• Jean Allouch Transportes Conférence à l’occasion de mon livre La règle, le compas et le divan, Seuil 2002.
• Cécile Renouard Ethique et entreprise 208 p., L’Atelier 2015 (édition de poche après celle de 2013).
• Bruno Latour Où atterrir ?, Comment s’orienter en politique La Découverte 2017.
• Guénaël Visentini Pourquoi la psychanalyse est une science, Freud épistémologue, PUF 2015.
• Gori R. et Hoffmann C., La science au risque de la psychanalyse, Essai sur la propagande scientifique, érès 1999.
• Isabelle Stengers Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences, Les Empêcheurs de Penser en Rond / La Découverte, 2013.
• Christopher Reich, Compte numéroté, trad. B. Cohen, Albin Michel 1998.
• Jean Allouch « Transportes » (2002)
A la suite de discussions récentes avec des collègues mathématiciens où nous avons évoqué le cas de Galois et plus généralement la maïeutique de la création mathématique, je trouve intéressant de faire connaître cette conférence du psychanalyste Jean Allouch prononcée publiquement à l’École des Ponts il y a une vingtaine d’années, à l’occasion de la publication de mon livre La règle, le compas et le divan, plaisirs et passions mathématiques, Seuil 2002. Transportes
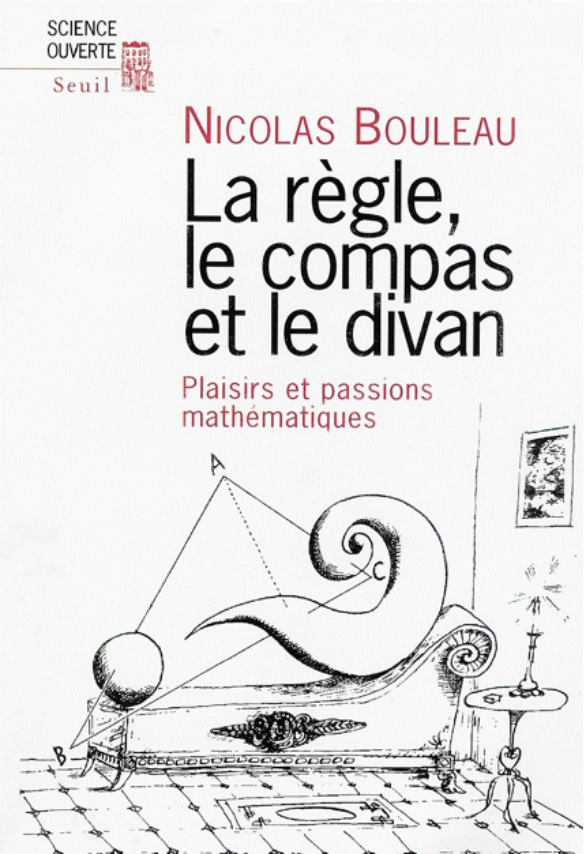
• Cécile Renouard Ethique et entreprise L’Atelier 2015. Ce livre n’est pas exactement ce que son titre pourrait faire croire, il ne nous parle pas tout à fait de l’éthique qu’on a l’habitude d’entendre ! Il ne s’agit pas de subtilités philosophiques et morales à propos du libre-arbitre, de l’entrainement technique, ni même du besoin de pensée cosmique ou de l’amour d’un prochain virtuel, son vrai titre pourrait être : La solution concrète, opérationnelle, ne se réduit pas au « tout marché ». Il s’agit d’une puissante remise en cause de l’économisme comme conduite de vie pour soi, pour l’entourage, pour le travail, et pour la planète. Non pas en rectifiant les calculs de Léon Walras ou de Jean Tirole, mais en replaçant nos actions dans une finalité collective viable.
Au fond le grand message d’Adam Smith est que l’éthique est inutile. Et on connaît ces passages célèbres où il s’accommode sans états d’âme du travail des enfants.
Toutefois le boulanger de Smith, ne peut pas être un automate, il se pose des questions, il est dans un contexte. Va-t-il mettre un peu d’ergot du seigle dans son pain juste pour que ça ne se voie pas et pour que ça donne de beaux rêves à ses clients ? Et que va-t-il faire si sa femme accorde ses faveurs à son concurrent contre quelques bijoux… Smith va dans le sens de la philosophie utilitariste de son contemporain Bentham qui fut ensuite approfondie par John Stuart Mill. Celui-ci découvrit combien ce courant s’accordait avec le positivisme d’Auguste Comte pour lequel il eut une grande admiration. Il dit de la loi des trois états de la connaissance de Comte qu’«on a du mal à imaginer quel flot de lumière elle jette sur le cours entier de l’histoire ». Or justement, Comte, contre son gré, rencontre l’éthique. Il fait la connaissance de Caroline Massin, femme légère qu’il épouse dans l’idée de la remettre sur le droit chemin mais qui continue à folâtrer avec ses anciens amis ce qui fera souffrir le philosophe à l’extrême jusqu’à la dépression et la séparation. Il connaîtra plus tard, le véritable amour avec Clotilde de Vaux qui mourra peu de temps après, laissant Comte changé et marqué pour le reste de ses jours par cet élan affectif.
Le sillage de Smith et de l’utilitarisme fut relayé par l’économie libérale et le pragmatisme. On arrive aujourd’hui à une doctrine géante, puissance temporelle et spirituelle, qui réussit en tant que religion non révélée là où les autres projets sociaux avaient échoué. Le problème est évidemment qu’elle réussit trop bien, et qu’elle empêche de voir les questions qui sont hors du champ où elle a été conçue. Comte et Marx sont morts, mais le capitalisme continue à nous imposer les solutions des problèmes du 19ème siècle.
Quelle est l’éthique pour Cécile Renouard ? « Je définis l’éthique comme la recherche déterminée, personnelle et collective, de la vie bonne, aujourd’hui et demain, dans des institutions justes, au service du lien social et écologique ». Mais si on compare à L’éthique du futur de Hans Jonas, à L’éthique du care de Carol Gilligan, ou aux approches plus classiques, cette définition dans sa simplicité est capable de porter très loin la contestation des doctrines philosophiques du « on n’a pas besoin de » que les pragmatistes ont construites et qui servent de base à l’idéologie économiste. Cette éthique se résume ainsi « Comment passer d’un hédonisme consumériste éphémère et nocif à une sobriété solidaire et savoureuse ? » (ce n’est pas, on le voit, le même projet que celui de Michel Onfray).
Les liens avec la pensée sociale que l’Eglise catholique a développée notamment par les encycliques des Papes Benoît XVI et Jean-Paul II, sont explicités. C’est qu’il existe évidemment un milieu catholique des affaires qu’il s’agit de convaincre au premier chef.
Le style est vivant, simple et agréable. L’ouvrage est très bien documenté, tant pour les données quantitatives que pour la littérature récente. Il ne se perd pas dans des technicités comptables, et ne tombe jamais dans les effets faciles en triant les chiffres pour leurs oppositions spectaculaires comme certains livres de journalistes. Cécile Renouard a réalisé un travail de recueil d’informations d’une qualité tout à fait inhabituelle dans les essais qui restent trop souvent au niveau purement polémique.
La référence (p. 82) à Bernard Mandeville, précurseur de Bentham et peu cité, est intéressante et la citation particulièrement savoureuse.
Je ne résume pas ici ce livre bien construit et facile à lire, très instructif, généreux, tout en restant réaliste.
Cécile Renouard prend le parti de ne pas se laisser faire par le positivisme implicite d’une économie qui se présente comme neutre, alors qu’elle porte entièrement sur l’appropriation des valeurs. Pour ce qui est de la méthode, je dirais que ce livre agit par la base, par en dessous, il rend superficielles les idéologies du profit.
Pour ma part, à propos du climat, de l’environnement, de la biodiversité, lorsque j’entends des responsables ou de conseillers d’entreprises se présentant comme convaincus des problèmes écologiques et énergétiques dire qu’il faut être « concret » pour faire avancer vraiment les choses, j’ai souvent l’impression que ce discours signifie simplement, en fait, qu’il faut trouver des solutions qui ne coûtent rien à ceux qui ne veulent pas payer.
Mais le livre de Cécile Renouard me fait voir les choses différemment. Je crois qu’elle a raison de ne pas chercher ni à s’offusquer, ni à redresser les torts, parce que c’est peu efficace. Il vaut mieux parvenir à glisser les leviers de déstabilisation sous les fondations apparemment solides du capitalisme concret, opérationnel et quotidien, et des droits qui le protège.
Pour tout de même formuler des remarques, je relèverais d’abord qu’en plus de l’analyse de la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) et de l’ISR (investissement socialement responsable), très bien discutés, il me semble qu’il aurait été normal de mieux souligner le problème moral de l’immunité de l’actionnaire. Le capitalisme tel qu’il s’est développé depuis les années 1980 avec le modèle néolibéral, accorde une place primordiale à la rémunération de l’actionnaire. Le principe est qu’on récompense vivement le choix judicieux de celui qui apporte des fonds aux entreprises florissantes ou prometteuses. S’il est si bien rétribué, c’est que cet acte est très important pour la société. On ne voit pas pourquoi l’actionnaire est a priori disculpé de ce qui est fait avec son argent. On est en pleine hypocrisie, la collectivité s’est privée, ce faisant, d’un levier qui lui est maintenant indispensable.
Il ne semble pas que soit évoquée la grande question de l’extraterritorialité du droit américain comme on l’a vu dans l’affaire Alstom.
Amartya Sen et Martha Nussbaum sont commentés et discutés, en revanche à la fin du chapitre 4, la critique de John Rawls est « laissée au lecteur » comme on dit dans les manuels. Le principe maximin n’est qu’une petite partie de la doctrine de Rawls qui pour l’essentiel est une justification d’une société de la course à la réussite, réussite définitivement légitimée ensuite par la liberté des règles du jeu initiales. (voir le mot clé « Rawls » sur ce blog).
A propos de la théorie de Freeman des « parties prenantes », Cécile Renouard défend « une conception résolument normative, selon laquelle les droits des personnes et des groupes doivent être prioritaires, et doivent être défendus par une institutionnalisation de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise. » C’est franchement un plaisir de lire un texte si indépendant des manières prudentes universitaires bridées par la publication dans les revues. Plus loin au chapitre 6, Cécile Renouard arrive à la conclusion qu’il faut fournir des critères et des indicateurs que l’économie ne fournit pas sur ce que fait une entreprise pour la société au delà de sa seule performance comptable. Des raisonnements totalement différents me conduisent à des conclusions similaires de la nécessité d’institutions pour palier les carences des marchés financiers sur le sujet très différent de la transition écologique des entreprises pour se détourner des ressources énergétiques épuisables. Les marchés ne donnent pas l’information utile qui doit être construite par un travail public sérieux et de qualité qui s’appuie nécessairement sur des institutions nouvelles au niveau local, national et global. (cf. la présentation du livre Le mensonge de la finance).
Pour finir, je dirai qu’il reste évidemment un handicap qui n’est dû au livre mais à son accueil : le lectorat athée peut se croire non concerné. Beaucoup d’intellectuels (P. Bruckner la sagesse de l’argent 2016, ou B. Cyrulnik et T. Todorov La tentation du Bien est beaucoup plus dangereuse que celle du Mal, 2017) ne parviennent pas à accepter l’idée que même si le collectif de cette planète est mal défini et s’il est l’objet permanent de tentations abusives, néanmoins il faut maintenant le défendre coûte que coûte.
• Bruno Latour Où atterrir ?, Comment s’orienter en politique La Découverte 2017.
Voici un titre très intéressant à l’heure où les marchés financiers brouillent complètement l’orientation politique, thème que j’argumente dans l’ouvrage Le mensonge de la finance aux éditions de l’Atelier février 2018.
Le livre de Bruno Latour se situe à un niveau tel qu’il est indispensable au préalable de rappeler quelques réalités. Les humains se multiplient et se regroupent dans les villes. Chaque année la population augmente d’environ 80 millions, c’est-à-dire de celle de l’Allemagne. La génération née après la seconde guerre mondiale a vu la population mondiale tripler.
Durant le même temps les captures halieutiques annuelles ont quadruplé. D’après la FAO, les stocks des sept premières espèces pêchées sont surexploités. Chaque année, les terres arables diminuent de la surface de l’Irlande et environ 13 millions d’hectares de forêts disparaissent soit la surface de l’Angleterre. On estime les réserves de cuivre à 38 ans, celles du zinc, du plomb, de l’étain sont plus courtes. La pollution des eaux et du sol par des produits industriels, pharmaceutiques et phytosanitaires atteint en beaucoup de régions un niveau irréversible à court terme. Quant au nucléaire, le parc mondial de 350 réacteurs vieillit, les incidents sont plus fréquents et les accidents plus graves.
Des ressources traditionnellement abondantes se raréfient comme l’eau douce, le sable, l’air pur. La biodiversité végétale et animale se dégrade à un rythme « géologique ».
Préserver la nature est plus difficile qu’on ne l’imaginait lorsqu’on a créé les grands parcs naturels des Etats-Unis (Yellowstone 1872, Yosemite 1890, Montagnes Rocheuses 1915, etc.). Par exemple les séquoias sont aujourd’hui menacés parce que leur avantage sélectif naturel était de survivre aux grands incendies épisodiques, qui sont impossibles à gérer artificiellement.
On sait maintenant que les réserves de ressources énergétiques fossiles sont telles que si l’on veut limiter le réchauffement climatique à un niveau acceptable pour la faune, la flore et les humains, il faut laisser plus de la moitié des réserves dans le sol. Au demeurant les puissances du Nord (Etats-Unis, Russie, Canada, Danemark, Norvège) se ruent vers l’exploitation des nouveaux gisements arctiques.
Le dogme économique rend tous les intérêts légitimes, quelle que soit leur divergence, quel que soit l’enjeu.
C’est bien à ce niveau de préoccupation que Bruno Latour prend la parole. Face à l’ampleur des préoccupations, on est heureux de voir qu’un intellectuel médiatique tel que Bruno Latour s’attaque au sujet et on ouvre son livre avec beaucoup d’espoir.
L’interpellation
L’ouvrage commence par trois chapitres qui sont une interpellation. Latour ne parle pas en spécialiste, en sociologue ou en anthropologue, il pose la question de notre époque, où nous allons, les raisons qui font que nos façons usuelles de penser peuvent nous embrouiller. Ces chapitres sont sur le mode décapant, ceux que j’ai le plus appréciés, les 15 suivants relèvent du structuralisme latourien, les deux derniers sont une sorte d’excuse modeste qui débouche sur des propos plein d’espérance sur l’Europe, sur fond d’américano-philie déçue.
Néanmoins dès le début Latour nous surprend. Lorsqu’il écrit « nous sommes entrés dans un Nouveau Régime Climatique », les majuscules sont là pour nous avertir qu’il ne s’agit en rien de l’évidence que répètent les scientifiques, mais de quelque chose de bien plus profond qu’il va expliquer. « Nous cherchons à atterrir » : à la remarque basique du Club de Rome qu’après l’overshoot il y a le collapse et que là les modifications sociales sont d’une telle ampleur que toute modélisation par scénarios ne permet plus de dégrossir même le qualitatif, Bruno Latour apporte une réponse à laquelle le livre est consacré. Il esquisse la méthode de pensée qu’il va utiliser. On croit que les migrants quittent leur pays, mais c’est à courte vue c’est le pays qui nous quitte. Le sol et le territoire vont être des embrayeurs linguistiques forts de sa démonstration « Migrations, explosion des inégalités et Nouveau Changement Climatique, c’est la même menace ».
La machine
Il y a beaucoup de formules. Plusieurs sont bien trouvées « les élites ont été si bien convaincues qu’il n’y aurait pas de vie future pour tout le monde qu’elles ont décidé de se débarrasser au plus vite de tous les fardeaux de la solidarité ». Hélas ce constat tourne court à la phrase suivante « pour dissimuler l’égoïsme crasse d’une telle fuite hors du monde commun il fallait absolument rejeter la menace à l’origine de cette fuite éperdue – c’est la dénégation de la mutation climatique ». Latour présente les élites comme des climato-sceptiques, non au sens basique, mais des climato-sceptiques au sens théorique, c’est-à-dire au sens de modernes. Le terme de modernes, modernisation est omniprésent dans ce texte souvent plusieurs fois par page.
Sur la globalisation on a dit trop de « globalivernes », ce qu’il faut comprendre c’est la différence entre la globalisation-plus et la globalisation-moins, et entre la localisation-plus et la localisation-moins. Voilà la machine lexico-structuraliste de Latour qui se met en marche.
Ce structuralisme est fondé sur l’emploi de schémas, exactement comme à l’époque de Politiques de la nature, comment faire entrer les sciences en démocratie La Découverte 1999. Et toujours avec la même technique d’un re-travail de notions de base faussement basiques.
D’abord dans l’ordre sémantique : scission des notions puis fusion des entités ainsi séparées…
Ensuite dans l’ordre syntaxique : ce sont les schémas avec les pôles – ici appelés attracteurs –, local, global, front de modernisation, l’attracteur hors-sol, … et cet attracteur Terrestre qui reste mystérieux durant longtemps avant que les derniers chapitres ne l’éclairent.
Enfin dans l’ordre pragmatique : les choses doivent être comprises comme des agents, sociologie élargie à tous les êtres, qui tous ont à dire.
Les outils de pensée de BL conservent sa marque de fabrique : une sorte de pan-animisme comme dans les contes de Perrault pour faire parler ce qui ne parle pas d’ordinaire, ici le sol : « L’expression ‘j’appartiens à un territoire’ a changé de sens : elle désigne maintenant l’instance qui possède le propriétaire ! » Le sol devient un agent, les choses se mutent en agents. Cette « agentivité » généralisée, qui est le pilier final de sa construction, BL n’explicite pas combien elle ressemble au pragmatisme utilitariste américain qui a nourri et a conforté la doctrine du libéralisme économique durant tout le 20ème siècle. Il actualise William James qui pensait à l’âme de la terre.
Comparer aux contes de Perrault n’est certes pas péjoratif, ces allégories ont une grande profondeur… mais on peut se demander si BL n’abuse pas quelque peu de la ruse de transformer l’ogre en souris pour le manger ensuite.[1]
A l’occasion BL se moque des climato-sceptiques : la dénégation « cela les rend fous »… Voilà des propos bien différents du relativisme relatif de Nous n’avons jamais été modernes et du principe de symétrie du vrai et du faux. Mais BL s’en est expliqué, ayant remarqué que les climato-sceptiques et les faiseurs de doutes étaient les bons élèves de la sociologie des sciences, il a mieux cerné sa position : il travaille dans le monde de la critique, ses articles sont marqués made in criticalland. Et le climato-scepticisme explique l’immobilisme : »on les a incité [les gens ordinaires], au prix de milliards de dollars investis dans la désinformation à se défier d’un petit fait massif – la mutation du climat ». N’est-ce pas trop vite dit ? On n’a pas dépensé tant que ça pour nier le travail de l’IPCC, il faudrait comparer avec les budgets de com de Monsanto, de Sanofi, et avec le budget de la défense américain. Non, justement c’est un point fondamental, ça a été très facile de faire croire aux gens ordinaires qu’ils n’avaient qu’à continuer comme avant. Nous fonctionnons avec des centaines d' »esclaves énergétiques ». Difficile de s’en passer. Lorsque BL poursuit « Alors que le public aurait pu trouver une issue de secours, les climato-sceptiques se sont mis devant elle pour leur en interdire l’accès. » Je ne crois pas que cette façon de parler éclaire. Les journalistes ont eu une facilité étonnante au contraire à flatter la propriété privée et relever les doutes de toute sorte sur ce que disent les scientifiques.
L’atterrissage est la grande question laissée en pointillés par le Club de Rome. Ces auteurs sont très prudents… Latour propose une vision, l’attracteur Terre. Une sorte de nouvelle Weltanschauung qui permettrait, selon une sociologie compréhensive des imbrications des choses et du sens, de dissiper les mauvaises croyances au progrès et aux facilités des égoïsmes. Cette façon de résoudre les grands problèmes me rappelle quelque chose… Cela ressemble à l’invention des produits dérivés par Arrow et Debreu pour régler toutes les incertitudes économiques.[2]
« Si l’on avale toute crue l’épistémologie usuelle, on va se retrouver prisonniers d’une conception de la ‘nature’ impossible à politiser puisqu’elle a été justement inventée pour limiter l’action humaine grâce à l’appel aux lois de la nature objective qu’on ne saurait discuter. » Elle n’a pas du tout été inventée pour limiter l’action humaine ! Pensons à Francis Bacon, à Ernest Renan, à Marcellin Berthelot ! Et aujourd’hui ce n’est pas ce qu’on pense dans les laboratoires de biologie de synthèse. Quel est l’intérêt de tels slogans? La politisation de la nature ne saurait être un chèque en blanc à des légitimités politiques qui pourraient essayer tout ce qui vient à l’esprit pour voir ce qui se passe par essais-erreurs. Politiser la nature ce n’est pas la « piloter » ni laisser les gens faire la biologie de synthèse dans leur garage.
La seule critique que BL fait à la science nomologique c’est qu’elle adopte le point de vue de Sirius. Elle se référerait tant à l’infinité du monde qu’elle adopterait toujours un point de vue sidéral sur les choses terrestres. Décidément, BL prend les scientifiques pour des enfants de chœur un peu bornés. Et la psychologie neurologique, et les sciences cognitives, et les big data qui tentent de capter les qualités idiosyncratiques des individus, tout cela ce ne sont pas des généralités loin des hommes. Critiquer la science de conquête en la caricaturant, c’est un peu facile.
Le chapitre 14 n’est pas le meilleur du livre. BL s’est fait connaître en étudiant les scientifiques en train de travailler, mais il connaît mal la science, il en parle à l’emporte-pièce. C’est dommage parce que son propos aurait beaucoup plus de force s’il parvenait à une empathie minimale avec les difficultés que rencontrent beaucoup de chercheurs, qui aiguisent leur intelligence et donnent fondement à leur prudence.
« il faut à la fois étendre et limiter l’extension des sciences positives » enfin une assertion avec laquelle je peux être d’accord. Sauf que je comprends que Latour et moi n’avons pas du tout la même idée de ce qui manque aux sciences positives. (Je renvoie ici à mon essai Science nomologique et science interprétative, connaissance de l’environnement ISTE 2018 ).
BL martèle – presqu’à chaque page – la responsabilité du modernisme. Le suremploi de ce terme dans ce texte reste dans les ornières de la sociologie des sciences pour penser la connaissance scientifique. C’est le point aveugle de BL. Il n’est pas en position de reconnaître que parmi les scientifiques, pas tous mais de plus en plus, il y a les gens les plus sensibles au long terme, les plus réticents à la pensée nomologique, et à la religion du progrès. C’est une armée dispersée, mais des noms illustres en font partie. Les scientifiques ne sont pas représentés par les signataires de l’appel de Heidelberg, ils ne sont pas que des experts technocrates stipendiés, des petites mains dans l’arrière cuisine, commandés par le « Modernisme ». Beaucoup ont réfléchi sur ce qui restait de la soif de connaître et de ses modalité lorsqu’on prend en compte des limites imposées par la biosphère et qu’on sait notre ancrage naturel et social.
C’est un choix très net de passer tout cela sous silence.
L’accouchement de la montagne
Le peu de pages où l’auteur s’engage sur des voies de solution, la conclusion, consiste à comprendre que les choses, les êtres vivants, et les autres êtres de culture, sont des agents, et à faire que ces êtres-agents puissent engendrer. Ceci se fait en procédant à l’inventaire des territoires de vie, les listes pour qualifier les engendrements. Cette procédure est mise en parallèle avec les cahiers de doléance de 1789.
Il y a des paragraphes un peu mystérieux. BL laisse entendre que le progrès vers l’attracteur Terrestre est bien un progrès positif comme l’ancien progrès avec son esprit d’innovation mais « seul est modifié le point d’application de cet esprit » qui va permettre de nouvelles « grandes découvertes ». N’est-ce pas un peu trop abstrait pour avancer réellement sur les problèmes ? Remplacer « système de production » par « système d’engendrement », est-ce suffisant?.
La page 113 est extrémale. Toutes les dégâts et catastrophes que nous observons, les éléments qui se déchainent, les maladies qui se répandent et autres dérèglements (BL n’évoque pas les crises financières mais c’est implicite) ce ne sont que l’expression de ces choses qui parlent qui sont devenues des agents. Et il faut s’en réjouir parce que c’est cela qui va faire comprendre que Bruno Latour avait raison. Je cite « Désormais, nous bénéficions, si l’on peut dire, du secours des agents déchaînés qui obligent à reprendre la définition de ce que c’est qu’un humain, un territoire, une politique, une civilisation. » Après s’être moqué de Pasteur d’avoir « inventé » les microbes, Latour invente l’engendrement par les choses-agents pour expliquer ce qu’est l’homme, le territoire, la politique et la civilisation. Peut-être pense-t-il que ça va marcher aussi facilement que pour Pasteur.
Cet essai est une esquive. Il s’en rend compte assurément « Le but de cet essai n’est certes pas de décevoir, mais on ne peut pas non plus lui demander d’aller plus vite que l’histoire en cours ». Fausse modestie, à comparer avec l’emphase prométhéenne précédente.
BL est convaincu que les faits n’ont de consistance solide que si la société a un vivre ensemble partagé suffisamment fort. Sinon ça flotte, sorte de lévitation chaotique, dans laquelle nous sommes maintenant qui inhibe définitivement les « modernes ».
Je ne suis pas d’accord avec l’hypothèse initiale. Trump aura beau faire tout ce qu’il voudra, les climato-sceptiques auront beau modifier les programmes scolaires, et les médias répéter qu’on n’est sûr de rien, les fabricants d’armes auront beau jouer la complexification géopolitique, le CO2 dans l’atmosphère restera à la concentration que l’on mesure selon les règles de la science moderne et positiviste. Et de même pour la déforestation, les ressources halieutiques et la pauvreté. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas à améliorer nos moyens de connaître pour entendre mieux les dégradations du contexte de la vie sur la planète. Pour rester chez Charles Perrault, Latour a chaussé les bottes de sept lieues et ne les quitte pas.
Le dernier chapitre est un plaidoyer pour l’Europe, un peu vague, sans dire pour quelle Europe vraiment (avec ou sans le TAFTA, avec inflation ou pas, avec création monétaire publique ou pas, etc.), sans lien direct avec la métaphysique précédente.
La grande absente
BL jamais n’évoque l’irréversibilité. C’est pourtant un trait essentiel de toute la problématique qu’il envisage. Irréversibilité de l’extinction des espèces, de la désertification, irréversibilité des non-linéarités climatiques (sur le Groenland sans glace il ne neigera plus), irréversibilité politique (les lois difficiles à défaire), irréversibilité des pesticides protégeant les OGM., etc.
Mais surtout, BL ne désigne pas clairement la propriété privée comme mode de vie à réaménager. Il ne pointe pas la force immense de l’idéologie économique concrètement.
Nous sommes dans la démocratie à la criée, non pas une voix par personne mais un décibel par dollar. Or de l’économie BL ne dit rien. C’est stupéfiant… Dans cette vaste orchestration l’économie n’intervient que furtivement, par la référence à Polanyi et par la mention rapide des inégalités.
Que la philosophie des services éco-systémiques justifie la lente destruction des sols, que les marchés financiers conduisent très mal les productions et les échanges, il faut le dire…
BL ne parle pas du problème de la propriété privée, de l’importance de nouvelles règles pour les communs. Ou plutôt il en parle, mais d’une façon telle que les uns peuvent y voir une vision radicale et les autres une justification du statu quo… Ce qu’il faut comprendre c’est que ce n’est pas le bourgeois qui possède une maison et un portefeuille de titres, non, c’est la maison qui possède le bourgeois, quant au portefeuille, on ne sait s’il possède le bourgeois ou le fonds de placement. Et pourquoi ne pas pointer que le délitement du social est largement dû à cette économie du crédit qui pousse les implantations d’entreprises là où le law shopping est le plus avantageux pour les actionnaires.
Que les choses, les êtres vivants, les réseaux et autres configurations sociales soient des agents qui « engendrent », n’est-ce pas simplement dire qu’ils ont un rôle essentiel qui leur vient du social et du mouvement de l’époque? Mais alors il faut expliquer en quoi ce rôle diffère de la valeur financière qu’on peut leur attribuer par l’économie. En quoi le système d’engendrement ne se ramène pas au résultat d’une analyse coût bénéfice. Quelle est donc la force d’attraction dans la cosmogonie des attracteurs ? On ne la voit pas. Il y a une absence oppressante, la grande maîtresse du jeu qui est partout et dont on ne parle quasiment pas dans cette approche c’est l’économie. La modernité et l’économie, même en termes très vagues, ce n’est pas la même chose. L’engendrement est si proche des services éco-systémiques que le risque est immense que ceux qui croient comprendre confondent les deux notions. Ne pas prendre la peine de procéder à cette scission va engendrer, c’est le cas de le dire, une fusion. Cette grave ambiguïté ne sera pas pour déplaire aux chargés de stratégie d’entreprise pour « verdir » leur image.
Le problème est-il réglé en montrant la gauche et la droite dans les ornières de la modernité ? On peut faire semblant de penser la nature politiquement en faisant des inventaires sans se soucier de savoir si l’économie contribue à faire parler les choses ou pas. Cette scotomisation de l’économie du bien-être envahissante et omniprésente dans la pratique politique fait du discours de BL une échappée hors de la lutte pour une vie digne de tous qui est la bienvenue pour le capitalisme néolibéral. Je n’imagine pas qu’on puisse faire une place aux tigres, au glyphosate, au nucléaire et aux abeilles sans regarder à qui ça coûte à qui ça profite. La pensée « engendrante » n’aurait de pertinence qu’en opposition explicite et radicale à l’économisation du monde. En ne le disant pas vraiment Bruno Latour fait semblant d’un discours lucide et généreux mais qui suppose en fait le problème déjà résolu. Il contribue à la procrastination générale car celle-ci est indissociable de la vision économique totale du monde (cf. situations d’immanence constante http://www.nicolasbouleau.eu/le-catastrophisme-de-posture/).
[1] L’animisme devient une philosophie. Dans une conférence récente (ENS, 9 janv. 2018) le mathématicien Laurent Laforgue montre que les écrits philosophiques d’Alexandre Grothendieck emploient le registre animiste : les choses parlent. Mais Laurent Laforgue souligne aussi que toute la question est la relation entre cette compréhension accueillante et la socialité de la connaissance, ici donc le lien avec les travaux mathématiques de Grothendieck. Je pense personnellement que cette manière animiste n’est pas une simple façon de raconter la créativité après qu’elle a opéré. Elle est la forme première la plus simple du talent interprétatif présent chez le scientifique productif. Elle existe dès l’art pariétal voir sur ce blog et voir Penser l’éventuel Quae 2017).
[2] Parce que cette trouvaille répercute les inquiétudes des intervenants des marchés sur tous les acteurs économiques et qu’il est impossible de piloter les affaires sans signal-prix juste avec des assurances. Le résultat est que les raretés ne se voient pas sur les prix pour engager la transition (cf. Le mensonge de la finance L’Atelier 2018, cité plus haut). Le parallèle vient du sous-titre Comment s’orienter….
• Guénaël Visentini Pourquoi la psychanalyse est une science, Freud épistémologue, PUF 2015.
La psychanalyse est sous pression. Les sciences cognitives veulent plus de place. Les universitaires affirment définitivement que la connaissance est ce qui peut s’enseigner dans les amphis. Les crédits se restreignent dans les hôpitaux et y prévalent les soins fondés sur la pharmacopée.
Aussi le livre de Guénaël Visentini apparaît comme à contre courant, une tentative de rétablissement des fondamentaux. Il fait penser à un ouvrage un peu plus ancien de Roland Gori et Christian Hoffmann que j’ai évoqué récemment ci-dessous sur ce blog.
Un point commun des deux ouvrages est de considérer la position épistémologique de Feyerabend indépassable : pour Gori et Hoffmann » Le tout est bon de Feyerabend constitue la position pragmatique la plus adéquate ». L’introduction donne le point de fuite de l’ouvrage en citant Canguilhem « Ce que la science trouve n’est pas ce que l’idéologie donnait à chercher. Toute découverte, en psychanalyse comme ailleurs relève d’une transgression de la signification, c’est-à-dire d’un savoir constitué au profit d’une connaissance de l’inattendu ».
Feyerabend est aussi l’argumentation centrale de l’ouvrage de Guénaël Visentini. Par un travail très approfondi, et au demeurant passionnant, celui-ci nous fait suivre les tentatives de Freud pour élaborer une connaissance avec toutes les spécificités d’un domaine nouveau. Et tous les aspects de cette démarche viennent ainsi s’insérer dans une construction de connaissance dont les traits, même les plus positivistes, comme les diagrammes des topiques et autre affirmation que c’est la vérité qui soigne, ne sont que des aspects de ce chemin qui débroussaille l’inconnu avec des outils de circonstance. On ne peut qu’acquiescer à ce récit historique. Dès lors que la singularité du domaine de connaissance est reconnu, suivant Feyerabend, toute aventure cognitive est un exemple de la diversité des modes de construction du savoir.
Le problème est que nous sommes à l’époque des climato-sceptiques, des faiseurs de doutes, et de tous ces mercenaires de la connaissance qui utilisent habilement la socialité du discours scientifique pour se mettre au service d’intérêts privés. La thèse de Feyerabend est, au final, extrêmement complaisante vis à vis des cyniques et des habiles faussaires.
C’est l’occasion de souligner ici l’insuffisance des vues de Paul Feyerabend. Elles sont terriblement datées. Les discussions argumentées entre Popper, Kuhn, Lakatos et Feyerabend, pour passionnantes qu’elles soient, portent toujours sur le problème épistémologique classique de caractériser la connaissance véritablement scientifique et comprendre les processus susceptibles de l’engendrer. La même chose peut être dite des penseurs moins cités Bachelard, Quine, Lautman, ou des essais de philosophie des sciences de grands scientifiques tels que le 20ème siècle en a abondamment produit (Jean Ullmo, Bernard d’Espagnat, David Ruelle, etc.). Si, dans de tels débats, la position de Feyerabend paraît iconoclaste, elle n’en reste pas moins attachée aux mêmes valeurs. En prônant le slogan « tout est bon » ou plus fidèlement « tout marche », Feyerabend abonde dans le sens du développement scientifique, si mal défini soit-il, par émerveillement devant la richesse de sa fécondité. Feyerabend se place à la limite mais dans la problématique classique. D’autres vues sont apparues au 20e siècle : la philosophie écologique, la sociologie des sciences, la fragilité de la nature et son échelle de temps, l’opposition au modernisme, le travail scientifique sur les menaces environnementales. Elles apportent incontestablement un changement de registre, sur fond d’une opinion publique grandissante que « tout n’est peut-être pas bon » et que la question n’est pas uniquement de savoir « ce qui marche ».
Il se pose corrélativement la question de l’empirisme, Feyerabend, grand admirateur de Ernst Mach, est partisan de poser toutes les questions possibles à la nature, alors que nous sommes aujourd’hui beaucoup plus réservés lorsqu’il s’agit d’expériences qui peuvent violenter la nature au delà de sa résilience.
Comme mathématicien j’ai une vision assez différente du fonctionnement de la psychanalyse à utiliser et produire de la connaissance. Cette vision, que je vais esquisser, est plus lacanienne, non pas à cause du goût de Lacan des diagrammes et raccourcis mathématiques mais pour sa conception de la connaissance qui m’apparaît un renouveau épistémologique remarquable.
D’abord j’accorde une grande importance à l’interprétation dans la science, je renvoie sur ce blog à l’article Le talent interprétatif condition de la connaissance. Et en ce qui concerne la psychanalyse je dirai que pour moi le travail du psychanalyste pendant la cure est de même nature que le travail du mathématicien : à partir d’une base interprétative standard à disposition dans la communauté, élaborer une lecture de matériaux nouveaux spécifiques, soupeser sa pertinence, et la modifier si elle n’est pas féconde.
C’est ce que fait le mathématicien. Evidemment ses matériaux ne sont pas les mêmes, sa terra incognita n’est pas l’inconscient du patient mais l’inextricable de la combinatoire formelle. La situation à laquelle il s’intéresse n’est jamais sans aucune signification, elle a des racines historiques qui furent abordées grâce à des outils sémantiques qu’il connaît. Mais ce sont des prolongements bien au delà du champ de ces lectures qui l’intéressent. Il lui apparaît rapidement que les significations standard sont ambiguës, incomplètes, bifurcantes, etc. Et là où la ressemblance des deux activités est frappante, c’est que le mathématicien est amené à « aller voir » si le réel répond comme il imagine, et que la formulation de cette quête lui apparaît déjà comme une avancée. Il a besoin alors d’une certaine docilité pour prendre en compte ce qui advient.
Il serait artificiel de pousser l’analogie trop dans le détail. On peut toutefois aller un peu plus loin que Poincaré et Hadamard qui ont apporté la preuve du rôle de l’inconscient chez le mathématicien mais uniquement d’un inconscient esthète. Plus loin dans deux directions au moins : celle des liens entre la créativité interprétative et l’angoisse paranoïaque, pendant la cure et en général (cf mon étude sur Galois et mon témoignage dans La règle, le compas et le divan, Seuil 2002), et celle du rôle du transfert.
Sur ce dernier point en effet, pour nous mathématiciens, je suis persuadé que la place qu’occupent dans notre affectivité les très grands mathématiciens dont on a pu apprécier les idées et le talent est tout à fait inhabituelle dans les relations professionnelles ordinaires. Nous faisons plus que les admirer, nous les aimons, sommes prêts à des sacrifices pour eux pour suivre un de leurs encouragements, prêts à relever un défi pour augmenter leur estime. Et eux nous aiment en retour, sans qu’il soit besoin de le dire.
Il me semble que l’on tient par ce parallèle beaucoup mieux la spécificité de la psychanalyse avec son « package » d’interprétations communes travaillées collectivement et à disposition, et le talent interprétatif du thérapeute sur des matériaux idiosyncratiques dans le cadre de la cure. Cela replace aussi Freud dans une véritable Verleugnung de son propre talent interprétatif, et situe historiquement sa difficulté à envisager le pluralisme des interprétations pertinentes.
Si l’on a à l’esprit le fonctionnement de la communauté mathématique, et le même s’observerait dans d’autres domaines, il y a un travail collectif très important, par les rencontres, les séminaires et la littérature spécialisée de constitution d’une base commune de paradigmes utilisables par chaque chercheur, où se pose en permanence la question de savoir si les interprétations révélées par tel ou tel ont une certaine valeur générale ou doivent simplement être considérées attachées au cas particulier étudié. Il est évident aujourd’hui qu’un pluralisme est indispensable pour ce bagage commun, pluralisme tolérant quant à sa pluralité mais exigeant quant à la cohérence de chaque vision. A cet égard Freud dans sa gestion de la communauté impose une doctrine unique, même quant au vocabulaire, (cf. son refus du terme de scotomisation, etc.) par un contrôle épistolaire permanent et vigilant. C’est la contribution majeure de Lacan d’avoir proposé de partager des vues nouvelles qui renouvelle cette « académie » de la psychanalyse.
Dès lors que la psychanalyse, sous l’angle de sa production de connaissances, se trouve banalisée par le parallèle avec le cas des mathématiques, reste à regarder la question de sa justification sociale. Là évidemment c’est très différent. Les mathématiques, depuis l’antiquité grecque et chinoise, tiennent leur justification de proche en proche à partir des nombres et de la géométrie dans la vie quotidienne, et dans l’architecture et la musique. On doit toutefois observer que si nous effaçons par la pensée ces racines historiques et prenons les mathématiciens d’aujourd’hui sans écouter leurs propos vulgarisateurs uniquement pour ce qu’ils font, on pourrait se demander si cette activité cabalistique a quelque rapport avec la science…
La psychanalyse est une activité bourgeoise. On doit le reconnaître, elle est coûteuse pour le patient dans la cure privée et en temps de présence d’un soignant dans le cadre public. Peut-être peut-on considérer, c’est une hypothèse, que dans les couches populaires le lien social plus fort compensait dans une certaine mesure l’absence de thérapie psychique. C’est un peu la thèse de Durkheim pour expliquer les taux de suicide en corrélation inverse avec la pratique religieuse (à son époque).
Mais la période que nous vivons est bien différente. Le lien social se délite gravement tout spécialement dans les classes populaires. Pour de multiples raisons : chômage massif, détérioration des conditions de vie, brutalité des mélanges de cultures et de religion dus aux migrations, difficultés à adapter l’amour à la vitesse de changement du capitalisme, restriction des dépenses publiques dans le domaine social (ce qu’on appelle la fin de l’Etat providence qui signifie plus précisément la fin de la générosité bourgeoise).
Là, la connaissance psychanalytique se greffe sur la civilisation d’une façon forte mais complètement autre que l’utilitaire des mathématiques : par l’éthique.
Elle suggère une attention nouvelle à certains traits de la nature humaine. Freud, Lacan et beaucoup d’autres ont consacré une grande part de leurs écrits à cette dimension qu’ils ont considérée à juste titre fondamentale. Mentionnons quelques uns de ces accents.
– Le difficile et le compulsif. Il y a du « aide toi le ciel t’aidera » dans la psychanalyse, forme du Wo es war soll ich werden. Le capitalisme c’est compulsif, ça utilise toujours la facilité, ça produit de l’innovation sans se soucier du contexte, comme si le contexte était une providence aussi bienveillante que la maman. Les choses difficiles sont réellement l’enjeu. C’est l’effort-plaisir-effroi de se diriger vers autre chose. C’est du registre du transport de l’amour vers une autre femme que la mère, vers un autre homme que le père, ça modifie l’actif et le passif, la routine et le but. Les scientifiques ont sous-estimé les forces compulsives du capitalisme, ils ont cru qu’il suffisait de dire les faits observés, comme dans les interventions des colloques, pour que les décideurs imaginent la suite, la misère de la vie dans la pollution, l’extension du domaine de l’inerte, l’irréversibilité des changements climatiques, etc., et s’emparent du problème. C’est une erreur, il ne faut pas faire confiance au capitalisme, c’est une machine qui a été conçue pour un autre problème.
– Au connais-toi toi-même est suggéré de substituer une vigilance vis-à-vis de notre animalité dans sa force et sa fragilité, une acceptation sous condition. Egalement reconnaître au détail l’origine parentale du surmoi et notre propension à chercher qu’il soit socialement partagé pour former des réseaux ou des communautés.
– Peut-être le trait plus fort est la reconnaissance du rôle fondamental de l’amour dans la société. Aussi important que l’eau. Peut-être aussi menacé qu’elle. Denrée précieuse, souvent il manque, on ne sait pas comment le faire renaître. Le grand Autre est compris de maintes façons, projection vers une société qui n’est pas comme on la souhaiterait, appel sans réponse. On ne peut être révolutionnaire tout le temps, la force manque. En chassant le religieux, la science positive n’a pas laissé de place suffisante à l’amour.
Ajoutons un « enseignement » de la psychanalyse, plus caché mais essentiel pour comprendre les tendances du monde contemporain. La créativité de la vie singulière. Cela veut dire deux choses. D’abord la non réductibilité à quelque système que ce soit de la configuration personnelle, ni par une psychologie scientiste, ni par les gènes et une biologie envahissante. C’est un pilier central pour une forme d’humanisme respectueux de ce qui est merveilleux chez l’autre, curieux, inattendu, surprenant, artistique, séduisant. Et le second volet, dual, qu’il y a de l’ignorance irréductible dans ce que nous, comme sujet et la société dans son ensemble, savons de tout être humain particulier, et que la conscience de cette ignorance est au cœur même de la civilisation. Il y a un danger d’oublier cela à cause de la superbe que la science positive a installé en Occident. Un fait caractéristique doit nous alerter. Les statistiques de l’OCDE et de la Banque mondiale montrent que le niveau de vie et le PIB par habitant s’améliorent quasiment partout. Et pourtant la misère s’abat dramatiquement sur la majeure partie du monde. Où est l’erreur ? C’est que la misère ça invente ! Les grilles très rationnelles faites par les pays confortablement installés dans un quotidien sans problème décrivent le monde sans rien en comprendre et objectifient les seuls critères qui garantissent leur supériorité à leurs propres yeux. L’Occident malgré sa science hyper-développée ne parvient plus à comprendre la souffrance qu’il a largement engendrée.
• Gori R. et Hoffmann C., La science au risque de la psychanalyse, Essai sur la propagande scientifique, érès 1999.
On a souvent remarqué que Freud était très attaché à voir la psychanalyse comme le début d’une connaissance scientifique qui progresse grâce à la pratique et la théorie. Il propose des schémas pour organiser l’ensemble des différents concepts : la première puis la seconde « topique », à la fois sous l’angle « clinique » c’est-à-dire du processus de la cure, et sous l’angle de la charpente théorique, il est précautionneux et le plus logique possible pour contribuer à une démarche scientifique.
Ce statut de science sera contesté par plusieurs penseurs et particulièrement par Popper dans des textes très virulents ainsi que par Wittgenstein en termes plus nuancés.
Aujourd’hui ce débat s’est émoussé. L’enjeu d’avoir l’étiquette, l’appellation contrôlée « science » n’est pas considéré comme si essentiel pour plusieurs raisons: a) la ligne de démarcation tracée par Popper n’est guère pertinente pour les sciences humaines et sociales b) la dimension interprétative est maintenant considérée comme consubstantielle de la connaissance (Ullmo, Kuhn, Ravetz, etc.).
Mais surtout l’époque n’est plus la même. La psychanalyse elle-même n’a plus besoin de cette caution, elle a sa spécificité et le reconnaît. A l’époque de Freud, parler des pulsions sexuelles, de l’amour refoulé pour le père, de complexe de castration, était extrêmement difficile dans la société bien comme il faut qui dominait socialement.
Dans leur ouvrage Roland Gori et Christian Hoffmann poursuivent le débat épistémologique et tentent de retourner la situation en posant la question : la psychanalyse ne permet-t-elle pas de dénoncer une carence dans la construction de savoirs de la science ? Et ils pointent « l’effacement de la parole dans le discours des sciences contemporaines ». Leur critique porte pleinement sur la dominance du positivisme qui, effectivement, s’attache à scotomiser toute initiative du sujet dans les avancées de la connaissance. Mais plusieurs préoccupations contemporaines font que cette vision positiviste est en passe de passer au second plan devant les urgences environnementales et écologiques où interviennent de façon légitime des démarches interprétatives.
Les auteurs dénoncent « cet abus des métaphores dans la science moderne » (p21) et plaident pour une prise en compte de la parole comme matériau ré-interprétable existant aussi dans la vie scientifique. La science serait plus langagière, sémantique et sociale que ne le disent les positivistes. La psychanalyse laisse penser que c’est la parole qui serait le creuset de cette émergence.
Il me semble que c’est trop tirer la couverture à soi. La source d’invention interprétative de la parole en psychanalyse ne peut faire méconnaître le travail interprétatif dans la science dirigé vers des schémas et formalismes déjà partiellement interprétés mis à l’épreuve dans des expériences nouvelles. Forçons le trait, en chimie, trouvera-t-on un catalyseur en parlant seulement avec des collègues ? En physique, les nombres entiers qui apparaissent dans les raies d’émission et d’absorption ne sont ils pas la donnée nouvelle à interpréter pour construire la nouvelle mécanique et installer le paradigme de l’atome de Bohr ?
Il me semble à la lecture des divers articles qui constituent l’ouvrage de Gori et Hoffmann que l’idée qu’il y a une absence dans la science conçue selon les canons positivistes et que ce manque est lié à la dimension interprétative — idée présente chez de nombreux auteurs parmi lesquels on peut citer Poincaré, Emile Picard, Elisabeth Metzger, Bachelard, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, etc. — ne peut véritablement prendre corps en une vision épistémologique que si l’on accepte une pluralité dans la science, pluralité dont le statut est d’être en travail dans la communauté. Faute d’une telle conception pluraliste on ne voit pas comment on peut échapper à la vision positiviste.
La position de Gori et Hoffmann va même jusqu’à critiquer les idéalités de la science (p17) parce qu’elles ignorent « la séduction de l’entendement humain dans l’immanence des actes d’énonciation » de sorte que « l’idéologie comme le mythe ne peuvent être éradiqués de la connaissance scientifique » et ils proposent de « reconnaître un matérialisme du signifiant nous incitant à ne rendre compte qu’en termes de réalité discursive ». Cette vision peut-elle aller plus loin qu’une posture polémique ? Il y a trop de faiseurs de phraséologie sans fin, ce matérialisme est aussi flou et idéologique que l’autre. A bien des égard les idéalités de la science sont des arrachements qui ont leur valeur en tant que tels. Ecrire « Le tout est bon de Feyerabend constitue la position pragmatique la plus adéquate » est trop facile, et frise l’hypocrisie. Car finalement c’est un conformisme encore plus absolu que le positivisme, qui maintient comme souci premier de faire avancer la connaissance scientifique par tous les moyens, dans n’importe quelle direction, quels que soient les mobiles des acteurs et les intérêts économiques en jeu.
Je crois qu’en psychanalyse le discours du patient est « précieux » parce qu’il n’a pas grand-chose à dire et a du mal à le dire. Alors que socialement nous nous trouvons dans une situation de surabondance, de profusion, de surdoués du discours savonneux dont nous n’avons que faire.
Puis il est fait référence à une remarque de Canguilhem « Ce que la science trouve n’est pas ce que l’idéologie donnait à chercher » et les auteurs ajoutent « Toute découverte, en psychanalyse comme ailleurs, relève d’une transgression de la signification, c’est-à-dire d’un savoir constitué au profit d’une connaissance de l’inattendu » (p37).
On doit, à mon avis, nuancer la proposition de Canguilhem, car n’en déplaise aux vues nobles et édifiantes, la science normale a aussi sa fécondité, aussi surprenant que cela puisse paraître.
Quant à l’inattendu qu’est-ce que cela veut dire ? Où est-il l’inattendu ? Dans la trouvaille géniale de l’inventeur, tel Monsieur Pigeon représenté au cimetière du Montparnasse sur son lit en train de s’éveiller subitement par la vision inattendue de la lampe qui a immortalisé son nom ? Certes, la maturation inconsciente existe, Poincaré et Hadamard en ont apporté des témoignages passionnants. Mais on n’a pas beaucoup avancé en reprenant le vieux thème de l’illumination dans l’heuristique scientifique.
L’inattendu il est là, déjà. Toutes les craintes déjà socialement formulées, ces interprétations et ces sur-interprétations concernant : la fin des abeilles, la notion d’épisode cévenole, la contamination de la nature par des OGM, les effets des faibles doses de rayonnement, les perturbateurs endocriniens, etc., ne sont ni des entités magiques, ni des transgression de signification. Elles sont des requêtes de travail scientifique dans le champ interprétatif. Des urgences même, oh combien difficile à traiter, si on les compare au phlogistique, au calorique et autres « éther » sur lesquels on a déjà statué.
Il n’est pas nécessaire d’être post-moderne, sociologue des sciences, ou tenant de la performativité de la science pour comprendre que l’échappée hors du positivisme réside dans les questions que l’on pose.
Mais continuons notre lecture car elle aborde un point important de la philosophie. Heidegger est cité dans Qu’appelle-t-on penser ? : « La multiplicité de sens est plutôt l’élément où la pensée doit se mouvoir pour être rigoureuse ». Belle idée, apparemment. Et pourtant il s’agit d’une façon extrêmement laxiste de penser le pluralisme à laquelle je ne peux souscrire. Cela ne peut mener qu’à un discours « au dessus de », on a perdu tout l’opérationnel du pluralisme. La rigueur doit tout au contraire se situer au niveau de chaque interprétation. C’est là l’audace de pensée à laquelle nous invitent les mathématiques et à laquelle rechignent tant les philosophes que les positivistes. Ce métadiscours de Heidegger est de l’émotion philosophique bon marché, nous sommes appelés à situer notre intelligence dans des enjeux plus difficiles.
Les auteurs en arrivent à la question, en effet centrale, « comment parler science à partir de l’étude du singulier » (p110).
Peut-on faire de la psychanalyse le creuset générique de la solution de ce problème ? N’a-t-elle pas trop de spécificités, n’est-elle pas méthodologiquement trop fragile pour servir de mannequin à une connaissance collective ?
Il y a plusieurs sortes de singulier. Il y a d’abord ce que j’appellerai le fortuit : tout l’étant qui n’est pas dans le champ d’une « loi ». C’est l’immensité des « c’est comme ça » qui fait que le monde est ainsi et non un autre qui suivrait les mêmes lois. Ce singulier-là est plus ou moins pris en compte par les nouveaux moyens de représentation de l’informatique contemporaine (cf. par exemple mon livre La modélisation critique Quae 2014). Il concerne les données et les conditions aux limites. Il pose de graves problèmes épistémologiques à cause de notre ignorance du contexte à tous les niveaux de la connaissance qui nous font trop souvent décider comme si nous savions ce que nous ignorons.
Mais il est un autre singulier plus fondamental qui est véritablement de nature interprétative. Ce sont les êtres-questions, les démons et divinités de notre temps avec lesquels il faut vivre comme des menaces ou comme des espoirs tant que leur « pouvoir » n’a pas été dissipé. Il y a là un vrai travail scientifique de réduction progressive des propriétés supposées de ces êtres afin de les cerner davantage jusqu’à peut-être, et peut-être seulement, montrer leur incohérence avec les savoirs dont nous disposons ou au contraire leur existence définitive (comme pour les atomes par exemple, dont souvenons-nous que Marcellin Berthelot, et Henry Le Chatelier niaient l’existence et avaient pour ces affabulations des sarcasmes méprisants). Je renvois à mon article « Sur la place du singulier dans la connaissance » revue Communications n°96, 2015.
Nous nous « cognons » à la finitude de la planète. Il faut en finir avec le slogan que les craintes sont hors du domaine scientifique. Là je rejoins la dimension interprétative de la connaissance défendue par nos auteurs. Elles sont en plein dans ce qu’on demande à l’intelligence, d’abord d’être mieux formulées, spécifiées par des représentations hypothétiques plus précises, puis mises à l’épreuve de l’empirisme autant que nos moyens nous permettent d’éprouver la consistance de leur propriétés.
• Isabelle Stengers Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences Les Empêcheurs de Penser en Rond / La Découverte, 2013.
L’ouvrage est pour l’essentiel un recueil d’articles retravaillés par l’auteure, ce qui s’aperçoit à quelques redites mais a aussi l’avantage d’une lecture tranquille chapitre par chapitre. L’édition comporte également une traduction d’un texte de William James « Le poulpe et le doctorant » traduit et commenté par Thierry Drumm dont nous ne parlons pas ici, nous réservant d’y revenir.
Disons d’emblée que les questions abordées par Isabelle Stengers dans cet essai sont d’une portée philosophique considérable et qu’elles mériteraient que l’on prenne un temps suffisant — c’est le cas de le dire — pour les soupeser, les discuter et les prolonger, dans une réponse à la hauteur des enjeux et avec des outils conceptuels adaptés. Mais je veux parler de ce livre tout de suite pour éveiller la curiosité des amis de l’épistémologie.
Le problème de l’éloignement des connaissances scientifiques par rapport au citoyen est une difficulté sérieuse de notre société qui ne saurait être réduite à la question d’une bonne vulgarisation. Isabelle Stengers en traite dans le premier chapitre en se plaçant volontiers dans le sillage de Jean-Marc Lévy-Leblond d’une part insistant sur « la mise en culture des savoirs », et de Bruno Latour d’autre part en reprenant l’idée de « matter of concern » introduite par celui-ci pour se substituer au slogan de « matter of fact » rabâché par les spécialistes. Pour le lecteur, je mentionne aussi l’article de Michel Callon « Les différentes formes de démocratie technique » (Responsabilité et Environnement 1998) qui prend place avantageusement dans cette discussion. Les choses ne sont pas simples si l’on garde à l’esprit que la science est socialement produite, qu’elle « n’est pas une instance immotivée » comme disait Maurice Merleau-Ponty, mais que par ailleurs les « connaisseurs » affichent pour la plupart une attitude positiviste où leur « liberté » est la garantie de l’objectivité et que les groupes concernés et les lobbies opposent arguments et contre-arguments pour faire osciller les politiques. Les OGM par exemple sont typiquement une illustration de « matter of concern » par les intérêts économiques liés à leur production, par les risques attachés à leurs effets sur l’environnement, par les discours qui les entourent où la science affirme sans dire ce qu’elle ne sait pas. Souvenons nous du paysage de la sociologie des sciences d’il y a une quinzaine d’année où Bruno Latour ayant dénoncé le grand partage moderne et la courte vue des chercheurs à nier l’encrage social de leur production de connaissance, les sciences studies s’étaient rapidement développées aux Etats-Unis, et nous étions arrivés à la fresque remarquablement dressée par Philippe Descola (Par-delà nature et culture, Gallimard 2005) où la fabrication de connaissance devenait une activité sociale, la lucidité devant être reconnue et non cachée. Cependant voilà, une page a été tournée avec les faiseurs de doute (cf les ouvrages de D. Michaels, Doubt is their product, Oxford Univ. Press 2008, et de N. Oreskes et E. M. Conway, Les marchands de doute, Pommier 2012) (note 1). Isabelle Stengers le souligne à juste titre, mais en laissant la question largement ouverte. Il me semble qu’on peut dire que Bruno Latour en s’adressant de façon incisive aux scientifiques pour les faire bouger — ce qui était porteur d’enjeux très intéressants au regard des problèmes environnementaux — a été pris dans une sorte de piège : les scientifiques n’ont pas écouté, irrités qu’ils étaient par les reproches qu’ils ont pris pour une superbe disciplinaire de la sociologie ou de l’anthropologie, le socio-centrisme, et en revanche des mercenaires compétents de grandes firmes ont élaboré des estompages généralisés de toutes les certitudes pour continuer à prendre des risques économiquement avantageux. C’est grave. Disons les choses de façon schématique : la sociologie des sciences apparaissait comme une construction bien adaptée au monde contemporain où la connaissance se fait avec des réseaux, capable d’apporter une critique solide au progrès technique et aveugle que les philosophes n’avaient pu dénoncer que dans des sphères très abstraites jusqu’alors. Mais aujourd’hui elle n’est pas loin de se trouver relayée au rang de recette de management pour les MBA. Alors que justement on a un besoin incontestablement de plus en plus impérieux de faire prendre en compte un certain nombre de faits (épuisement des ressources énergétiques fossiles, des réserves en certains métaux, rythme d’extinction des espèces, élévation de la température, etc.) dont l’ignorance a des conséquences sociales majeures. Ce sont certes des faits-valeurs mais leur dimension éthique est typiquement collective et n’est portée par aucun intérêt d’agent économique quel qu’il soit. Au contraire l’encrage social de la production de connaissance a la vertu de scotomiser complètement ces données. Dès lors on est face à un dilemme soit on considère que la méthode était néanmoins valable et qu’en effet toute connaissance est performative qu’il faut se faire une raison et on conforte le business as usual, ou bien on a oublié quelque chose, on est allé un peu trop vite, encore une question de vitesse…
Le second chapitre est attentif aux conséquences de la place des femmes dans la pensée et l’institution scientifique. La domination masculine dans monde de la recherche scientifique est un phénomène d’une ampleur considérable, et on se demande comment un esprit aussi aiguisé que Pierre Bourdieu ait pu passer à côté sans rien voir (cf La domination masculine Points 2002). Il y a beaucoup à dire sur ce registre et ce biais n’est évidemment pas sans conséquences sur la nature même de la connaissance élaborée. Je ne vais pas discuter l’approche qu’adopte Stengers ici, j’ai déjà un peu écrit à ce sujet (cf le dernier chapitre de La règle le compas et le divan et dans l’article Can there be an excessive mathematization of the world ? in Seminar on Stochastic Analysis Dalang, Dozzi, Russo eds, Birkhaüser 2013) et j’ai l’intention de mettre mes vues sur le papier que je ne peux esquisser ici. Je souligne seulement combien Isabelle Stengers voit juste lorsqu’elle pointe certaines conséquences de l’économie de la connaissance à la fois destructrice d’une image moderne classique de la science et du confort qu’avaient les chercheurs à réclamer la plus grande liberté grâce à l’argument que l’ensemencement de leurs idées peut germer dans plusieurs décennies ou siècles. Les diagnostics qu’elle porte sur la docilité des chercheurs sont convaincants, l’expérience de la vie dans les laboratoires de recherche me confirme qu’il y a, en effet, comme la quête d’une compensation virile recherchée auprès de la société par les chercheurs qui doivent courber l’échine devant la discipline maintenant tenue par les forces économiques. Ce chapitre me donne aussi le sentiment qu’il est dommage qu’Isabelle Stengers se soit montée contre la psychanalyse car celle-ci lui aurait donné ici des outils bien intéressants.
« Science et valeurs : comment ralentir ? » est le titre du troisième chapitre qui semble avoir été rédigé spécialement pour ce livre et qui, en effet, donne une large portée à tout l’ouvrage. Je ne peut tout commenter ici, les pages 51 à 54 sont absolument savoureuses de justesse. La situation actuelle de la recherche y est décrite avec un courage lucide qui conduit Isabelle Stengers au programme suivant : « je voudrais plaider pour un ralentissement des sciences qui ne soit pas un retour à un passé quelque peu idéalisé, où les chercheurs honnêtes et méritants étaient justement reconnus par leur pairs. Ce ralentissement devrait impliquer une prise de compte active de la pluralité des sciences, à laquelle devrait répondre une définition plurale, négociée et pragmatique (elle-même évaluée à partir de ses effets) des modes d’évaluation et de valorisation des différents types de recherche. » Le modèle de la science rapide a été mis au point dans les sciences de la nature, physique, chimie, etc. Il est certain que l’évaluation y met rarement en jeu des questions de principe ou de doctrine mais correspond le plus souvent « à la vérification de ce qui préoccupe tous les compétents — l’extension du champ de la réussite ». Pour abonder dans ce sens je citerai l’aventure extraordinaire de la notion de copule en statistique. Il s’agit d’une idée très simple qui généralise la notion de corrélation en s’affranchissant de l’échelle des axes de coordonnées. Dès son apparition elle fut reprise par d’autres articles dont la seule originalité était de s’en servir. Il faut publier. On vit apparaître des copules pour l’étude de la circulation du sang, pour le dénombrement des pigeons en ville, etc. le terme fit florès dans les colloques au grand dam de ceux qui ne le connaissaient pas encore. Les citations du terme atteignirent des sommets, parce que c’était « une extension du champ de la réussite » l’apport épistémique étant très faible et même souvent contestable. (note 2)
Il y a une sorte de déséquilibre quant au rôle que prennent les diverses disciplines au détriment des sciences sociales. Il convient de « faire exister la pluralité des sciences contre l’unicité de la science« . Isabelle Stengers introduit la notion de sciences « camérales » non au sens de celles qui étudieraient l’Etat, mais qui seraient définies comme servantes de l’Etat « dans son rôle de gardien de l’ordre et de la prospérité publique ». Pour que les sciences sociales pèsent dans le jeu de la fabrication de la science elles ont besoin de temps. Il y a une question de rythme. Ces sujets sont tout en nuance et on pourrait avoir l’impression d’une approche durkheimienne assez positiviste où la sociologie fait du bien comme la médecine améliore la santé, mais non, « les sciences sociales ne seront jamais l’amie de l’Etat, leurs réussites sont au contraire vouées à lui compliquer la vie, mais la manière dont l’Etat attend et anticipe, ou au contraire subit et au mieux tolère, cette complication est une mesure de l’effectivité de sa relation avec ce qu’on appelle la démocratie ». Le travail d’Elinor Ostrom est cité pour ce type d’apport des sciences sociales. L’exemple est tout à fait pertinent comme prise en compte de considérations extérieures à la seule « rationalité » économique pour aborder l’économie. Pour tenter de résumer la thèse centrale je dirais que ralentir, aller plus lentement est la condition pour que la nouveauté ait donné le temps à son effet sur le social et pas seulement sur les pairs, d’où une ouverture où le citoyen, la démocratie, le politique peut trouver place.
Dans le feu de son style plein de relief je relève ce passage éclatant : « L’individu démocratique, celui qui dit ‘j’ai bien le droit…’, est celui qui s’enorgueillit d’une ‘autonomie’ qui, en fait, renvoie à l’Etat la charge d’avoir à ‘penser’ les conséquences. Etrange liberté que celle de ne pas avoir à penser. Quant au capitalisme, il a libre cours dans un monde disponible à des redéfinitions qui, toutes, verrouillent notre dépendance à des modes de production supposant et entraînant, à la manière des enclosures, un processus ‘progressif’ de destruction de toute possibilité d’intelligence collective — ce que les institutions de recherche, après tant d’autres, découvrent aujourd’hui. »
Je crois en avoir assez dit pour faire sentir au lecteur le champ de préoccupation de cet essai et donner envie de s’y plonger. Les deux derniers chapitres sont riches d’arguments supplémentaires dans un style toujours épicé (notamment le rôle des « diplomates » que I. S. avait déjà introduit dans Les atmosphères de la politique, dialogue pour un monde commun, Latour B., Gagliardi P., Les empêcheurs de penser en rond 2006). J’ai particulièrement apprécié l’épinglage de Pascal Lamy et les remarques de la page 118 sur le capitalisme d’aujourd’hui.
Pour finalement situer les thèses de cet essai par rapport aux idées développées dans ce blog, je dirais qu’elles en sont très proches pour ce qu’elles dénoncent. Mais un peu plus éloignées sur les voies qu’elles tracent. A mon avis une place insuffisante est faite à l’interprétation dans la fabrication de connaissance, qui est source de pluralisme au sein même des disciplines et qui devient essentielle pour déceler des éventuels, des futurs possibles, en préparation, joyeux ou tristes. (cf « Le pluralisme est l’état instantané permanent de la connaissance scientifique »).
Note 1. La « révolution » que représente les constructions de doute ne porte pas uniquement sur la consistance de la connaissance scientifique mais aussi sur celle du droit. Par un souci historique légitime nos textes juridiques sont pour la plupart rédigé de sorte que le citoyen moyen puisse les comprendre donc avec des termes qui font appel au « bon sens » tel que « risque important » etc. Par exemple le Conseil d’Etat (28-11-2011) (après consultation de la Cours de Justice de l’UE) considérant que l’existence d’une situation susceptible de présenter un « risque important » n’était pas « prouvée » a annulé le décret du 7-2-2008 interdisant l’OGM Monsanto810 puis encore celui du 16-3-2012. Un nouvel arrêté vient d’être voté par l’Assemblée le 15-3-2014 quelle sera sa durée de vie ?
retour à la recension de l’ouvrage d’Isabelle Stengers
Note 2. L’idée d’isabelle Stengers que la science va trop vite touche également un problème très juste et fondamental. Elle va trop vite pour que les femmes des pays sous-développés et aussi des pays en développement y trouvent des modifications des valeurs dans lesquelles elles s’épanouissent par la famille selon des usages ancestraux transmis efficacement par les soins et l’amour. Ce ne sont pas les nanotechnologies en tant que telles qui les modifieront mais des relais sociaux par nature très lents.
retour à la recension de l’ouvrage d’Isabelle Stengers
• Christopher Reich, Compte numéroté, trad. B. Cohen, Albin Michel 1998.
Il s’agit d’un roman policier, mais qui dépasse le divertissement, il fait partie de ces nouveaux polars qui ont une vraie fonction politique. Evocateur d’un milieu social mal connu, révélateur d’institutions et d’agissements cachés.
Le meurtre permet d’évoquer la face sombre de nos sociétés, des sujets qui ne sont pas politiquement corrects. Il est le prétexte qui révèle ce que la société veut cacher d’elle-même. Chaque société a ses cadavres dans le placard. C’est une façon intéressante de comprendre les autres cultures, leur spécificité mais aussi ce qui nous unit tous comme êtres humains — l’amour, la soif du pouvoir et de richesse, la haine, la vengeance, l’amitié… Citons quelques auteurs dans cette veine: les scandinaves Arnaldur Indridason, Leif Davidsen, Henning Mankell, les italiens Donna Leon, Monaldi et Sorti, en espagnol Eduardo Mendoza, Mathilde Ascensi, ainsi que Yasmina Khadra au Maghreb et l’Américano-chinois Qiu Xiaolong, (Cyber China) etc.
Ici Christopher Reich par l’artifice habile du romancier suggère avec une justesse remarquable, dès 1998, un univers de pratiques qui s’est trouvé absolument confirmé par la suite, où l’UBS, Union des Banques Suisses forme l’essentiel du décor. Les agissements de l’UBS furent mise en pleine lumière par la suite avec l’ouverture d’une enquête par la banque central de Hong Kong sur une manipulation par l’UBS du taux interbancaire le Hibor, des soupçons de blanchiment d’argent de trafic d’armes, la pression Américaine contre le secret qui protège l’évasion fiscale, les scandales à répétition en France à propos de dissimulation de patrimoine, l’affaire Cahuzac, etc.
Pour ce qui est de ce livre, il s’agit d’un polar, ça ne se raconte pas… mais la grande question qu’il soulève, celle du secret, reste un problème délicat, très ancien et aussi très actuel. La Suisse s’est octroyé un avantage économique considérable à accueillir les fonds de toute origine — donc aussi les profits crapuleux — en osant afficher à la face du monde le principe du secret bancaire comme on affiche les droits de l’homme et du citoyen. Le gouvernement confédéral trouve dans ce système une bonne part de ses ressources allégeant d’autant les impôts des habitants qui cautionnent donc indirectement ces agissements.
La religion aussi a ses secrets, elle instaure une certaine forme de pouvoir, que Michel Foucault étudia dans le monde occidental sous le terme de pouvoir pastoral. Elle a toujours appuyé la position du clergé sur certains savoirs spécifiques ignorés des fidèles. Mystères, ésotérisme, cabbale, elle est détentrice de secrets et de savoirs non disponibles. Dans le monde antique aussi bien, seuls les prêtres de Delphes ont accès à ce que veulent les Dieux et l’Oracle ne parle que par énigmes.
Avec les Chrétiens de l’époque romaine, apparaît, en plus de la confraternité de l’appartenance à une communauté de croyance et d’idéaux de vie, l’idée de la transparence des agissements humains aux yeux de Dieu qui prendra plus tard les modalités de la confession et de la direction de conscience. Mais la sanction des tricheries et malveillances commises ici bas n’interviendront que dans l’autre monde, de sorte que cette régulation sociale nécessite un rappel sévère et permanent du risque infernal, comme en attestent encore les tympans de nos églises et les pratiques spectaculaires de l’inquisition . Il existe une sorte de surveillance permanente et supérieure, qui prend une forme différente dans le système des castes et de la métempsychose en Inde mais accomplit aussi, ou tente d’accomplir, une régulation stable et efficace du vivre ensemble.
Le libéralisme comme régime social au dessus des croyances éventuellement dissimulées
La découverte audacieuse du 18ème siècle fut d’avoir compris que dès lors que la prospérité était une chose favorable à tous — que Dieu ne pouvait réprouver puisqu’il nous avait conçus comme des êtres qui la désirent et capables de la réaliser, argument évidemment dans le fil du protestantisme — laisser les paysans, les commerçants et les manufactures tenter de tirer le meilleur prix des biens qu’ils ont produits dans le jeu de la libre demande, dispensait d’avoir à vérifier que les bons usages et l’état de l’art étaient appliqués, pour la raison que le marché se chargeait de sanctionner les résultats.
Dans le sillage d’Adam Smith et de Jeremy Bentham, l’utilitarisme se constitua en théorie sous la plume de John Stuart Mill : il y a assez de vérité pour agir, et la vérité suffisante est donnée par le jeu de la critique au sein de la diversité des opinions. Système qui plaide donc clairement pour la liberté des échanges et de l’expression des idées, et qui renforcera ses bases philosophiques avec la formulation du pragmatisme au tournant des 19ème et 20ème siècles (Charles Peirce, John Dewey, William James) allant jusqu’à postuler que les possibilités d’action du sujet sont la seule réalité.
Si pour le marché les choses semblent claires, pour le crédit en revanche la supervision divine reste importante comme l’a souligné Max Weber dans sa célèbre interprétation de la naissance du capitalisme où il rapporte des Etats-Unis le souvenir personnel de cette réplique « Monsieur, pour ma part, tout le monde peut croire ou ne pas croire ce qu’il veut, mais si je voyais un agriculteur ou un homme d’affaires qui n’appartienne pas à aucune église que ce soit, je ne voudrais pas lui faire confiance avec cinquante cents. Pourquoi me payer, s’il ne croit pas en quelque chose? »[1]. Il y a une relation de confiance dans le prêt ou la dissimulation peut-être dangereuse.
Il nous reste de cette période les discours un peu convenus sur le caractère amoral du capitalisme que l’on trouve dans les manuels d’économie.
A la limite, si le marché règle automatiquement et de façon optimale les comportements, on n’a plus besoin de Dieu, ni même de gouvernement. Jean-Baptiste Say, disciple de Smith, le pense explicitement « Avons-nous trouvé le gouvernement de la société dans tout cela ? Non. Et la raison en est que le gouvernement n’est point une partie essentielle de l’organisation sociale. Remarquez bien que je ne dis pas que le gouvernement est inutile; je dis qu’il n’est pas essentiel; que la société peut exister sans lui; et que si les associés voulaient bien faire leurs affaires et me laisser faire la mienne, la société pourrait à la rigueur marcher sans gouvernement. » [2]
Si nous entendons gouvernement au sens que lui donne Foucault : « l’ensemble des institutions et pratiques à travers lesquelles on guide les hommes depuis l’administration jusqu’à l’éducation » on mesure combien la thèse de Say est naïve ne serait-ce que par les attitudes d’entente et de coalition où précisément une partie des motifs sont dissimulés.
L’expression de savoirs locaux
Cette difficulté fut très rapidement reconnue et conduisit aux lois anti-trust de 1890 et de 1914. On arrivait à l’idée qu’exceptées les positions de quasi-monopole, les coalitions secrètes, le marché concurrentiel fournissait des prix qui étaient les informations suffisantes pour les agents économiques, et en particulier les dirigeants d’entreprise afin de prendre les meilleures décisions devant les changements et les évolutions sans qu’aucune connaissance globale ne soit disponible à quiconque. C’est la remarquable théorisation de Hayek de la construction d’un « ordre économique rationnel »[3].
Mais on est là sur le bord tranchant des limites des possibilités de la doctrine du marché de libre échange, à cause… du saut qu’il y a entre ce que sait un agent et ce qu’il est possible de prouver qu’il sait, comme cela se pose toujours dans les délits d’initiés. Les connaissances partagées par les professionnels et les scientifiques, les réseaux d’acteurs biaisent le jeu de l’offre et de la demande, le système a besoin de gouvernance, et son fonctionnement serein en toute amoralité malgré les immoralités est mis à mal.
Le libéralisme économique comme gouvernement sans responsabilité
De tous temps le gouvernement, « guidage des hommes les uns par les autres », tombe sur la question dirimante des représailles. Il faut éviter aux décideurs les ennuis que les mécontents des changements ne manqueront pas de provoquer. Le roi de droit divin a une garantie à cet égard. Le système de la démocratie représentative a cette vertu que l’élu a un mandat, trace d’une préférence vis-à-vis d’autres candidats, base d’une confiance jusqu’aux prochaines élections. Le tirage au hasard, comme celui des magistrats dans l’Antiquité, ne donne pas cette liberté d’agir car les désignés par le sort ne peuvent que se fonder sur leur propre jugement et sont totalement vulnérables dans leur individualité[4].
Mais le capitalisme a trouvé des mécanismes d’échappement, comme on dit en horlogerie, qu’il a institutionnalisés d’une façon efficace et mondiale dans la période néolibérale des années 1980 à nos jours, qui constituent un véritable système de gouvernement auquel d’ailleurs les Etats se plient maintenant autant que les entreprises. Il est fondé d’abord sur la primauté données aux actionnaires qui apportent leurs moyens financiers sans jamais pâtir des aventures des entreprises qu’ils financent si ce n’est justement financièrement. Lorsque des médicaments s’avèrent dangereux, lorsque des dégâts environnementaux résultent de risques pris par les dirigeants, lorsque des manufactures sous-traitantes sont prises à faire travailler des enfants, etc. l’actionnaire reste pur comme un ange. Mais surtout le système du crédit avec l’instauration du marché mondial des créances par la titrisation fait que les déposants dans les banques ne sont pas responsables de ce qui est fait de leur argent. Les créances sont mises sur le marché du crédit où seul le taux d’intérêt sera visible comme paramètre de risque. Qui prête ainsi à la Grèce ou à l’Espagne à des taux usuraires, on ne sait pas, les dépôts sont groupés en paquets complexes mélangés de produits à terme dérivés et de collatéraux.
Ces deux mécanismes d’échappement sous cette forme, sinon de secret, du moins de discrétion garantie à l’actionnaire et à l’épargnant, expliquent la schizophrénie ordinaire du citoyen contemporain. Il veut sauver la planète mais cautionne par ses économies un système orienté exclusivement vers le profit privé.[5]
Il s’agit bien d’un « gouvernement » qui permet d’agir sans représailles d’une façon extrêmement efficace mais dans une seule direction, celle de l’intérêt individuel. Les Etats sont pris dans ce système, et la démocratie représentative ne crée plus un échappement suffisant pour prendre des résolutions vers des objectifs de défense des intérêts collectifs. Ils sont soumis au marché des créances qui dissimulent l’origine des « états d’âme » des marchés.
Un regard historique montre clairement que les enjeux de la planète dépassent les objectifs que le libéralisme s’était assignés dans ses racines et qu’il a perfectionnés. Le gouvernement mondial ne se pose pas en termes de pouvoir au sens ordinaire. Ce qu’il faut c’est trouver un mécanisme d’échappement qui permette de constituer une immunité aux défenseurs de l’environnement — c’est-à-dire à tout un chacun — que le secret des comportements puisse aussi profiter à la préservation des biens communs. Cela veut dire
– aider et officialiser les faiseurs de diagnostics : fabrication de connaissance de la plus haute importance,
– pénaliser les entreprises qui n’en tiennent pas compte, encourager celles qui intègrent ces indicateurs dans leurs objectifs,
– supprimer l’anonymat des actionnaires et des déposants, qui est le dispositif clé à l’origine des prises de risques permanentes sur les richesses collectives dont nous disposons encore.
Le citoyen a droit à une réserve de secret. Avec l’affaire des écoutes américaines, on a forcément Big Brother à l’esprit[6]. Les droits de l’homme sont des limites que l’on oppose à tous les gouvernements possibles. Dans ces droits il y a fondamentalement la possibilité d’un agir selon des idées, des valeurs choisies, et qui doivent être respectées sans qu’il soit besoin de les révéler.
La question concrète est la suivante : ce qu’on fait de son patrimoine mobilier est-ce que cela doit faire partie, aujourd’hui encore, de ce domaine non révélé ?
[1] Max Weber, The Protestant Sects and the Spirit of Capitalism 1904-1905.
[2] Say J.-B., Cours à l’Athénée (1819).
[3] F. A. Hayek « The Use of Knowledge in Society » The Amer. Economic Revue, Vol XXXV, n°4, sept 1945.
[4] B. Manin Principes du gouvernement représentatif, Flammarion 1996.
[5] Cf. N. B. « Un, deux, trois, soleil », Esprit déc 2009, p85-104.
[6] Avec seulement 30 ans de retard par rapport au 1984 d’Orwell.
