• Martin Hirsch Les solastalgiques, Stock 2023.
• Gérard Araud Nous étions seuls, Une histoire diplomatique de la France 1919-1939, Tallandier 2023.
• Pierre Brémaud Pythagore en Inde, l’aube des mathématiques Cassini 2021
• Laurent Chauvaud La coquille saint-jacques sentinelle de l’océan Equateurs 2019
• Costa Gavras « Adults in the room »
• Stéphane Foucart, Des Marchés et des Dieux, comment l’économie devint religion, Grasset 2018.
• Delphine Batho, Ecologie intégrale, le manifeste, postface de Dominique Bourg, éd. du Rocher 2019.
• Antoine Costa, La nature comme marchandise, une série d’entretiens, Le monde à l’envers 2018.
• Muriel Fabre-Magnan L’institution de la liberté, PUF 2018
• Francis Magnard, Vie et aventures d’un positiviste, Librairie illustrée Paris, (1875).
• Sophie Kovalewsky Souvenirs d’enfance, suivis de Biographie par Anne-Charlotte Leffler, Préface et notes de Michèle Audin Spartacus-idh, 2017
• Hiroshi Sugita Probability and random numbers, World Scientific, 2018.
• Ivar Ekeland Le syndrome de la grenouille, l’économie du climat, O. Jacob 2015.
• Krzysztof Burdzy Resonance, From Probability to Epistemology and Back, Imperial College Press 2016.
• Ernest Renan L’islam et la science (1883), Berg International 2016.
• Edouard Tétreau, Au-delà du mur de l’argent , Stock 2015, 194p.
• Grégoire Souchay, Marc Laimé, Sivens, le barrage de trop, préface d’Hervé Kempf. Seuil 2015, 135p.
• Kilani M., L’universalisme américain et les banlieues de l’humanité, Payot Lausanne 2002.
• B. Latour et P. Gagliardi (ss la dir. de) Les atmosphères de la politique, dialogue pour un monde commun, Les empêcheurs de penser en rond, 2006.
Les événements de janvier 2015 remettent à l’actualité cet ouvrage qui tentait de penser le débat entre Weltanschauungen incompatibles.
• Marc Angenot Les grands récits militants des XIXe et XXe siècles, Religions de l’humanité et sciences de l’histoire, L’Harmattan, 2000.
• Miguel Benasayag et Pierre-Henri Gouyon Fabriquer le vivant ? La Découverte, 2012.
• Michel Serres Petite Poucette Le Pommier 2012.
• Hubert Reeves Là où croît le péril… croît aussi ce qui sauve, Seuil 2013.
• Stephen Emmott 10 Billion, Penguin books 2013.
• Roland Dumas Dans l’œil du Minotaure, le labyrinthe de mes vies, Le cherche midi 2013
• Présentation et commentaire par Bernard Perret des deux ouvrages suivants
Dominique Méda – La mystique de la croissance, Flammarion, 2013
Juliet B. Schor – La véritable richesse, Editions Charles Leopold Meyer, 2013 (True Wealth, Penguin Books 2010)
• Laurent Davezies, La crise qui vient, la nouvelle fracture territoriale, Seuil 2013.
• Gilles Raveaud La dispute des économistes, Le Bord de l’Eau 2013.
• L’économie verte en trente questions, Coordination Philippe Frémeaux, Alternatives Economiques 2013.
• Reinhard Illner, To the Class of 2030: A Letter and Apology, Kindle edition 2013
• Albert Jacquard et Hélène Amblard, Réinventons l’humanité, Postface de Serge Latouche, Sang de la Terre, 2013.
• Bernard Perret, Pour une raison écologique, Flammarion 2011.
• Gaël Giraud, Illusion financière, Coll. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire, Les éditions de l’atelier 2012.
• Jean-Baptiste Poulle Réflexions sur le droit souple et le gouvernement d’entreprise, Le principe « se conformer ou expliquer » en droit boursier. L’Harmattan 2011.
• Philippe Derudder et André-Jacques Holbecq Une monnaie complémentaire, Pour relever les défis humains et écologiques Editions Yves Michel, 2011.
• Fred Hirsch, Social Limits to Growth, Harward Univ Press 1976.
• Michel Serres Genèse, Grasset 1982.
• Martin Hirsch, Les Solastalgiques Stock 2023.
Je n’ai pas accroché. Le mode romanesque ne me semble pas adapté au thème de la fin du monde par le changement climatique. Ça fait baladin, récit fabriqué.
Cela m’a remémoré une soirée à la FNH (à l’époque Fondation Nicolas Hulot, maintenant Fondation pour la Nature et l’Homme) où nous avait été présentés les travaux des laboratoires pour le rapport suivant du GIEC et où nous avions pu apprécier le soin du partage entre ce qui est sûr et ce qui est à préciser. Il en résultait une impression fondamentalement grave.
En repartant vers le métro je me trouvai en compagnie d’un homme jeune dans la trentaine et je le félicitai de s’intéresser à ces questions «qui seront votre avenir vous les jeunes». Il acquiesça. Je lui demandai «vous êtes chercheur dans un labo sur l’environnement ?» Il répondit «non je fais des jeux vidéos pour des play-stations sur Internet et ce genre de réunion me donne des idées pour le réalisme contextuel»…
Souvenons-nous qu’immédiatement après la sortie du film «Le syndrome du Titanic» qui se voulait une mise en garde du grand public sur les conséquences mondiales et sociales du changement climatique, sont sortis plusieurs films d’épouvante où des cités entières étaient recouvertes par la montée violente des océans.
Martin Hirsch devient voltigeur sur le cheval des causes graves. Cela ressemble un peu aux casseurs qui, ce faisant, cassent les manifs. Il faut être simple redescendre sur terre.
Je rappelle trois faits d’actualité de ce début juillet 2023
– le 5 juillet La commission européenne a adopté un texte ouvrant à la voie à la mise sur le marché de variétés issues de Nouvelles techniques génomiques (NGT en anglais) en distinguant deux catégories, dont l’une dérogerait à la législation OGM en vigueur (mutagenèse). Les propositions doivent être examinées par le Parlement européen et le Conseil de l’UE.
– le 6 juillet l’EFSA Autorité européenne de sécurité des aliments ne s’oppose pas au renouvellement de l’autorisation du Glyphosate. On repart comme il y a plus de 50 ans avec le DDT
– le 10 juillet le PDG de Total Energies et le ministre du pétrole irakien ont signé à Bagdad un méga contrat de partage de production de 10 milliards de dollars.
• Gérard Araud, Nous étions seuls Tallandier 2023.
Je recommande la lecture de cet ouvrage remarquable, passionnant, sur une periode sombre de l’histoire de France souvent racontée de façon sommaire. L’entre-deux-guerres est complexe et ce sujet ô combien grave méritait un récit approfondi fondé sur les rôles des diplomates comme traducteurs des intentions des gouvernants souvent orientés différemment des états majors. Extrêmement documenté le livre est riche de citations révélatrices des mentalités, des hésitations et des aprioris de personnages dont la réputation fabriquée superficiellement est à relativiser. C’est ainsi que l’économiste John Meynard Keynes apparait moins lucide que l’image courante qu’on en a. C’est l’inverse notamment pour Briand, Barthou, Bainville qui comprirent le danger mieux que beaucoup d’autres. La réalité économique sous-jacente est bien rendue avec pour les diverses nations européennes des périodes d’essor rapide interrompues par les conséquences de la crise de 1929. La France a pâti d’une image fausse auprès de l’opinion britannique : la victoire de Verdun n’en faisait pas une nation forte elle était ravagée à l’Est et sa population était nettement moindre que celle de l’Allemagne qui n’avait pas eu la guerre sur son territoire. Incontestablement Hitler a longtemps été vu, par Chamberlain et d’autres partisans de la paix, comme on souhaitait qu’il fût et non pour ce qu’il était. Les personnages de Staline et de Mussolini sont dépeints avec précision.
Le choix des citations qui se répondent est très vivant, souvent les prises de position des uns et des autres sont stupéfiantes. L’Anschluss puis la nuit de cristal n’avaient pas ouvert les yeux et il faut attendre septembre 39 et l’effondrement de la France envahie pour que la réalité apparaisse à l’échelle mondiale.
J’ajouterai pour les lecteurs de mon âge que ce livre m’a fait voir combien mes parents qui ont vécu cette période étaient mal renseignés. Leurs récits durant ma jeunesse étaient allusifs et incomplets, ce livre fait réfléchir en politique sur ce qu’on sait et sur ce qu’on croit savoir.
•
Hélène Tordjman, La croissance verte contre nature, Critique de l’économie marchande, La découverte 2021.
L’OCDE met en exergue sur son site la définition suivante de la croissance verte : « favoriser la croissance économique et le développement, tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux sur lesquels repose notre bien-être ». Toute la question est de savoir si cela n’est pas un vœu pieux, et donc de penser les conséquences de cet affichage. En fait Hélène Tordjman prend « croissance verte » en un sens un peu plus général, proche de développement durable, ce qui donne à son analyse une plus large portée, véritable critique de la vision englobante de la planète par l’économie libérale.
S’appuyant sur de nombreux exemples symptomatiques des tendances récentes, elle évoque les traits typiques du capitalisme qui se dessine, en montrant que les stratégies du nouveau management tirent parti de la prise de conscience environnementale pour conquérir de nouveaux marchés. Le cadre général est donné par les NBIC et la bioéconomie c’est à dire l’articulation des techniques nouvelles de la biologie avec les nanotechnologies grâce à l’intelligence artificielle et les sciences cognitives, avec l’aide de l’informatique de puissance et les big data. Il a été ainsi installé une perspective triomphaliste sur laquelle peut s’appuyer la promotion d’innovations techniques toujours plus décalées par rapport aux exigences de l’environnement.
L’auteure examine ensuite le cas des agrocarburants qui fut présenté comme la solution miracle pour palier l’épuisement des ressources énergétiques fossiles. Elle montre le conflit de ces surfaces cultivées avec le maintien d’une agriculture locale pour les besoins alimentaires locaux. En matière d’alimentation, le grand public n’a pas conscience de la main mise des grandes firmes internationales sur les semences, grâce à une accumulation de brevets de toute sorte sur le vivant. Celles-ci profitent de règles juridiques très strictes protégeant par brevets les semences aux vertus « augmentées » mais très faibles en ce qui concerne la protection de la nature.
Plus généralement Hélène Tordjman revient sur la question des services écosystémiques et de la vision de l’environnement comme capital naturel. Cette mentalité d’englober la nature dans la pensée économique a la vie dure. [cf. sur ce blog combien coûte la nature ? ] Ce chapitre réactualise la question à juste titre, car cette « rationalité » semble s’infiltrer, comme l’encre dans le buvard, dans toutes les instances internationales même celles qui s’affichent en faveur de la planète et de la biodiversité. C’est lié aux tentatives récentes de « verdissement » des marchés financiers ainsi qu’à la politique européenne du Green Deal destiné à orienter les investissements vers la transition écologique sans modifier les instruments financiers eux-mêmes, obligations vertes, (voir A. Grandjean et J. Lefournier, L’illusion de la finance verte, L’Atelier 2021), ainsi que les produits dérivés autrement dit les marchés sur les produits à terme au-dessus des grandeurs économiques classiques, comme c’est en cours de mise en place avec les marchés de compensation [cf. sur ce blog La transition ].
L’ouvrage est écrit dans un style plaisant, dynamique et direct, qui va rapidement aux problèmes. Il est salutaire comme base solide pour les discussions qui nourrissent les choix politiques aujourd’hui. Car le gouvernement actuel semble jouer la gouvernabilité au second degré. Dès lors que pratiquement une large proportion de la population et des décideurs économiques reste attachée, crispée, sur la croissance, le gouvernement utilise le vocable d' »engagements pour la croissance verte » pour encourager certaines opérations de recyclage et de valorisation des déchets. Utilise-t-il habilement l’opinion pour la bonne cause, ou bien contribue-t-il à propager cette idéologie clairement pilotée par le profit ? A voir…
• Pythagore en Inde, l’aube des mathématiques
L’esprit de notre époque nous enjoint avec insistance d’adopter certains goûts culturels. Cette littérature complaisante me tombe des mains. Mais il me semble qu’émerge en ce moment une nouvelle forme de littérature qui ne porte pas encore de nom : des récits qui ne requièrent aucune adhésion à quelque idéologie ni système socio-économique que ce soit, et qui nous donnent l’impression qu’ils garderont toute leur valeur encore dans cent ans, deux cents ans…
Deux exemples.
Pythagore en Inde de Pierre Brémaud. Passionnant, dans un style clair, simple, mais précis où l’on reconnaît l’art du professeur expérimenté, ce mathématicien nous emmène à l’époque de l’Empire achéménide où la géométrie, de l’Inde à la Grèce, était naissante. Que de questions naturelles se posaient alors que la science n’avait pas les lourdeurs spécialisées d’aujourd’hui, questions qui ont fécondé notre culture comme les rapports harmoniques par exemple qui seront repris à la Renaissance par Alberti et Pierro della Francesca. La grande érudition de l’auteur nous fait connaître nombre de personnages mi-savants mi-artistes, et philosophes qui se sont engagés dans certaines énigmes de la connaissance. Merci pour ce moment de lecture paisible et motivante.
La coquille saint-jacques de Laurent Chauvaud. C’est une histoire qui commence il y a bien plus longtemps, celle d’un coquillage, mais qui nous est contée par le récit de la découverte de l’importance de ce bivalve pour suivre les péripéties des fonds côtiers. L’auteur est lui-même acteur dans cette investigation et nous intéresse par ce qu’il nous révèle et par ses propres interrogations, déceptions, chances, dans cette enquête. Conservez donc ces coquilles si vous en dégustez, vous pourrez y lire les événements qui se sont déroulés comme on lit l’histoire du climat dans les cernes des arbres.
Je recommande ce film pour plusieurs raisons, surtout le jeu des acteurs. Gavras les a choisi la plupart ressemblants aux personnages réels, et l’usage du grec, de l’anglais, du français et de l’allemand suivant les circonstances contribue à immerger ces scènes stressantes dans la réalité. On ne s’appesantit pas sur les origines de la dette grecque et le rôle des conseillers de Goldman-Sachs ni sur la détresse du peuple grec au quotidien, ni sur l’achat du port du Pirée par les Chinois. Aucune vue sur la misère des gens réduits a la mendicité dans les rues d’Athènes. Gavras ne dépeint pas le chômage ni la rupture de l’approvisionnement en eau douce dans les iles. Il y a unité d’action. Sur le problème économique le film est plus simple et plus direct que les livres de Yanis Varoufakis il les complète bien.
• Des Marchés et des Dieux, comment l’économie devint religion, Stéphane Foucart, Grasset 2018.
Il y a plusieurs façons de montrer la faiblesse de certaines idées. La plus classique, favorite des universitaires, est de critiquer les auteurs qui en étaient les mentors. On leur trouve toujours des faiblesses, et de toute façon ils parlaient pour leur temps qui est révolu, la page est tournée. Cette sorte de critique reste malheureusement abstraite comme si la conviction reposait exclusivement sur l’argumentation logique. A la limite on arrive à la philosophie analytique américaine qui n’a jamais persuadé que ceux qui étaient déjà convaincus. Il y a une raison à cela que j’ai appelée le préjugé de supériorité analytique (cf. Penser l’éventuel QUAE 2017 p. 47 et seq) qui tient à ce que la structure de la logique, la logique classique d’Aristote, est intrinsèquement beaucoup trop exclusive pour s’occuper d’interprétations. Parmi les règles qu’elle impose se trouve ex falso sequitur quodlibet de sorte que les théories que l’on récuse sont forcément « n’importe quoi » on ne leur accorde même pas d’avoir une charpente qui tient en elle-même, On ne peut y penser deux théories, deux interprétations non encore départagées ou complémentaires.
L’autre façon de prendre les choses est de nourrir toutes les controverses de faits concrets perceptibles dans la vie d’aujourd’hui. C’est ce que fait admirablement Stéphane Foucart à propos de l’idéologie du marché. En l’abordant par une multitude d’aspects différents il la dissout, la décompose, de sorte qu’il n’en reste qu’une croyance, une foi religieuse, elle devient religion. Cependant pas n’importe quelle religion. Il forge le terme d’agorathéisme pour souligner sa ressemblance avec la religion romaine intimement fondue dans la structure politique de l’Empire.
Je ne veux pas ici évoquer le cheminement du livre. Evidemment on a vite vu où l’auteur veut nous conduire : les marchés sont de nouveaux Dieux, on attend leurs oracles etc. On a compris dès le premier chapitre où il nous fait remarquer combien le Palais Brongniart ressemble à un temple grec ou à l’église de la Madeleine. Mais justement, la façon qu’il a de nous servir ce à quoi on s’attend dans les grandes lignes est tout à fait savoureuse. Du coup le livre est vraiment plaisant à lire. Une réussite talentueuse émaillée de belles trouvailles de style.
Et on apprend beaucoup d’exemples significatifs, le tour d’horizon est très complet, jusqu’à la critique détaillée du culte du PIB, les réactions des économistes lorsqu’est paru le rapport du Club de Rome, etc.
L’ouvrage a quelque chose de Voltaire, ou encore de Beaumarchais, je crois qu’il contribue à faire de la place pour des idées nouvelles dont nous avons besoin aujourd’hui.
• Ecologie intégrale, le manifeste, Delphine Batho, postface de Dominique Bourg, éd. du Rocher 2019.
Ouvrage sérieux et courageux. Une de ses caractéristiques est de renouveler complètement les fondements du « besoin d’Etat ». Argumentation qui vient à point nommé quand on est en train de déliter le service public après avoir « fluidifié » le droit du travail.
Le style de l’ouvrage est sans ambages. Les faits réels sont décapés de leurs enrobages trompeurs (comme ce mensonge répété que la pauvreté diminue dans le monde sur la base de chiffres déconnectés de la vie réelle dans les pays pauvres). C’est un manifeste. Sur la politique de droite et de gauche, et sur le libéralisme économique implicite, il met les pieds dans le plat en s’appuyant sur l’urgence prioritaire donnée à la planète : un ton tranché qui dénonce l’inaction flagrante sur le climat, la pollution, la biodiversité. Je n’entre pas ici dans la description des propositions, elles sont claires et bien structurées.
Si ce texte comporte des passages qui peuvent paraître utopiques étant donné le fonctionnement politique actuel, il a aussi une assise solide qui fait penser que le réalisme est en train de changer de bord. On commence à comprendre partout que les immenses problèmes que nous rencontrons ne se résoudront certainement pas avec de l’analyse coût-bénéfice en économie du bien-être.
La postface est vigoureuse et pleine de justesse. On fera évidemment la critique que le péril est bien évoqué ainsi que la fin d’un monde mais que le monde nouveau est juste esquissé et que les voies d’y parvenir ne sont pas passées au crible des moyens d’action. Seulement cette critique, toujours la même, en récusant toute analyse politique qui ne prenne comme point de départ la répartition des possibilités financières actuelles abonde dans le sens de laisser agir les forces du marché, méthode qui n’est plus du tout crédible aujourd’hui.
45 ans après la candidature de René Dumont aux présidentielles — en 1974 peu après le premier rapport du Club de Rome — on s’aperçoit que les politiciens n’ont toujours pas pris la mesure du problème et tentent de gérer les affaires avec les mêmes notions de croissance, de PIB, de marché et n’ont rien entendu de ce qui angoissent les jeunes.
A mon avis la radicalité politique est la condition pour que ces difficultés majeures, uniques dans l’histoire, soient traitées démocratiquement.
• La nature comme marchandise, une série d’entretiens, Antoine Costa, Le monde à l’envers 2018.
Dès les années 1970 et surtout après le sommet de Rio de 1992 où la notion de développement durable est venue sur le devant de la scène avec ses ambiguïtés, tout le monde avait compris que la logique de marché était à courte vue et prenait mal en compte le long terme ainsi que les contraintes collectives. La méthode qui fut la première à être critiquée fut l’analyse coût-bénéfice destinée à internaliser des externalités en donnant un prix à des biens ou services non marchands. Je renvoie pour une synthèse à l’article « Analyse coût-bénéfice » du Dictionnaire de la pensée écologique, sous la dir. de D. Bourg, A. Papaux, PUF 2015.
Plus perfectionnée, la théorie des services éco-systémiques s’est développée progressivement en poussant l’idée que la notion de valeur qui faisait fonctionner les échanges et vivifiait l’économie pouvait parfaitement s’étendre à notre attachement à la nature. Et ainsi englober la nature et la planète dans le champ de la pensée économique avec tous ses outils élaborés depuis le 19ème siècle c’est-à-dire depuis l’ère industrielle. Cette vision extrêmement réductrice prend la nature pour ce qu’elle n’est pas, la même erreur que Descartes. Les services que rend la nature sont pensés en compétition avec des artefacts produits par la chimie qui n’ont en commun avec ce qu’ils remplacent que le service qu’ils rendent au sens le plus étroit. En réalité ils affaiblissent les sols, les écosystèmes, les rendre vulnérables aux espèces invasives, et en certains endroits les tuent définitivement. On peut vraiment parler du bulldozer de la substituabilité.
Par ailleurs j’ai montré que la fixation de prix élevés pour les zones écologiques précieuses ne pouvait pas résister à la compétition avec l’exploitation de ressources fossiles cotées sur les marchés. Voir sur ce blog l’article « Combien coûte la nature ? ».
Récemment une nouvelle étape a été franchie, la plus terrible car elle fabrique de la bonne conscience tout en détruisant. C’est la méthode au joli nom de compensation, venue des Etats-Unis, extension à la biodiversité des droits à polluer négociables inventés pour le CO2. C’est l’objet principal de ce livre. On atteint là le summum de l’hypocrisie parce qu’on fait semblant de régler le problème : on adopte une méthode qui, peut-être, théoriquement, pourra se perfectionner lorsque notre connaissance scientifique de la nature sera meilleure mais qui aujourd’hui permet de détruire tout de suite en remplaçant la nature par un simulacre confectionné pour qu’il puisse faire illusion.
Entre les pessimistes et les optimistes, nous sommes en France, avec la nouvelle économie de la transition, à l’époque du mysticisme de marché : la biodiversité diminue partout et selon des causes d’une complexité croissante, mais on va compenser. Certains pourront anticiper la destruction de sites essentiels en élevant des animaux et des plantes sur des terrains non menacés par l’urbanisation et les vendre aux promoteurs d’opérations bétonnées et asphaltées pour qu’il y ait compensation, suivant des idées ultra-libérales. On est content parce qu’on a fabriqué un marché.
Pour moi l’arnaque de ce genre de considération réside dans le retournement des risques. Il y a toujours de l’aléa dans ce qui se passe ici ou là dans les vingt ans à venir. Ce qui est détruit n’existe plus et même la description exhaustive de ce qu’on a détruit est hors d’atteinte. Et on prétend donner autre chose ailleurs qui dans vingt ans jouera le même rôle que ce qui n’est plus. Il n’y a que les profiteurs de la destruction pour croire à cette magie macabre.
On atteint avec la loi biodiversité un tel niveau de verbiage intentionnel que les medias sont débordés, ils n’ont pas le temps de séparer le vrai du faux, ils sont submergés par l’innovation langagière, leur propre matériau.
Ce livre coûte 9 Euros, il est lu rapidement et mérite qu’on y revienne. Cela vaut la peine. Ce n’est pas du temps perdu. Il permet de voir clair sur ce sujet difficile et gravissime.
• Pourquoi joindre l’inutile au désagréable, En finir avec le nouveau management publicEvelyne Bechtold-Rognon, L’Atelier 2018.
Ecrit peu de temps avant le déclenchement du mouvement des gilets jaunes, ce livre aurait pu en être une base au niveau du diagnostic et de la prise de conscience. Il traite du nouveau management public (NMP) méthodes pour organiser et administrer les services publics et en particulier l’enseignement, telles qu’elles sont mises en œuvre en France actuellement. L’ouvrage explique les théories sociales et économiques qui sous-tendent cette idéologie issue de l’utilitarisme anglo-saxon de Bentham et de Mill mis au goût du néolibéralisme. Il décrit comment ceci est appliqué et vécu dans les faits en Angleterre et en France. Evelyne Bechtold-Rognon tire de cette analyse des notions clés — injonctions paradoxale, plaisir dans le travail, fausse idée de l’appât du gain, importance du collectif dans le travail et dans la mission — qui permettent de mesurer la maladresse et la courte vue de ces dispositions qui sous prétexte d’économie font perdre du temps, fonctionnent mal, et découragent les agents qu’on empêche de faire bien leur travail. Elle en tire une réflexion de fond très documentée sur le service public, sur l’Etat et ses missions
Le livre est émaillé d’une foule de témoignages authentiques, concrets, directs. Ils illustrent la réalité qui est faite d’une infinie variété de situations dont seul le dévouement à sa tâche bien faite parvient à tirer parti pédagogiquement, au contraire des principes de compétition qui se révèlent l’application doctrinaire d’une théorie abstraite, hors sol, comme on dit. La conclusion est tout à fait brillante.
Pour employer le langage économique auquel je suis habitué, je dirais qu’il s’agit d’un exemple typique d’application de l’analyse coût-bénéfice à un domaine non marchand, stratégie explicite de la politique agressive menée actuellement par le libéralisme.
On voit que la destruction du plaisir à servir l’Etat dans le service public, et le management impersonnel froidement calibré, imposé par double contrainte, ne pouvaient qu’avoir des répercussions désastreuses sur les liens entre la classe des ménages aisés, disons qui possèdent des valeurs mobilières et profitent du dynamisme de la finance, et celle des gens ordinaires (ceux « qui ne sont rien ») aux prises avec des diminutions de services dans l’enseignement, dans la poste, les hôpitaux, l’université et les chemins de fer.
• L’institution de la liberté Muriel Fabre-Magnan , PUF 2018.
Ouvrage très intéressant. Il n’est pas nécessaire d’être juriste pour l’apprécier. Le droit est ici le révélateur de modifications sociales et économiques profondes induites par la forme que prend le capitalisme depuis peu. Il s’agit de ce qu’on doit appeler le libertarisme méthodologique c’est-à-dire l’idéologie libertaire élevée au rang de doctrine économique.
L’ouvrage est précis dans son écriture et sa pensée ce qui est tout à fait agréable. Les exemples, nombreux et variés, apportent non seulement un éclairage sur la jurisprudence mais révèlent souvent des comportements insoupçonnés des humains de nos démocraties occidentales auxquels on n’aurait pas immédiatement pensé. Beaucoup de citations sont habilement choisies en particulier celle de Simone Weil p. 179 qui anticipe certaines vues de Lacan.
La machine ultra-perfectionnée qu’est le capitalisme contemporain (qui — comme le savent les lecteurs de ce blog — conforte le business as usual en effaçant le signal-prix), dispose d’une méthode assez redoutable pour tirer parti des innovations dont les deux outils principaux sont le droit des contrats et la notion de consentement.
Cela est bien expliqué par Muriel Fabre-Magnan. Le cas central est celui de l’érosion puis de la véritable destruction du droit du travail grâce à des contrats précaires consentis explicitement par les personnes concernées. La liberté de l’individu et sa responsabilité dans ses choix sont mises en avant pour faire valoir la légitimité juridique de conditions de travail sans protection ni garanties de durée et avec des salaires diminués. Cette idéologie agressive politiquement, juridiquement et économiquement, vient des Etats-Unis où elle a été installée depuis longtemps et elle parvient à diffuser internationalement grâce à Internet, aux firmes transnationales et aux accords de libre échange. La Cour européenne des droits de l’homme joue nettement le rôle d’institution relai de ce dispositif.
Sur cet exemple du marché de l’emploi on voit facilement les gros sabots des défenseurs de cette théorie. Considérer dans l’abstrait que la plus grande valeur est la liberté des choix individuels est moralement une tromperie puisqu’à l’évidence les contraintes des conditions de vie limitent les choix et obligeront les plus démunis à accepter n’importe quoi. C’est à mon avis la grande faiblesse de la justice axiomatisée de John Rawls qui fut dénoncée par Amartya Sen. Nous ne sommes pas dans la situation d’un groupe de quelques pionniers égaux dans la conquête de l’Ouest en train de fonder ex nihilo les règles d’une ville nouvelle. Sen souligna l’injustice de ne pas tenir compte des possibilités d’action des personnes, les fameuses « capabilités ». J’ajoute qu’en outre on peut démontrer qu’un système conforme aux principes de justice de Rawls conduit inéluctablement à l’effondrement économique par l’accaparement de la richesse par un seul agent, sauf à prévoir un transfert social par un impôt sur la fortune ( N. Bouleau, Chr. Chorro « The impact of randomness on the distribution of wealth: Some economic aspects of the Wright-Fisher diffusion process » Physica A, mars 2017).
Mais le libertarisme méthodologique ne se limite pas aux relations de travail loin de là. En fait, il entend conquérir… tout. Cela a été théorisé par Friedrich Hayek en utopie globale. Concrètement cela va depuis le marché des prélèvements d’organes, les divers usages du corps par arasement des barrières sociétales, jusqu’à la nature qui nous entoure en la pensant comme un service gérée par des droits d’usage négociables. Les exemples donnés par Muriel Fabre-Magnan dans la jurisprudence américaine et les modifications du droit en Europe sont révélateurs du terrain que parvient à gagner cette idéologie invasive. On est bien au delà du pragmatisme de John Austin (Quand dire, c’est faire, 1955) qui reste au niveau sémiologique et philosophique. Et on peut se demander comment sans employer d’armes autres que des mots et de l’argent, le capitalisme parvient ainsi à conquérir une bonne part des décideurs de civilisations très élaborées sur des sujets moraux de prime abord éloignés de l’économie comme l’euthanasie ou la gestation pour autrui.
Parmi les explications de cette docilité surprenante, il me semble qu’il faut ajouter que le libertarisme sociétal a le talent de mettre les agents sous double contrainte ce qui a tendance à annihiler leur estime de soi. On sait que cette situation psychologique particulière, dégagée par Gregory Bateson en étudiant les peuples autochtones de l’île de Bali, a des conséquences importantes sur le comportement de ceux qui la subissent s’ils ne sont pas en mesure d’en prendre conscience. Il s’agit de deux injonctions logiquement contradictoires, typiquement la mère disant à son fils adolescent « Mais cesse de m’obéir, prend ton indépendance ». En proposant des artéfacts ou des systèmes professionnels ou sociétaux nouveaux l’idéologie libertariste dit « prends de la liberté je t’en donne si tu es consentant », consentement qui est évidemment cadré juridiquement comme une cage en acier.
Avec cette propagande flatteuse sur la liberté de ceux qui osent la saisir, on fait oublier aux gens les contraintes dans lesquelles ils sont de par leur corps, leur santé, leur patrimoine matériel et culturel. Et nous trouvons là aussi une explication des difficultés de l’extension de la connaissance scientifique aux craintes désintéressées. La connaissance est considérée comme une valeur marchande et la liberté du chercheur lui est présentée comme pleine et entière s’il ose valoriser ses travaux économiquement en gérant soigneusement ses conflits d’intérêt. Il lui sera plus difficile de se focaliser sur les risques que les entreprises profitables font courir à la santé et à l’environnement.
Il y a du tragique dans ce livre, du moins c’en est ma lecture. On imagine un big brother diffus sous la forme d’une armée de partisans prêts à détruire beaucoup de principes sur lesquels sont fondés nos efforts pour donner du raffinement et de la justice à la civilisation.
Je pense que ce livre ouvre également des chantiers de recherche sur les rapports à l’environnement.
• Ecologie antique, milieux et mode de vie dans le monde romain (1990), Paolo Fedeli, EIL, Genève, 2005.
L’auteur a réuni un grand nombre d’extraits qu’il a regroupés en thématiques et commentés de façon nuancée et comparée afin d’éclairer nos problématiques contemporaines. Les rapports des Romains avec l’environnement sont traités ici, sources latines et grecques à l’appui, ce qui permet, en plus de la réflexion écologique, d’approfondir si besoin les étymologies des termes employés aujourd’hui sur ces questions.
De nombreux auteurs de l’Antiquité montrent une sensibilité à la campagne, aux éléments naturels, à l’eau, à la pollution, aux plantes, aux animaux et plaident pour le soin qu’on doit leur accorder. Souvent ils appuient leurs visions prudentes sur les valeurs religieuses très liées à la nature à cette époque. Mais P. Fedeli montre aussi que le point de vue qui justifie les aménagements volontaires par les besoins du développement urbain et les nécessités guerrières est très présent également, parfois chez le même auteur, révélant une grande ambivalence de l’époque sur ces sujets.
L’ambiguïté est particulièrement apparente à propos des forêts. Celles-ci sont habitées de toutes sortes de divinités qui doivent être respectées et honorées. Elles sont aussi difficiles à pénétrer par les armées. Alors que la Gaule est conquise, la Germanie reste en dehors de l’Empire, les hommes qui y habitent peuvent s’y cacher et sont qualifiés de sauvages. Mais la construction des navires et des maisons de ville nécessite énormément de bois, ce qui entraîna une vaste déforestation le long des mers et des fleuves pour faciliter l’acheminement. Certains auteurs justifient cela pour les besoins de la guerre, notamment contre les carthaginois, et soutiennent que la nature est abondante. On a là une mauvaise gestion de ressources renouvelables qui se retrouve largement aujourd’hui qui consiste à surestimer le rythme de renouvellement des réserves parce que celles-ci sont mal connues. L’empire romain est si vaste, bordé de forêts un peu partout qu’un décompte précis est impossible et les urgences priment, d’autant plus que celles-ci sont épisodiques. Ce déboisement est à l’origine du « désastre hydro-géologique » comme l’appelle P. Fedeli dû au ravinement et à l’érosion des terres par les pluies torrentielles, phénomène dont les Romains ne semblent pas avoir vu le lien avec la diminution des zones boisées. On sait, de même, que la déforestation et le détournement des eaux pour l’irrigation durant l’Antiquité furent responsables du changement de climat de la Mésopotamie.
Se mêle à ces considérations de nombreux écrits simplement élogieux pour l’Italie (Laudes italiae) sorte de propagande expliquant que, par sa situation idéale, son climat tempéré, ses plaines cultivables et ses sources nombreuses, l’Italie explique la constitution saine et vaillante du peuple romain prédisposé à dominer le monde.
L’agression faite aux montagnes pour les nombreuses carrières dont avait besoin l’empire choque beaucoup d’auteurs. Ils y voient un processus excessif, une violence dont l’irresponsabilité s’exprime à cette époque en terme de divinités outragées. Alors que des louanges vont aux travaux agricoles qui sont respectueux des paysages et maintiennent une nature bienveillante. Ces extraits font immanquablement penser aux arguments contre la technique qu’avancera Heidegger imprégné de culture classique (« La question de la technique » Essais et conférences (1952), trad. A. Préau, Gallimard 1958).
Un passage de Tacite (p64-65) est d’une actualité saisissante. Il s’agit d’un vote du Sénat contre certains travaux destinés à éviter des inondations fréquentes du Tibre à Rome en détournant certains de ses affluents. Les arguments des uns et des autres étant entendus, on décide de ne rien changer, comme si les ouvrages artificiels envisagés n’étaient pas convaincants et pouvaient entraîner des dommages insoupçonnés. Principe de précaution avant la lettre.
Plus clairement que d’autres, deux auteurs expriment dès cette époque de véritables philosophies de l’écologie. D’une part Lucrèce qui met en poésie une vision quasi matérialiste, pessimiste sur l’avenir de l’humanité, et Vitruve qui développe concrètement, en professeur, l’ensemble des préalables dont doit se préoccuper un architecte avant et pendant la construction, pour le choix du site, l’orientation, les matériaux, avec une attention tout à fait étonnante à ce que nous appelons l’environnement. La finesse avec laquelle il s’attache à transmettre plutôt des préoccupations que des recettes tout en s’appuyant sur le plus vaste champ possible de sciences explique son influence considérable à la Renaissance, et encore maintenant d’ailleurs.
L’ouvrage de P. Fedeli est plein de trouvailles étonnantes qui révèlent la liberté de pensée et l’étendue des connaissances des auteurs de l’Antiquité sur les sujets de la vie quotidienne. On apprend par exemple que Pasteur ne serait pas l’inventeur des microbes car Varron écrivait « Il faut, s’il y a des endroits marécageux, tourner la ferme en sens opposé parce qu’il se développe certains petits animaux, invisibles à l’œil, qui par la respiration pénètrent dans le corps à travers la bouche et les narines, et y créent de périlleuses maladies ».
Des auteurs romains se préoccupent de la pollution volontaire de certains produits par des adjuvants dissimulés. Déjà à cette époque la main invisible de Smith semblait ne pas très bien fonctionner et il se posait la question de la sûreté alimentaire : « Nous savons qu’on y ajoute aussi pour le teinter des substances colorantes, comme une sorte de fard pour le vin, et qu’il s’en trouve épaissi. Tant de poisons pour le contraindre à plaire et nous nous étonnons de sa nocivité ! » (Pline l’ancien). Je renvoie au livre lui-même qui est plein de surprises de ce genre.
• Vie et aventures d’un positiviste, Francis Magnard (1875). Disponible sur Gallica.
Petit livre écrit de façon enlevée, à la fois léger et grave sur certaines questions philosophiques. Véritable scenario d’une pièce de boulevard à rebondissements. Lu en une demi-heure, sans regret.
Ce qui est dommage c’est que le personnage principal Pierre-Paul-Jacques Beuvron, le positiviste du titre du roman, n’est pas vraiment campé en positiviste mais comme matérialiste. Il est athée, anticlérical, comme Marx, croyant aux forces de la nature comme d’Holbach, en faveur du darwinisme social comme Spencer, perdu dans ses fantasmes scientifiques comme le savant Cosinus, mais tout cela n’en fait pas un positiviste.
Pour quelques mots introductifs sur le positivisme je renvoie à la vidéo Philosophie des sciences leçon n°7
• Souvenirs d’enfance, Sophie Kovalewsky, Suivi de Biographie, par Anne-Charlotte Leffler, Préface et notes de Michèle Audin.
Absolument savoureux. Quelle intelligence, quelle sensibilité chez cette jeune fille. Et l’ambiance de cette famille russe, la jalousie avec sa sœur, l’aura de Dostoïevski, c’est véritablement du Tchekhov. Son récit de la naissance de sa vocation pour les mathématiques est splendide. On tombe véritablement sous le charme de cette femme exceptionnelle et vibrante.
L’équipe de la jeune maison d’édition a organisé un travail éditorial remarquable. Voir les vidéos de présentation. L’édition est augmentée de chapitres inédits en français et de notes de Michèle Audin qui s’appuyent sur des sources historiques nouvelles. Cela fait de cet ouvrage une référence.
Indispensable dans la bibliothèque de toute personne ayant un faible pour les mathématiques.
• Hiroshi Sugita, Probability and random numbers, World Scientific (2018).
La théorie des probabilités, intuitive, ou axiomatisée par Kolmogorov dans le cadre de la théorie de la mesure et de l’intégration, ne dit pas précisément lorsqu’une suite de digits 0 et 1 est au hasard, comme si on les avait tirés à pile ou face. Elle dit très bien les propriétés de telles suites. Mais pour une suite donnée, elle ne répond pas à cette question pourtant naturelle qui a depuis longtemps intrigué les philosophes et les savants. Si la suite est infinie la théorie des probabilités indique des conditions seulement nécessaires par ses théorèmes asymptotiques.
L’idée qu’une suite est au hasard si elle défie tout procédé pour la calculer est ancienne et a été précisée d’abord par l’école soviétique autour de Kolmogorov. Ce courant de recherche abondant et passionnant engagé dans l’entre-deux guerres avec les noms de Borel, Von Mises, Ville, Wald, s’est développé après la seconde guerre mondiale à partir de la notion de complexité au sens de Kolmogorov et, après les travaux de Martin-Löf, Levin, et d’autres, les logiciens-mathématiciens sont parvenus à établir, en un sens précis, qu’une suite dont aucun algorithme ne pouvait « rendre compte » vérifiait les propriétés qu’on attend d’une suite au hasard.
Ces résultats montrent également qu’une suite finie peut être considérée comme au hasard si les algorithmes qui peuvent l’engendrer ne sont guère plus courts que la suite elle-même. En quelque sorte elle ne peut être résumée.
L’audace du livre de Hiroshi Sugita (à paraître en février 2018) est de démarrer une initiation au calcul des probabilités à partir de cette idée de complexité d’une suite de digits pour des étudiants qui débutent. Evidemment l’avantage est d’éviter la théorie de la mesure qui est toujours un gros paquet à faire passer. Aussi Sugita ne peut que rester vraiment dans le cas discret. Mais il est un aficionado du mouvement brownien et de l’analyse stochastique et il ne peut s’empêcher d’ouvrir souvent les fenêtres vers ces horizons en se servant d’extension et d’analogie.
Ce livre est remarquable d’habileté et de précision. Il passionnera les enseignants qui tentent de mettre à profit l’engouement vers l’informatique pour rendre vivante la science des risques probabilisables. Une prouesse réussie.
• Ivar Ekeland Le syndrome de la grenouille, l’économie du climat , O. Jacob 2015.
Un livre de plus sur la transition énergétique. Tout n’a-t-il pas été dit ? Sur les faits mesurés, sur les contradictions entre vision économique et intérêt collectif, sur la myopie des taux d’intérêts, sur les faiblesses du politique ?
Il s’agit d’un livre de vulgarisation. Mais vulgarisation, qu’est-ce que ça veut dire finalement ? Dire la vérité scientifique ? Contrer les climato-sceptiques par des affirmations factuelles incontestables ? Ce n’est pas du tout cela dont il s’agit ici. Ekeland veut faire comprendre. Et il utilise pour cela un immense talent de conteur pour clarifier, simplifier sans trahir les phénomènes cachés, introduire au bon moment une analogie éclairante bien choisie.
Le style de ce petit livre est un délice, captivant, informatif, amusant, on commence à lire et on ne le quitte plus. Je crois avoir compris le secret de cette façon d’écrire. C’est de prendre le lecteur pour intelligent, cultivé et d’esprit ouvert. C’est très agréable évidemment.
D’autant plus qu’Ivar Ekeland nous conduit bien plus loin que les critiques stériles des décideurs qui ne décident pas, profondément dans la philosophie de l’économie, et de la démocratie, de façon tout-à-fait décapante.
Sur l’existant tout ce qui est dit ici est connu des spécialistes, encore fallait-il y mettre toute la lumière. Là où le livre est précieux ce sont sur les tendances, sur « ce qui est en train d’advenir », et là il faut un jugement solide (avec tout ce qu’on entend !), sur les tendances courtes, le long terme et les inerties de comportement.
Je recommande ce livre sans restriction, particulièrement à ceux de vos amis qui sont d’accord pour dire qu’il y a un souci avec l’environnement et la planète, mais ne souhaitent pas tellement en savoir davantage parce qu’ils sont submergés de discours douteux, post-modernes, performatifs, intéressés, dont ils ont la nausée. Ce livre n’a pas la naïveté d’un point de vue positiviste, ni d’ailleurs iréniste, il est courageux et cela fait du bien de lire une vision forte, généreuse, lucide, qui s’appuie sur une vaste culture scientifique.
Les pages 70 à 73 m’ont particulièrement plu. Je ne connaissais pas l’étude dont il s’agit. Cela fait très bien comprendre pourquoi la pensée économique est éthiquement invasive, elle souhaite défaire les règles sociales et les contraintes environnementales qui la gênent et — là est le point — elle crée ce faisant des situations irréversibles à cause de la mentalité naturelle du consommateur. Entre autres tabous démolis, j’ai apprécié le coup de projecteur sur la morale irresponsable de la position d’actionnaire (p108) qui structure de façon si importante l’économie aujourd’hui (que j’avais dénoncée en d’autres termes dans « Une pensée devenue monde » ESPRIT nov. 2009, p130-146).
Ce livre est facile à lire parce qu’il se situe au bon niveau, il ne s’éternise pas sur les sujets trop fins — comme la philosophie économique d’Amartya Sen, certes fondamentale, mais tout de même réponse à une longue série de préoccupations de penseurs économistes difficilement accessibles. La vertu de la simplicité vivante et stimulante.
• Krzysztof Burdzy Resonance, From Probability to Epistemology and Back, Imperial College Press 2016.
Krzysztof Burdzy est un mathématicien dont l’œuvre est marquée d’un style particulier que l’on peut caractériser en disant qu’il parvient à rendre passionnant des problèmes très fins et très difficiles. Il nous parle ici de philosophie des probabilités et des statistiques.
J’extrais de l’introduction
Je fonde mon épistémologie sur le concept de « résonance », vaguement relié à son sens en physique. J’utilise résonance dans mon analyse du problème philosophique de l’induction. J’examinerai aussi trois problèmes philosophiques bien connus : de la conscience, de l’intelligence, et du libre arbitre.
et du texte
Le processus de l’acquisition de connaissance a deux volets. Le second fut le thème principal de l’épistémologie, de sorte que je lui attribuerai l’étiquette « logique ». L’existence et l’importance du premier volet de ce processus sont la thèse majeure de ce livre. Je qualifie cette partie du processus épistémologique de « résonance » parce que je crois qu’elle a quelques éléments communs avec le phénomène naturel éponyme. Pour esquisser la chose, résonance est un premier filtre grossier dans le processus d’acquisition de connaissance. Le traitement logique est un second filtre plus fin.
Nous voyons qu’avec la résonance Burdzy semble aborder avec un regard nouveau ce que j’ai essayé de travailler sous le terme d’interprétation ou de talent interprétatif. Mais c’est à confirmer.
Plus amples commentaires bientôt.
• Ernest Renan L’islam et la science (1883) Berg International 2016.
Cette conférence peu connue prononcée il y a 130 ans à la Sorbonne est impressionnante de pertinence aujourd’hui. J’en recommande absolument la lecture.
Renan habituellement grand stratège à se maintenir dans un entre-deux habile lui permettant de critiquer les religions par des faits historiques objectifs tout en les défendant vis à vis des matérialistes comme des courants historiques naturels, dessine ici une vision très claire du cheminement des connaissances scientifiques depuis les Grecs jusqu’à l’Occident de son temps. Il dissocie le rôle de la religion et celui des structures politiques assez variées qu’ont connues les divers contrées musulmanes durant le moyen âge et après.
On perçoit, en arrière plan, la vénération de Renan pour le progrès de la connaissance scientifique. A cette date Renan garde toujours inédit le manuscrit de L’avenir de la science qu’il a en réserve depuis près de quarante ans et qu’il se décidera à publier 5 ans plus tard, dévoilant ainsi publiquement le transfert de son propre élan religieux vers la science.
Evidemment bien des choses ont changé. La colonisation du Maghreb, le pétrole dans les pays du Golfe et en Iran, le régime soviétique dans les pays du Nord comme l’Ouzbékistan, et récemment la remontée de l’Islam en Turquie et les migrations vers l’Europe…
• Edouard Tétreau, Au-delà du mur de l’argent , Stock 2015, 194p.
Ce livre est écrit par un chrétien convaincu et convaincant. Je veux dire par là que le propos n’est pas sur la défensive des valeurs chrétiennes mais les prend comme base pour appréhender les problèmes et apporter des solutions pour l’avenir des humains et de la planète. L’ouvrage est agréablement écrit et, il faut le souligner, les données factuelles et les chiffres mentionnés au cours de l’argumentation sont précis et soigneusement référencés. L’auteur a participé à l’entourage actif qui encouragea le voyage du pape François aux Etats-Unis pour dire à l’ONU et devant le Congrès une parole forte et sans compromis. C’est à partir du texte Evangelii Gaudium et de l’encyclique Laudato Si (voir la discussion sur ce blog) qu’Edouard Tétreau entend prolonger la réflexion et proposer une ligne d’action.
Je ne décris pas ici le principe de cette proposition qui constitue la quatrième partie du livre, pour laisser au lecteur le goût de le lire. L’auteur se défend de tout idéalisme et considère qu’il faut prendre le monde tel qu’il est, au risque de faire trop de concessions peut-être à un pragmatisme nécessairement teinté de conformisme. C’est à dire que l’argumentation peut manquer de radicalité pour influencer réellement les trois piliers écologiques que sont l’économique, le social et l’environnemental. Elle part de la thèse fondamentale d’accorder une valeur infrangible à l’homme dans sa dignité.
Cet humanisme chrétien, sans doute les écologistes y sont-ils maintenant davantage attentifs, mais il a déjà été discuté par avance par nos intellectuels célèbres, je pense à Alain Finkielkraut qui dans La sagesse de l’amour mettait en garde contre l’abstraction d’un amour lointain portant sur des personnes que l’on ne connaît pas et à Luc Ferry qui dans Le nouvel ordre écologique écrivit que l’être humain était désormais défini par sa perfectibilité. Aussi bien le lecteur aurait aimé que la thèse de la pertinence de la charité chrétienne pour la planète soit davantage étayée selon un argumentaire sinon laïque du moins opérationnel.
Cette réserve étant faite, l’ouvrage d’Edouard Tétreau fait partie des textes qu’on a plaisir à lire par sa clarté et la générosité avec laquelle sont abordées les graves questions de notre époque, il émerge du badinage insignifiant avec lequel on nous bat les oreilles.
• Grégoire Souchay, Marc Laimé, Sivens, le barrage de trop, préface d’Hervé Kempf, Seuil 2015, 135p.
Après la confusion médiatique autour des événements de Sivens, ce livre présente un récit des faits, des moyens et des méthodes des divers acteurs, dans le but d’illustrer finalement l’opposition entre deux conceptions de l’aménagement du territoire et de la gestion de l’eau comme problématique de l’agriculture de demain.
Dans la préface Hervé Kempf replace la lutte contre le barrage de Sivens dans le perspective plus générale d’une « transformation de l’économie, qui doit intégrer pleinement l’impact écologique de l’activité humaine ».
L’ouvrage se compose d’une première partie de sept chapitres exposant la montée du conflit depuis l’opposition locale jusqu’au drame national, et d’une seconde partie de cinq chapitres qui est une analyse des causes sociopolitiques et historiques à partir des options de l’agriculture productiviste en France depuis la seconde guerre mondiale. Il fournit également un ensemble de références à des décisions, textes juridiques et documents en ligne sur lesquelles s’appuie l’analyse, ainsi qu’une liste, fort utile, des significations des cigles employés. La lecture en est très facile, intéressante, et ouvre souvent des apartés qui font réfléchir.
Dans le Tarn, les conflits pour ou contre l’irrigation à outrance sont antérieurs à l’affaire Sivens. Les zones humides sont appelées des « bouilles » en patois. Il existe d’ailleurs un collectif « Tant qu’il y aura des bouilles » dont des sympathisants furent attaqués par un groupe cagoulé en janvier 2014. Ici comme ailleurs, les opposants aux projets destructeurs des espaces naturels emploient le terme de ZAD pour dire zone à défendre. C’est significatif en soi. Les zones d’aménagement différé étaient considérées dans les années 1970-80 comme des protections contre la spéculation immobilière dans les projets d’intérêt général. Elles ne sont plus tellement utilisées, aujourd’hui on préfère plutôt tenter d’orienter les perspectives de profit des promoteurs vers la planification souhaitée (Cf. Grand Paris). On voit que le mouvement de Sivens et celui de Notre-Dame-des-Landes se positionnent nettement au niveau de la contestation des « grands projets inutiles ». La ZAD, en ce nouveau sens, devient un espace de convivialité où la vie quotidienne n’est pas si facile à organiser et repose sur une entraide avec les moyens du bord.
Du côté des décisions administratives l’idée du barrage nait au début des années 2000. Les bases idéologiques, économiques et politiques des discussions entre collectivités locales, services préfectoraux et structures syndicales sont bien rendues. Il semble tout à fait normal dans ces cercles de mobiliser les moyens publics pour mettre 40 millions de mètres cubes à la disposition d’une trentaine d’exploitants. La Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne joue à la fois un rôle de conseil et de maître d’œuvre pressenti, ce qui peut être perçu comme conflit d’intérêt. Cependant le projet avance malgré les avis défavorables dont en particulier celui du Conseil scientifique régional de protection de la nature, et en mai 2014 le Conseil général du Tarn adopte la « déclaration de principe du projet » et son financement. Les trois premiers chapitres fournissent une analyse, assez méticuleuse, des faits, et des connaissances disponibles, où l’on voit que les rapports de pouvoirs rencontrent souvent des détails déterminants.
Le chapitre suivant aborde la politique de l’eau par les positions et décisions des responsables politiques nommément : Philippe Martin (le ministre qui ouvre les vannes), Delphine Batho (qui bloque les projets de décrets favorisant la création de retenues), l’euro-députée Catherine Grèze (qui interpelle la Commission européenne sur les manquements du dossier) et bien d’autres. Les procédures et initiatives confuses des acteurs publics et des intérêts locaux aboutissent à des réserves explicites de la Commission européenne sur le projet en juillet 2014 notifiées au gouvernement français.
Mais ceci ne freine pas les études ni les mesures de démarrage du barrage. L’attitude des forces de l’ordre sur le terrain, sous l’autorité de la préfecture du Tarn, s’en tient à la légitimité d’un « vouloir bien faire » qui consiste à rendre effectif le pouvoir régalien dans son acception la plus productiviste. Ceci monte en violence à l’automne 2014, escalade jusqu’au drame du 25 octobre, avec la mort de Rémi Fraisse sous l’explosion d’une grenade de type offensif, le « crime du pouvoir socialiste », comme l’écrit Hervé Kempf sur le site de Reporterre.
La seconde partie nous fait réfléchir sur les causes de la bataille de Sivens en montrant depuis la seconde guerre mondiale, l’inertie d’un système agricole productiviste dépassé. Remembrement pour faciliter la mécanisation, pesticides, usage intensif de l’eau que l’on considère inépuisable, invasion par le maïs assoiffant les sols, courses aux primes de Bruxelles, cette trentaine de pages est un excellent tableau de la politique agricole menée depuis une soixantaine d’années, durant les trente glorieuses et par la suite dans un certain imbroglio des intérêts locaux et des principes de politique publique. J’en profite pour signaler à ce sujet l’excellent ouvrage collectif Une autre histoire des trente glorieuses, Bonneuil Chr., Pessis C., Topçu S., eds, La découverte 2013, plus approfondi qui montre combien cette période fut brutale d’un point de vue environnemental et a laissé des traces positives dans les esprits à cause de références économiques sommaires.
La conclusion du livre fait de Sivens une étape dans la prise de conscience d’un productivisme révolu et sur les nouvelles vocations environnementales de l’agriculture.
Comme dit Kempf dans la préface, les écologistes, jeunes et moins jeunes demandent une mutation devant une vision de l’avenir « celle des dominants — unissant en France le Parti socialiste, l’UMP et le Front National — pour qui la croissance économique est la clé de la paix sociale, quel qu’en soit le prix environnemental et sans toucher aux rapports d’extraordinaire inégalité qui régissent aujourd’hui la société. »
Ce livre est engagé, il ose dire les choses. Il ne laisse pas indifférent. Il est motivant sans jamais faire appel à des catégories abstraites et des anathèmes éculés. Il est certain que ces luttes opiniâtres mais pacifiques forcent le respect. Il pose également très bien cette grande question du vouloir bien faire des décideurs publics et responsables locaux qui ne parviennent plus à séparer l’intérêt général et les fortifiants économiques.
Une ou plusieurs cartes avec la vocation des sols, voire une ou deux photos eussent été les bienvenues. Il manque aussi à mon avis quelques explications sur certaines causes économiques du comportement des collectivités locales durant la période, en particulier sur la politique d’appel aux marchés internationaux pour encourager le crédit aux communes, départements et régions, avec le rôle emblématique de la banque Dexia, conduisant à une immense facilité de lancement de projets divers d’aménagement, avec la contrepartie d’un endettement absolument incontrôlé sur de longues périodes, rigidifiant la gestion collective. C’eût été, certes, alourdir aussi ce travail, qui a l’avantage d’être accessible à quasiment tout lectorat.
• Kilani M., L’universalisme américain et les banlieues de l’humanité, Payot Lausanne 2002.
Ce petit livre écrit peu de temps après le 11 septembre 2001, est d’une actualité saisissante. Non seulement par les problématiques relatives à l’islam mais aussi à cause de l’évolution récente du monde occidental. Je comprends le regard anthropologique de Mondher Kilani comme une ouverture à une pluralité d’universalismes. Ceci n’est pas paradoxal. Il entend par universalisme une culture offerte à tous dont l’assise est historique mais ouverte à l’autre et attentive à la richesse et la créativité de l’autre. Sa grande connaissance de l’islam et la solidité de son analyse philosophique fait de cet essai un creuset de réflexions qu’il est impossible de résumer. L’auteur tire beaucoup d’enseignements du monde contemporain en forme de thèmes de recherche : sur un certain parallèle entre l’islam et la question de la décroissance, sur le post-modernisme et l’objectivation des faits sociaux, sur la fabrication de stéréotypes, et sur la co-formation de la vision que nous avons des autres et que les autres ont de nous, etc.
Cf. plus récemment du même auteur « la religion dans la sphère civile, une critique du « désenchantement » » Esprit fév. 2011, p91-111.
• Laurent Mermet, Yann Laurans, Tiphaine Leménager Tools for what trade ?, Analysing the Utilisation of Economic Instruments and Valuations in Biodiversity Management, AFD 2014.
Ce livre est tout à fait remarquable par la qualité de l’analyse et par la problématique qu’il transmet au lecteur. On n’y trouvera pas l’état des lieux en matière de biodiversité et de sa dégradation, on sait que c’est alarmant mais ceci peut être trouvé ailleurs. L’objet du livre est d’analyser les moyens d’action pour enrayer ce phénomène en portant son attention sur les outils économiques et également décisionnels. Disons tout de suite que l’impression finale qui ressort de ce travail énorme est que la conservation de la biodiversité est un objectif beaucoup plus difficile qu’on pourrait croire a priori, et que l’humanité semble, malgré toutes les bonnes volontés, vouée à la poursuite d’un processus qui n’est sûrement pas inéluctable, mais qui fait intervenir un tel écheveau de jeux d’acteurs que sa complexité même le nourrit et le perpétue.
La méthode de quantification financière des services éco-systémiques — présentée comme la panacée par trop d’instances internationales — est re-située dans ses limites et l’économisme simpliste de la substituabilité. Je ne reprends pas ici l’ensemble des outils économiques étudiés. L’ouvrage ne s’arrête pas là. Il discute également certaines théories sociologiques qui éclairent les attitudes vis à vis de l’innovation telle que « la traduction » de Michel Callon expliquée sur le cas générique de la culture des coquilles St Jacques à St Brieux et le rôle que peuvent avoir des minorités ou des « groupes concernés » ainsi que le schéma structurel de Bruno Latour des « Politiques de la nature ».
Le seul point sur lequel mon diagnostic sur un outil diffère légèrement de celui des auteurs est celui du « biodiversity banking » qui est l’idée des droits négociables appliquée à la biodiversité. Je suis plus radical et pense que cet outil ne marchant déjà pas pour le carbone, comme on le voit en Europe, il ne peut pas marcher pour la biodiversité. Le point, comme je l’ai souvent souligné, est que les marchés financiers s’agitent tellement que la mise en marché des droits efface, par la volatilité, toute visibilité aux acteurs et à l’instance régulatrice s’il y en a.
Une problématique de fond que pose cet ouvrage est celle du positionnement du chercheur en « biologie de la conservation » et donc plus généralement celle de la place du scientifique entre le constat et l’action engagée. Le cas de la biodiversité est exemplaire d’une difficulté contemporaine majeure. Est-ce que les mesures d’indicateurs, les articles de sociologie de la décision, ne sont finalement que des « commentaires » au dessus d’une réalité qui échappe ? Est-ce que des écrits plus engagés ne font pas perdre au scientifique une part de son objectivité en le situant explicitement dans une socialité partisane. L’avantage de réfléchir à cette question à partir de ce livre est d’éviter les propos nuageux de la haute philosophie anthropologique et socio-systémique, ici l’acuité des problèmes apparaît concrètement.
Pour ma part je crois que le travail du scientifique doit aujourd’hui s’élargir par rapport à ce que la tradition positiviste a défini comme « scientifique » (et qui est encore la référence largement majoritaire dans le monde) : d’une part en accueillant dans son travail de l’interprétatif pour comprendre les menaces, et d’autre part en acceptant une vision socialement située par la participation à une communauté de scientifiques dont les options de bases sont explicites. L’interprétation est à mes yeux, comme je l’ai illustré sur ce blog, un talent essentiel de la construction de connaissance qui est le seul outil dont nous disposons réellement pour penser l’éventuel.
• B. Latour et P. Gagliardi (ss la dir. de) Les atmosphères de la politique, dialogue pour un monde commun, Les empêcheurs de penser en rond, 2006.
Les atmosphères de la politique propose de réfléchir sur les conditions d’un dialogue entre des parties qui ne se reconnaissent mutuellement aucune légitimité ni même ne s’accordent a priori sur les modalités d’une négociation, cela concerne aussi bien des situations impliquant l’Islam, la Chine et la démocratie libérale occidentale que le problème du dialogue des scientifiques avec d’autres citoyens « irrationnels ».
Douze intellectuels d’horizons variés dissertent, non comme représentants de branches disciplinaires mais simplement comme voyageurs de la culture faisant part des paysages qu’ils ont visités. Le thème est grave « que peut vouloir dire constituer cette atmosphère de la liberté sans considérer que nous savons évidemment d’avance la place où doivent s’asseoir les réducteurs de têtes amazoniens, les sages chinois, les savants chimistes, les ayatollahs, etc. comme si nous savions d’avance à quoi devait ressembler le parlement global ? » mais le mode d’expression n’est pas universitaire. Il s’agit d’une pièce de théâtre, douze personnages en quête de hauteur, sur le mode de la comedia del arte, des textes ont été rédigés par chacun et lus par les autres, à partir desquels les discussions s’improvisent librement devant un public qui n’intervient pas. Le procédé fréquent des images flottantes où l’on remplace une notion abstraite par une image (les serres pour plantes exotiques, etc.) qui est travaillée dans le registre sémantique in absentia avec des images voisines ou complémentaires projetées en retour sur le problème philosophique comme nouveaux concepts éclairants, fonctionne sans coup de force pour le lecteur et l’ensemble atteint une façon de philosophie poétique de bonne qualité. L’avantage de la forme choisie est la spontanéité des débats qui donne souvent des formules particulièrement heureuses. Indiquons-en quelques moments.
D’abord la tolérance, notion d’origine chrétienne, apparaît aux yeux de B. Latour et de I. Stengers comme une fausse solution, il s’agit d’un « analgésique » qui édulcore abusivement les problèmes. Ensuite le concept de liberté n’est pas perçu universellement comme une valeur évidente, il est marqué négativement dans le monde musulman (G. Kepel) et « le cas chinois est hors cadre à cet égard, telle est bien l’hétérotopie : la Chine a bien pensé le pouvoir mais elle n’a pas pensé la liberté » (F. Julien). Quant à l’universalité, elle est attaquée « Nous pensions que ce mélange de marché capitaliste et de démocratie libérale, dans lequel nous vinons plus ou moins, était une sorte d’avant-garde […] le reste du monde n’a pas envie d’être guidé de cette manière » (S. Maffettone). Néanmoins la raison publique est notre affaire : On ne peut échapper ni à l’héritage de la raison universelle […] ni à la certitude de sa fragilité » (B. Latour) « Est-ce que vous accepteriez, dans un dialogue à venir, de traduire le concept de public reason par le concept de ‘sagesse d’Allah’ ? » (P. Sloterdijk). Mais nous sommes pris dans un conformisme pesant qui se rengorge de compétition : « ce qui est sidérant est notre incapacité à dire ‘non’ à ce qui, au nom de Darwin, propose une multiplicité de mises en scènes évolutionnistes relativement obscènes, propres à confirmer que l’hypothèse de l’évolution est une machine de guerre contre tout ce qui, pour une raison ou pour une autre, attache les humains » (I. Stengers). La nature, enfin, pose un problème de représentation politique : « l’humanité se savait faible. Or appartenir au genre des faibles donne des droits » maintenant c’est la nature qui est faible, et la question se pose de savoir qui parle pour elle (P. Sloterdijk).
La pièce n’a pas de dénouement. Il n’y a pas de solution car aucun cadre a priori « Il n’y a pas d’arbitre donc on ne peut se contenter de faire du calcul de théorie des jeux pour calculer s’il faut ou non faire la guerre en Irac » (B. Latour). Le message du livre est un point d’orgue sur le problème lui-même.
La science et la techno-science sont aussi abordées. Isabelle Stengers espère que les scientifiques soient capables (ou au moins certains d’entre eux) de mettre leur raison au service de la construction d’une paix avec des adversaires irrationnels. Leur générosité peut-elle aller jusque-là ?
Il semble que pour l’immense majorité des scientifiques le rôle qui leur est ainsi proposé ne leur convient pas. En mettant en parallèle l’inacceptable pour les musulmans d’avoir à se régler sur les principes démocratiques inventés par les impies occidentaux et l’inacceptable pour les scientifiques d’avoir à faire une place dans la fabrication de connaissance à des représentants de croyances irrationnelles, on fait resurgir en toile de fond l’inacceptable pour les chercheurs d’envisager que la vérité scientifique puisse être mise sur un pied d’égalité avec l’erreur ou la fraude dans une vision purement socio-centrique de la connaissance.
C’est déjà beaucoup d’obtenir que la science n’ait pas la prétention de tout régenter, on n’obtiendra jamais qu’un chercheur après des efforts pour s’émanciper de croyances dans lesquelles il était lui-même enraciné, accorde que les représentations qu’il a ainsi atteintes soient mises au même niveau que des croyances jamais contestées ni vérifiées.
En l’espace d’une dizaine d’années cet ouvrage a vieilli. Le contexte international est plus instable avec plus de conflits entre pays économiquement peu développés, la violence à l’égard des pays riches vient d’actions individuelles dispersées, les migrations dues à la dégradation des conditions de vie prennent des proportions historiques, les indicateurs environnementaux globaux se sont détériorés.
Le programme fort de la sociologie des sciences a créé artificiellement une défiance, une fracture d’incompréhension et le problème qu’elle a ainsi exacerbé n’apparaît plus aujourd’hui bien posé. La responsabilité de la technique est évidente mais accabler les chercheurs est sans effet, au contraire il s’agit aujourd’hui d’aider les scientifiques à de nouvelles missions dont la planète a besoin.
Le courant des sciences studies qui nourrit nombre de thèses dans les universités américaines a été détourné par la mise au point des nouvelles techniques des marchants de doute : la mauvaise fois contrôlée des mercenaires scientifiques. Les climato-sceptiques et faiseurs de doute sont les bons élèves de la sociologie des sciences.
Justement, l’origine de la mécompréhension vient à l’évidence d’une surestimation des ambitions de la sociologie des sciences. Ni David Bloor ni Bruno Latour, ne semblent se douter qu’un siècle avant eux déjà le sociologue Edmond Goblot écrivait dans un ouvrage teinté de positivisme « la science est un phénomène social, et, par conséquent la logique est une branche de la sociologie » et concluait « la logique est une branche de la sociologie et la vérité est un fait social » (Essai sur la classification des sciences Alcan 1898).
Mais la sociologie peut seulement faire apparaître, soit des « faits sociaux » à la Durkheim, soit des idéaux-types à la Weber, en tout cas des lectures générales du monde présent. Elle a bien assimilé les idées post-modernes, elle tient compte de l’effet social de la connaissance, du « quand dire c’est faire » de Austin, de la performativité et autres procédures itératives de recherche de point fixe. Au demeurant elle doit reconnaître qu’elle est largement démunie pour parler de l’avenir.
Notons que E. Goblot écrit cela cinq ans avant la plus grande crise logique des fondements des mathématiques depuis la découverte des géométries non-euclidiennes sans avoir rien entrevu évidemment.
• Marc Angenot Les grands récits militants des XIXe et XXe siècles, Religions de l’humanité et sciences de l’histoire, L’Harmattan, 2000.
Passionnant. Combien les questions que se posaient les lanceurs d’idées, les initiateurs de mouvements, au 19ème siècle au moment de cette industrialisation — qui est bien à l’origine des défis que nous ne savons pas résoudre aujourd’hui — sont actuelles. Les deux grands sillages, celui de Marx qui pense la transformation du monde comme lutte de la classe ouvrière pour l’appropriation des biens de production dans le cadre philosophique d’une dialectique hégélienne rendue matérialiste, et celui du positivisme de Comte qui a laissé encore plus de traces aujourd’hui, ces deux sillages se situent dans tout un ensemble de doctrines qui tentent de définir une société meilleure.
Comte n’est pas le seul à avoir la conviction que seul moyen de construire les règles sociales de façon solide est de les fonder sur la science parce que c’est la seule chose sur laquelle il y a consensus.
Le 19ème siècle est le siècle des « grands récits sociaux »: le communisme, les différents socialismes, (Proudhon, etc), le fouriérisme (de Charles Fourier) et les théories sociales de Saint-Simon, de Pierre Leroux, de Colins, de Godin (le phalanstère Godin). La plupart de ces courants et en particulier le saint-simonisme s’appuie sur la science, tous, y compris le positivisme, partagent trois convictions
– Les religions sont sur le déclin, elles vont disparaître, y compris le catholicisme
– Le socialisme doit s’appuyer sur la science
– Le progrès va balayer toutes les vieilles croyances et apporter un monde meilleur.
Mais aussi la plupart de ces « hommes de progrès » se posent une question qui les inquiète: Que va-t-il advenir du lien social s’il n’y a plus de religion ? Les gens ne vont-ils pas se comporter en égoïstes sans compassion ni altruisme et la société se déliter. « La société ne peut être un assemblage d’êtres humains, ennemis naturels les uns des autres sans cesse occupés à se nuire mutuellement » écrit Lamennais.
La grande question politique que posaient ces penseurs de la société future était : par quoi remplacerez-vous les croyances que vous voulez supprimer ? Question bien actuelle s’il en est.
Et la réponse chez tous — y compris les communistes — était « par la croyance au progrès, à la liberté, à la justice ».
Comte est lui-même conscient de ce problème. Il veut organiser la société sur la science, mais il sait bien que la science, le peuple ne la comprend pas, alors il a l’idée de fonder une religion laïque, sans dieu, qui reprend un peu la religion des saint-simoniens et s’appuie sur la science et l’idée de progrès. Mais alors vers quoi peut se tourner cette spiritualité ? La chose la plus haute à vénérer est l’humanité.
Aujourd’hui nous ne pouvons plus souscrire au positivisme en tant qu’épistémologie — pour de multiples raisons dont certaines sont discutées sur ce blog — mais ne serait-ce pas la partie considérée comme la plus faible de la doctrine, cette « religion de l’humanité », qui finalement resterait la plus « juste » aujourd’hui, la moins stupide ?. Après Hans Jonas, après Dennis Meadows, devant l’incapacité de l’économie à gérer dignement l’emballement de l’espèce humaine qui produit chaque jour 230000 naissances de plus que de décès, la religion du marché et du profit est bien comprise par l’homme de la rue, mais où mène-t-elle pour l’humanité justement ?
• Miguel Benasayag et Pierre-Henri Gouyon Fabriquer le vivant ? La Découverte, 2012.
Plein d’idées et d’éclairages sur les questions les plus variées de notre époque, sans négliger les grands défis philosophiques et culturels, cet essai est rédigé sous forme de dialogue entre les deux auteurs, retravaillé et rendu plus abordable par des exemples et références par Margot Korsakoff.
Dans l’ensemble les deux discutants sont assez d’accord, mais on se rend compte progressivement qu’au delà d’une alliance objective contre des visions qu’ils pourfendent, des différences assez nettes se font sentir, dans le style et le mode d’expression M. Benasayag ayant le verbe plus abondant, mais aussi sur certains thèmes P.-H. Gouyon développant une approche différente notamment de la notion d’information.
Impossible de résumer l’ouvrage. Il se lit avec beaucoup de plaisir, les exemples concrets sont nombreux pour illustrer les points phénoménologiques délicats. Les échanges abordent non seulement la biologie moléculaire et de synthèse, la grande question épistémologique du vivant et de la nature, mais aussi la société du progrès technique piloté par l’économie, la place de l’homme et de l’humanisme, le sacrificiel et la religion, et, à l’occasion on fait un peu de psychanalyse, un peu d’urbanisme, et pas mal de politique aussi évidemment. Un glossaire éclaire sur les termes difficiles.
Mon impression générale est que l’ouvrage est très convaincant pour tout ce qui concerne ce que les auteurs critiquent. Ils sont alors assez d’accord et cela les aide sans doute à trouver des images justes et des mots précis.
Par exemple pour montrer les insuffisances de la vision nominaliste-utilitariste que l’on retrouve aux fondements de l’économie libérale et aussi à la base de certaines démarches réductionnistes en biologie.
Et pour dénoncer la compétition, le ranking, et autres moyens d’enfoncer ceux qui ne réussissent pas dans la compétition néolibérale et l’eugénisme fondamentalement présent dans la course au progrès vers « l’amélioration » de l’homme.
Egalement, c’est le fil rouge de cette critique, celle du constructivisme — c’est à dire la vision selon laquelle les êtres vivants, l’homme, peuvent être pensés dans leur développement ontogénétique comme des éléments assemblés à partir de « briques » élémentaires. Sont lumineusement exposés le rôle du contexte et de l’épigenèse et le problème de la mutilation du réel par l’opération de compartimentage. Il est vrai qu’il y a un parallèle saisissant entre la volonté de séquencer, coder par des systèmes formels, la chimie de la cellule et le principe de l’économie libérale d’individualiser les agents en gommant systématiquement les liens qui font qu’ils ne sont pas indépendants.
Est mise en cause aussi une certaine rationalité plaquée sur le vivant qui consiste à le voir comme le résultat d’une « optimisation » alors qu’en fait il s’agit plutôt d’un bricolage selon le mot de Monod,
J’ai eu plus de mal à suivre le versant de l’essai qui propose des réponses, d’abord parce qu’elles se présentent comme des pistes de réflexion, des ouvertures plurielles, mais aussi par un foisonnement des propos. Un peu dommage que la discussion sur l’information ne soit pas davantage clarifiée. On peut distinguer au moins cinq notions différentes d’information utilisées dans les disciplines scientifiques et au moins deux en économie (cf mon article sur la non efficience des marchés) qui sont toutes des mannequins très réducteurs de la connaissance. On ne peut guère par exemple parler (p 154) de l’information de Shannon à propos de la combinatoire que peut engendrer un ADN car l’information de Shannon concerne exclusivement une famille probabilisée de signaux. Est-ce que l’information de Kolmogorov est ici pertinente? Ou bien doit-on postuler une méta-probabilité au dessus des ADN éventuels, c’est ce que Georges Matheron récuse (cf Estimer et choisir, Ensmp 1978)… Au sujet des lacunes de la biologie de synthèse, il est un peu difficile de suivre le vocable spinoziste de parties extensives et de parties intensives ou celui des extensions rhizomatiques de Deleuze et Guattari qui font penser à « l’âme de la terre » du pan-psychisme de William James. La discussion s’envole, ici ou là, vers des sphères un peu métaphysiques.
Il est sûr que penser ce que peut être une société respectant le mouvement du vivant est à la fois important et oh combien difficile.
La thèse principale que les auteurs veulent souligner finalement est tirée de leur discussion sur le sacré, l’importance — plus haute que l’utile — du sacrificiel, suivant l’excellent exemple des cellules de l’embryon qui sont dans la main entre les doigts et qui vont mourir (apoptose) pour l’émergence des doigts. C’est un point philosophique en effet tout à fait profond. Le sociologue pragmatiste John Dewey parlait de l’importance de l’élagage en matière culturelle et de contenus d’enseignement. Ici l’idée est plus intrinsèque à la nature propre du vivant : il faut accepter le sacrifice, (comme la mort programmée des cellules), ce que la société de progrès économique et technique est incapable de faire.
On voit bien en effet l’illusion de réussite toujours bénéficiaire qui anime le néolibéralisme. Mais le drame n’est-il pas que le sacrifice y est aussi programmé ? C’est celui des pauvres par la misère et la dégradation de leur cadre de vie. Les auteurs l’ont pointé d’ailleurs dans le chapitre 2, il eût été intéressant de faire le lien, le débat appelle une suite…
[ajouté en mars 2015 : Il est sûr que le thème de ce que l’on peut appeler « l’apoptose sociale » préoccupe Miguel Benasayag car il vient de s’exprimer sur Arte en disant « Le monde obéit à une nouvelle nature, un nouveau apartheid, alors les noirs les arabes les blancs tout est ok, simplement une autre race c’est les losers les winners. Il y a des losers et il y a des winners. Et on est responsable de notre vie. Celui par exemple qui mange tous les jours qui circule en bagnole, qui a une belle maison, eh bien il le mérite, et celui qui est dans la merde il le mérite »…]
• Michel Serres Petite Poucette Le Pommier 2012.
C’est l’histoire d’un grand esprit qui veut absolument tenir encore sa belle plume sur des interprétations généreuses et optimistes du monde contemporain.
Nous restons grandis par la plupart de ses vues, sur l’épistémologie de l’inter-fécondité des sciences sociales et des sciences mathématisées, sur sa pensée de la nature et de notre relation à elle, sur la culture et sur l’humain, mais finalement, n’est-ce pas aussi parce que Serres nous entraîne dans un monde où se mêle ce qui est et ce que l’on souhaite, où l’on ne voit pas certaines choses morbides, perverses, basses, alarmantes ?
Car projeter le téléphone mobile sur la grande fresque trans-séculaire de l’invention du langage, et de la révolution de l’imprimerie, en le cousinant avec les nouvelles technologies, c’est parler d’un monde qui aurait pu être mais qui n’est pas.
L’informatique distribuée était porteuse de nouvelles possibilités pour le citoyen : de moins subir, de construire lui-même les connaissances intéressantes, en s’émancipant des influences, vers plus de liberté et de maturité, et ceci avec la démultiplication d’une communication facile. Surtout le travail formidable des associations pour dire l’état de la nature pour témoigner des évolutions, des menaces et des expériences réussies, pour fabriquer ce fameux intérêt collectif que l’humanité cherche depuis des siècles et qui ne peut exister autrement que par des constructions politiques contractuelles. L’informatique distribuée devait pouvoir faire entrer en démocratie les savoirs lointains sur les conséquences collectives invisibles des comportements quotidiens pour en finir avec la mentalité du gaspillage irresponsable et du profit destructeur.
Mais ce que nous avons est bien autre chose : un système à la merci de toutes les intrusions, où les commerçants « bienveillants » capturent en cachette nos goûts et nos humeurs pour influencer nos décisions en suivant des techniques similaires à celles employées par les perturbateurs malveillants qui sont si nombreux qu’on ne peut plus se fier à l’informatique connectée.
Et Google, et icloud, et les enregistrements de messages, qui collectent des masses gigantesques de données permettant à la Nasa de filtrer, de sélectionner, sous l’approbation d’une bonne part des commentateurs des médias privés. Au fond beaucoup des représentants des classes dominantes sont convaincus que Big Brother c’est très bien si c’est dans les mains d’entreprises capitalistes cotées en bourse.
Quant à la technicité informatique de la finance qui permet de spéculer selon des centièmes de secondes suivant des traitements mathématiques savants, c’est à courte vue, irresponsable, une addiction au jeu d’argent, institutionnalisée par un discours économique manipulé. (Voir sur ce blog la page « Les marchés fumigènes »).
Je n’irai pas jusqu’à dire comme Alain Finkielkraut que la toile et wikipedia, à disposition immédiate, dissuadent les jeunes de faire l’effort de se cultiver. Mais il est incontestable que certains dépassements, l’abstraction du calcul mental, le plaisir de mobiliser des éléments de poésie, de littérature, l’enjeu de vivre avec des personnalités ennemies ou amies créatives du passé, tout cela nécessite plus de force de caractère pour se frayer une voie malgré l’embrouillamini du web.
Michel Serres sait tout ça, il sait aussi que la pensée critique intéressante s’émiette dans de petites publications sans audience, et, au final, n’a guère d’influence. Peut-être son idée est-elle justement de s’exprimer en négatif, de nous faire sentir ce que sa description a d’onirique…
• Hubert Reeves Là où croît le péril… croît aussi ce qui sauve, Seuil 2013
Le thème de ce livre est la question de savoir si la civilisation conditionnée par la nature et un passé de conquête est à même d’affronter les nouveaux défis liés à la finitude de la planète. Ce sujet a été maintenant très souvent abordé et l’on est curieux de connaître la particularité du regard de Reeves.
Va-t-il laisser le lecteur avec une perspective de désastre, misant sur l’effet social que peut avoir un livre pour susciter une prise de conscience dans l’esprit de Jared Diamond (Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Gallimard 2006). Poursuivra-t-il, comme le titre le suggère, la ligne philosophique de Jean-Pierre Dupuy que la vision de la catastrophe est la source efficiente du ressaut nécessaire (Pour un catastrophisme éclairé, quand l’impossible est certain, Seuil 2002). Ou bien encore s’en remettra-t-il à une forme d’optimisme abstrait ou de pan-messianisme à la manière d’Edgar Morin brossant un tableau lucide des problèmes « qui prouvent que les processus engagés nous conduisent à l’abîme » puis, concluant que l’imprévisible peut nous sauver : « Je pense donc que des processus encore invisibles et minoritaires dans le présent peuvent se développer et créer, en s’alliant les uns aux autres, une métamorphose comme le ver tout nu de la chrysalide qui se transforme, au cours d’une autodestruction qui se révèle en fait être en même temps une autoconstruction, en un être très différent, le papillon ou la libellule doté de qualités nouvelles » (« Le probable et l’incertain » revue Nouvelles clés, n°43, 2004).
Hubert Reeves prend du recul sous la forme d’une vaste fresque qui fait l’essentiel du livre, depuis la matière sombre, les neutrinos, la maturation du terreau galactique jusqu’au développement de la nature terrestre et sa mutilation par l’homme, et enfin, la prise de conscience écologique. En fait à peine plus d’une page est consacrée à la question pointée par le titre (p151-152) et ceci de façon allégorique grâce à deux personnages « Dame Nature » et « l’Enorme » qui est une sorte de volonté de puissance dont les effets peuvent être désastreux. Reeves suggère que le lecteur se munisse « d’un sac de guillemets et d’en saupoudrer les pages qui vont suivre » (les 15 dernières pages) et pose que la clef du problème réside dans le fait que c’est une erreur de penser que la lutte pour la vie est fondée sur l’égoïsme, la nature étant plus complexe et faisant aussi intervenir la compassion : « le Réveil Vert devient une manifestation du souci de Dame Nature de poursuivre son œuvre innovatrice. Dans ce contexte, son fils l’Enorme, ne joue plus contre elle mais avec elle, mettant son talent à son service. C’est pour nous la source de l’espoir. C’est là ‘que croît ce qui sauve’ selon les beaux mots de Hölderlin ».
Reeves se révèle un positiviste dans la tradition la plus pure. Il insiste abondamment sur le caractère universel et absolu des lois : « les lois de Dame Nature sont partout et toujours les mêmes » et passe de ce constat à une religiosité vague, une cosmo-éthique qui n’a rien à envier à la religion de l’humanité d’Auguste Comte. Les guillemets sont une forme de respect pour un langage scientifique qu’il ne faudrait pas souiller par des mots de tous les jours, un peu dans le style de l’appel de Heidelberg de triste mémoire. Aujourd’hui après le développement des sciences studies, même si elles ont mené à quelques excès, on est averti que les matériaux langagiers de la science ne sont que des perfectionnements plus ou moins réussis, plus ou moins durables, de la langue ordinaire, conçus en des lieux précis socialement.
S’il fallait caractériser le ton du propos de Reeves, je dirais qu’il s’attache à se maintenir en permanence dans l’entre-deux. Sa discussion de l’ouvrage de Monod Le hasard et la nécessité et sa façon d’évoquer (pour ne pas dire invoquer) l’intelligent design tout en s’en défendant est typique de ce style subtil et bon enfant qui fait penser irrémédiablement à Renan cet habile scientiste champion des demi-teintes.
On n’avancera pas tant qu’on en restera à des généralités, en usant du pronom « nous » dans le vague, en parlant de la nature compatissante, en invoquant « les générations futures ». C’est fini. Après Copenhague une page est tournée. On a compris la force des intérêts divergents. Le premier résultat de la situation actuelle et des comportements qu’elle fabrique est un effondrement dans la misère et la souffrance de la majeure part de l’humanité et la préservation d’avantages relatifs d’une minorité.
Reeves ne s’engage pas vraiment dans ces questions qui font mal, en particulier celles qui font mal au portemonnaie : pas un mot sur l’économie alors qu’elle est évidemment au cœur du problème.
• Stephen Emmott 10 Billion ,Penguin books 2013
Le livre grand public le plus impressionnant depuis les travaux du Club de Rome mis à jour par l’équipe Meadows en 2004 et le film d’Al Gore de 2006. Je le recommande sans réserves.
C’est un travail rédactionnel pour une large audience très réussi, avec un ton très juste. C’est bien l’objectif que nous avons tous, chercheurs sur l’environnement, d’essayer de faire quelque chose contre le business as usual. Nous retournons ce problème dans tous les sens avec les éditeurs qui ne veulent pas de livre rabat-joie. Emmott y parvient remarquablement, probablement parce qu’il n’élude aucun problème et ne se focalise pas non plus sur une cause précise et pointe — davantage qu’il n’est politiquement correct en France — les conséquences multiples de la surpopulation.
Sa critique du scenario « technologisant » est tout à fait efficace, son évocation de la forteresse des pays riches contre les affamés et les assoiffés également, et sa conclusion sur la guerre, courte et terrible de vérité.
J’ai l’impression d’avoir dit des choses très voisines dans « Vers un jardin des pays riches » Esprit nov 2012, 52-70. Mais c’était beaucoup moins percutant sans soute parce que j’ai voulu accuser en premier lieu le système économique alors que Emmott semble croire davantage que les problèmes sont inscrits dans la nature humaine et dans l’accélération vertigineuse des courbes de croissance dans tous les domaines.
D’ailleurs la fin de son livre débouche sur un large champ de questions non résolues. Mais la simplicité du propos peut ébranler journalistes et hommes politiques.
J’ai adoré ses phrases sur le boson de Higgs p192.
• Roland Dumas Dans l’œil du Minotaure, le labyrinthe de mes vies, Le cherche midi 2013.
Le pluralisme est irritant. Où est Roland Dumas ? Il mange à tous les râteliers. Il n’est pas l’homme d’une foi forte et claire. Curieusement les personnalités hors du commun qu’il apprécie (l’ouvrage évoque Bataille, André Masson, Maria Murano, Mitterrand, Picasso, Genet, Vergès, Lacan, Pierre Guyotat, Jean-Marie Le Pen, Pavarotti, Gorbatchev, Hafez el-Assad) et dont il cherche soit l’estime, soit l’amitié, soit simplement l’audience, sont eux, le plus souvent des passionnés engagés sur une vision du monde où ils tracent leur voie avec assurance et détermination. C’est le message de ce livre dérangeant, les monismes sont acceptables, avec leur beauté et leurs racines profondes, à la condition qu’il y ait des diplomates qui les replacent dans un cadre pluraliste, seul contexte qui possède la finale légitimité.
Déjà Isabelle Stengers insistait sur cette fonction des diplomates dans Les atmosphères de la politique, dialogue pour un monde commun, (Latour B., Gagliardi P., eds, Les empêcheurs de penser en rond 2006).
Dans le livre de Dumas il s’agit de pluralisme dans le champ des idées politiques et dans les goûts contemporains en littérature, en peinture, et dans le bel canto. Si l’on transpose en philosophie, le pluralisme aussi y est désagréable, il est hors des attaches qui fondent le sentiment des vérités profondes. Il est gênant comme sont les autres qui sont là sans que je les aie convoqués et qui osent porter attention à la femme qui peut m’aimer, qui peut me comprendre vraiment. Vis-à-vis du pluralisme nous sommes tous des adolescents attachés à l’amour inconditionnel de la mère ou des éléments familiaux qui en tiennent lieu.
Mais le pluralisme n’est pas l’éclectisme, cette philosophie très française, illustrée notamment par Victor Cousin, qui consiste, au lieu de construire une vision du monde, une de plus, à faire le travail de prendre dans les doctrines ce qu’elles ont de meilleur dans le domaine où elles excellent. La faiblesse de l’éclectisme est son artificielle inexpugnabilité et sa mobilité adaptative. On a besoin en philosophie d’autre chose qu’un patchwork comme en architecture d’ailleurs où Robert Venturi n’a pas su vraiment persuader malgré une analyse théorique brillantissime de l’usage d’éléments formels et de fonctionnalités de toutes les époques (Complexity and Contradiction in Architecture, New York 1966).
Le pluralisme n’est pas une recomposition, il dérive du constat que malgré tous les critères sévères, de pertinence, de compréhension, de légitimité culturelle ou historique et le soin des procédures, nous sommes à une époque où la connaissance prend la forme de plusieurs lectures du monde concomitantes qu’il faut faire vivre ensemble. Sans doute à l’échelle d’un temps très long certaines de ces visions finiront par se fondre en une sorte de vue unifiante supérieure comme ce fut le cas pour la conception corpusculaire et ondulatoire de la lumière et de la matière, mais à ce jour, compte tenu de la complexité des phénomènes environnementaux naturels et sociaux, donner droit de cité à quelques interprétations différentes des mesures recueillies n’est pas un luxe mais un des rares moyens dont nous disposions pour tenter de penser ce qui peut advenir. (cf. sur ce blog l’article « Is Science going wrong, or is epistemology changing ?« ).
Finalement quel message Roland Dumas nous livre-t-il ? Une soif de vivre étonnante et une estime portée à des personnalités qui ont confiance en soi. C’est exactement aux antipodes de cette forte tendance actuelle, inquiétante à bien des égards, qui pousse les gens à rechercher l’amitié exclusive de ceux qui partagent un héritage de valeurs, des racines, une configuration de sur-moi dirait Freud.
• Présentation et commentaire par Bernard Perret des ouvrages suivants :
Dominique Méda – La mystique de la croissance, Flammarion, 2013
Juliet B. Schor – La véritable richesse, Editions Charles Leopold Meyer, 2013 (True Wealth, Penguin Books 2010)
Critiquer la religion du taux de croissance, et après ?
Ces deux livres sont d’inspirations proches – leurs auteurs ont d’ailleurs écrit ensemble il y quelques années un livre sur le travail (Travail, une révolution à venir, en 1997). Chacun consacre de larges développements à la critique de la croissance et des errements de la science économique. Sur ce terrain, leur convergence de fond est totale et leurs approches complémentaires. Schor est plus pédagogue, multipliant les anecdotes et les exemples concrets. Elle est très convaincante dans sa démonstration du caractère aberrant et manifestement non soutenable de l’évolution de nos habitudes de consommation. Méda, pour sa part, manifeste davantage d’ambitions théoriques et pousse plus loin l’analyse des fondements philosophiques et anthropologiques du productivisme. Il ne sert à rien, en effet, de dénoncer de manière répétitive les contradictions de notre conception de la richesse si l’on ne comprend pas son enracinement dans les fonctionnements, valeurs et croyances des sociétés modernes : « croyance au caractère uniment bon des sciences et des techniques, confusion du progrès et de l’augmentation des quantités, désenchantement de la nature, croyance dans les capacité prométhéennes de l’homme, rapport utilitariste et anthropocentrique à la nature, élection de l’économie comme science reine et de l’individu comme valeur suprême, dépolitisation et extension de la sphère de la marchandisation comme mode de régulation des affaires humaines » (p253). Sur les impasses du modèle de développement et des schémas de pensée dominants, les deux ouvrages valent cependant plus comme de bonnes récapitulations/ reformulations de ce qui s’écrit depuis des années que par la nouveauté de leurs arguments. Reste qu’ils viennent à point nommé enfoncer le clou au moment où la tentation de tout sacrifier à un hypothétique retour de la croissance n’a jamais été aussi forte.
Le lecteur qui adhère pour l’essentiel aux thèses de ces deux livres ne peut cependant échapper à une question embarrassante : pourquoi des idées aussi faciles à comprendre ont-elles autant de mal à impacter le débat public ? Et, en particulier, pourquoi les économistes patentés se sentent-ils si peu remis en question ? Je renvoie à ce sujet à une interview ahurissante du prix Nobel Edmund Phelps, annoncée comme un événement à la une d’un grand journal du soir (Le Monde du 28 août 2013). D’après ce grand scientifique, le déclin économique des pays occidentaux serait du à une « crise de l’innovation » ! A le suivre, cette crise expliquerait le ralentissement tendanciel de la productivité du travail depuis plusieurs décennies. L’hypothèse d’un épuisement de notre modèle de développement (liée notamment à une évolution évidente de la structure des besoins) n’est même pas envisagée, alors que c’est bien d’abord de cela qu’il s’agit. Comment espérer faire bouger les lignes lorsque ce qui passe encore pour être l’organe de l’élite (je veux parler du Monde) se fait l’écho non critique des rabâchages d’une discipline fossilisée qui n’a même pas été capable d’anticiper la crise financière de 2008.
Pour en revenir à nos deux auteurs, c’est sur le terrain des solutions qu’apparaissent leurs désaccords les plus significatifs et que l’on peut trouver matière à d’intéressants débats. Il n’est pas surprenant, mais fort instructif, d’observer que leurs divergences reflètent un contraste politique bien connu entre les deux rives de l’Atlantique. Imprégnée d’un idéal typiquement américain de self reliance, Juliet Schor fait preuve de beaucoup d’optimisme quant à la capacité des individus et des petites communautés d’inventer par eux-mêmes de nouvelles manières de produire et de consommer. Il n’est certes pas sans intérêt d’observer que les pratiques alternatives peuvent être valorisantes et qualifiantes : « les adeptes de l’auto-approvisionnement valorisent les compétences qu’ils acquièrent et apprécient cette possibilité d’être créatifs : la construction d’un style vie où il faut compter sur ses propres forces les satisfait et les sécurise » (p167). Comme le note toutefois Méda, ce genre d’approche fait bon marché des conditionnements macro-sociaux et du « caractère addictif et profondément gratifiant de l’acte de consommation » (p242). Dans une perspective très française, elle met pour sa part l’accent sur le rôle décisif de l’Etat et des institutions — y compris de ces institutions particulières que sont les indicateurs censés mesurer notre performance collective — dans la reconversion écologique de l’économie. En conclusion, Méda suggère de renouer avec les idéaux grecs de modération, de sens de la mesure et d’autarcie, mais cette profession de foi est peu étayée et prête à discussion. On peut tout aussi bien défendre l’idée, qui trouve d’ailleurs des appuis dans plusieurs passages du livre (notamment lorsque l’auteur argumente en faveur du Principe responsabilité de Hans Jonas), que le projet de sauver la Planète a besoin du meilleur de l’héritage intellectuel et spirituel de la modernité. Bernard PERRET
• La crise qui vient, la nouvelle fracture territoriale, Laurent Davezies, Seuil 2013.
On apprend énormément de choses à la lecture de cet ouvrage qui ne sont guère relevées d’ordinaire et souvent porteuses de significations profondes. Pour n’en citer qu’une relative à ce qui se passe en France en matière d’emplois : « En 2007, les hommes occupaient 56% des emplois salariés privés; ils ont subi 92% des pertes d’emplois entre décembre 2007 et décembre 2009. On enregistre ainsi un recul de 350 000 emplois masculins, contre 30 000 emplois féminins » (p34) et, sur une période plus longue « entre 1982 et 2006, les femmes ont bénéficié de 84% des créations nettes d’emplois du pays (+3,4 millions de femmes actives occupées pour +0,6 millions d’hommes) ». Je renvois au commentaires que fait L. Davezies de ces chiffres. On aurait envie de disposer des mêmes statistiques pour l’Allemagne puisqu’on sait que les femmes actives y sont proportionnellement moins nombreuses (et qu’elles votent beaucoup plus que les hommes pour Angela Merkel)…
Mais la portée du livre va au delà de la seule analyse territoriale française. En particulier une remarque me semble fondamentale à relever sur laquelle je voudrais insister. Dans le chapitre 3 section 2, L. Davezies pose la question d’une « meilleure croissance ». Il s’agit bien de ce dont on parle à propos de la transition énergétique c’est-à-dire d’une activité économique où l’on développe les services à la personne, les échanges de biens de proximité, les activités non marchandes, etc. A l’échelle globale c’est la conviction qu’il serait souhaitable que les mégapoles du tiers monde essayent de vivre davantage sur l’agriculture des territoires proches plutôt que de nourrir leur population par les céréales des cargos obtenues avec force pesticides, proposées aux prix mondiaux qui tuent les petits agriculteurs poussés de venir trouver des interstices économiques dans les interstices des banlieues. A l’échelle des régions françaises, c’est toute la nouvelle politique de dynamisme local grâce à des incitations par des aides aux associations orientées vers le développement durable.
Ce que souligne L. Davezies est tout simplement que cette dimension « a pour effet immédiat — outre l’érosion de la valeur ajoutée — une baisse tendancielle des prélèvement publics et sociaux sur la création réelle de richesse » et il ajoute que ceux qui préfèrent une meilleure croissance à davantage de croissance devraient se réjouir car c’est bien ce qu’on observe aujourd’hui « mais une meilleure croissance veut dire aussi moins de redistribution ».
Ce point crucial pourrait venir brouiller d’une signification très ambiguë les actions en faveur du développement durable, sans que leurs promoteurs, engagés, ne s’en rendent compte le plus souvent. La redistribution touche à l’avoir et pas seulement à l’être, et là, l’idéologie que ce qui est en propriété est mieux soigné que ce qui ne l’est pas, en location ou en commun, joue à plein. On retombe encore sur l’importance du troisième pilier, social, du développement durable qui, depuis la première Conférence de Rio n’a pas fonctionné du tout.
Davezies montre aussi combien l’Etat, par le simple fait qu’il prélève aux individus indépendamment de toute considération territoriale, et alloue des aides sociales également selon des critères uniformes, est aujourd’hui la seule instance qui sort du jeu pur et simple de la liberté de l’offre et de la demande, et que c’est ce qui fait que le pays existe. L’étage des Etats-Nations (et de l’Europe en Europe) est donc essentiel. Il est actuellement le seul outil disponible.
La phrase de Ronald Reagan « Government is not the solution to our problem. Government is the problem »[1] est donc une idéologie très dangereuse, surtout maintenant que les Etats sont en plus très endettés.
[1] Discours inaugural, 20 janvier 1981.
• Gilles Raveaud La dispute des économistes, Le Bord de l’Eau 2013
Remarquable petit livre de synthèse des thèmes majeurs de l’économie. Agréable à lire, accessible à un large public, il fait se répondre les thèses de façon assez captivante. Le style résulte visiblement d’un travail ciselé, le résultat final est un texte qui devrait rester.
Pour ne pas me cantonner à l’éloge inconditionnel, j’ai regretté l’absence d’un paragraphe sur Hayek et son brillant plaidoyer pour l’intelligence décentralisée grâce aux prix, qui a eu une immense influence sur la légitimité du libéralisme. Et aussi que l’ouvrage s’achève sans une discussion critique de la thèse de la sauvegarde de l’environnement par son « économisation » avec l’analyse coût bénéfice généralisée…
Ce livre très soigné méritait une grande maison d’édition, mais elles esquivent tout engagement critique. Les grandes librairies ont supprimé les rayonnages « environnement » et « écologie » et la rubrique « économie » est de plus en plus remplacée par « gestion »…
Nous sommes, je dis nous pour les scientifiques indépendants qui essayons de réfléchir, dans une grande difficulté à nous exprimer, alors que justement nous sommes persuadés que beaucoup de références et de comportements doivent changer.
A cet égard le livre de Raveaud est très intelligent. A mon sens il est l’exemple même de ce qu’il nous faut faire dans les mois qui viennent. Rédiger un livre qui a toutes les apparences d’une parfaite neutralité (ce ton « impavide » dont parlait Kempf hier sur Reporterre). Donc qui accueille le lecteur dans le paysage strictement informatif précieux pour celui qui veut savoir mieux les grandes idées et les points de vues. Et progressivement, très progressivement, — et c’est cela tout l’art de l’auteur — amener, tirer le lecteur vers les problématiques contemporaines et la fausse route du productivisme…
• L’économie verte en trente questions, Coordination Philippe Frémeaux, Alternatives Economiques 2013
Qui est en décalage ? Qui voit juste ? L’équipe d’Alternatives Economiques qui était au départ un lieu d’expression de pensées hétérodoxes, si ce n’est subversives, est maintenant au centre de ce qu’on doit appeler l’appréhension raisonnable de la situation réelle. Nous sommes tant assourdis par des médias démagogiques qui flattent obséquieusement les pulsions possessives et consommatrices que le raisonnable est devenu hétérodoxe !
Ce livre est à recommander absolument. On est loin ici des pseudos solutions encourageantes et de la censure habituelle des vérités pessimistes, on tente de comprendre vraiment ce qui se passe, ou plutôt pourquoi il ne se passe pas grand-chose. Le développement durable est d’emblée reconnu pour une notion ambiguë qui a caché les difficultés. La dynamique propre du capitalisme et l’erreur du système de valeur qu’il répand sont pointées et analysées dans le chapitre initial qui pose bien le problème général. Il est incontestable que « le paradoxe de notre société est que l’inégal accès à la consommation conduit les riches et les pauvres à aspirer à une poursuite de la croissance » de sorte que « la fuite en avant dans la croissance devient une exigence pour se prémunir des conséquences mêmes de la croissance » et finalement « le bilan en termes d’emploi et d’activité, et donc de croissance économique dépendra alors essentiellement des nouveaux arrangements qui seront conclu au sein de nos sociétés sur la part respective des activités monétaires, qu’elles soient marchandes ou non marchandes, et des activités bénévoles et domestiques ».
En passant, certaines citations de John Stuart Mill font voir combien seulement certaines des idées de ce penseur original ont eu un sillage véritable, celles qui allaient dans le sens de l’utilitarisme déjà proposé par Bentham. La section sur l’économie d’Aurore Lalucq (p28 et seq) est une synthèse des traits qui font de l’économie et de son cœur néoclassique une vision simpliste — notamment son incapacité à prendre en compte le temps [1]. Elle doit être remise en cause impérativement, je verrais bien ce texte dans les manuels scolaires.
L’importance des indicateurs de durabilité forte est soulignée à juste titre (p38), j’ajouterais qu’il faut absolument insister sur le fait que ces indicateurs doivent être construits en unités réelles (quantités, surfaces, classifications, distances, dénombrement, etc.) et non par des traductions en prix, car sinon le jeu de la volatilité de marchés financiers qui attribuent des prix à la plupart des denrées actuellement de façon top-down, vient tôt ou tard cisailler toute norme ou accord entre parties si sages soient-elles[2].
Le chapitre II sur la crise écologique souligne sept « plaies » illustrées par des cartes ou schémas très parlants. Le suivant approfondit la question énergétique (et entropique sur laquelle Georgescu-Roegen n’avait pas parfaitement compris les choses, malgré la justesse de ses vues, en raison de l’état de la science de son temps[3]). Le dernier chapitre concerne les moyens de la transition, la gestion des biens communs, la modification nécessaire des comportements du citoyen socialement gratifiés, etc. Je ne veux pas ici de résumer cet ouvrage davantage il faut s’y reporter.
Pour tout de même ne pas rester dans un éloge inconditionnel, je mentionnerai une lacune à mes yeux importante. Le problème de la compétition dans un champ de bataille en désolation, ou de la myopie économique, ou encore du dilemme du prisonnier, ou de « un, deux, trois,…, soleil »[4] qu’on l’appelle comme on voudra, n’est traité qu’au niveau individuel c’est à dire des ménages, et la mondialisation essentiellement sous l’angle du problème des transports. Mais l’égoïsme est aussi fondamentalement au niveau géopolitique des Etats-Nations. Il y a les « gated-communities » et il y a les murs-frontières. Quand on y songe, la fameuse phrase de George W. Bush « The american way of life is not negotiable » était plus qu’une erreur, en se servant de la tribune internationale pour faire passer une position politicienne interne il a transformé tous les chefs d’Etats en imbéciles s’ils se préoccupaient des problèmes de la planète.
[1] Cf. à ce sujet Teeth of the Market Chap. III section 2.
[2] Cf. également Teeth of the Market, Chap. III section 4.
[3] Cf. René Passet Les thermodynamiques du développement (2004). Cf. N. B. op. cit. Chap. 2 section 1 et Chap. IV section 2.
• To the Class of 2030: A Letter and Apology, Reinhard Illner, Kindle edition 2013 http://www.amazon.com/dp/B00E82JWQO
Il est heureux que de plus en plus de scientifiques sortent la tête du jeu standard de la compétition universitaire pour réfléchir où va le monde. Leur regard est parfois d’une justesse directe sans naïveté ni cynisme qui nous change des subtils discours ambivalents et hyper-méta-astucieux.
 Illner est professeur de maths à l’université de Victoria au Canada. Son petit livre est un constat sans indulgence de la société occidentale telle que les Etats-Unis la pilotent depuis plus d’une vingtaine d’année. Sa connaissance concrète de l’Amérique donne à ce texte une certaine saveur pour le lecteur français (toujours gêné par la disqualification politique habituelle d’anti-américanisme primaire).
Illner est professeur de maths à l’université de Victoria au Canada. Son petit livre est un constat sans indulgence de la société occidentale telle que les Etats-Unis la pilotent depuis plus d’une vingtaine d’année. Sa connaissance concrète de l’Amérique donne à ce texte une certaine saveur pour le lecteur français (toujours gêné par la disqualification politique habituelle d’anti-américanisme primaire).
Le premier thème abordé est celui du dénie de démocratie. Pour Illner, la démocratie a été détournée aux Etats-Unis par l’action principale de quatre groupes. 1- le complexe militaro-industriel; 2- l’industrie financière; 3- « a loose assortment of wealthy people and businesses who are trying to opt out of community obligations by only serving their own interests »; 4- les Chrétiens fondamentalistes.
Aucune théorie du complot dans cette analyse, mais un regard lucide sur les rapports de force et les slogans lancés dans les médias. Les groupes 3 et 4 sont sur quoi s’appuie le Tea Party : « What united these people was their belief in the universal power of tax cuts, their disdain for social programs and social justice, and their invocations of religious beliefs in the sense of fundamentalist Christianity ».
Reinhard Illner fournit un compte rendu très documenté de la philosophie anti-impôts de la période Reagan Thatcher et CDU/CSU en Allemagne qu’il appelle la révolution néo-conservative « Conservative forces (led by Margaret Thatcher in Britain, Ronald Reagan in the US, the Christian Democrats in Germany) focussed their programs on the lack of freedom in state-planned economies in the Soviet bloc, and pushed their agenda with slogans like “Freedom or Socialism” (CDU/CSU slogan 1976) or “Government is not the solution to our problem. Government is the problem” (Ronald Reagan inaugural address, January 20, 1981) ».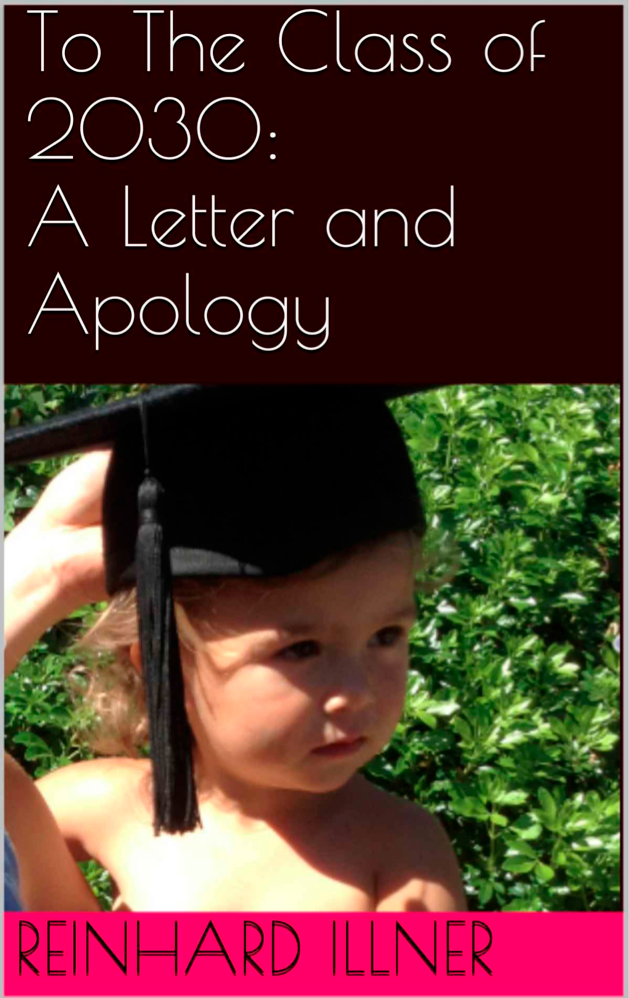
Le mouvement de la théorie de la relance par l’offre au lieu du stimulus keynésien par la demande date de cette époque (il a été repris semble-t-il par les conseillers socialistes de l’actuel gouvernement en France, avec une vingtaine d’années de décalage).
La société fracturée et en particulier les « gated communities » au Brésil, au Mexique etc. et bien sûr aux USA est citée comme un signe révélateur de ce qui est en train de se passer au niveau local et au niveau mondial. Illner rejoint ici l’analyse que j’ai faite dans « Vers un jardin des pays riches » Esprit nov. 2012, 52-70.
Il évoque également le problème de la propriété privée — sans analyser le problème des biens communs en eux-mêmes — par l’étude politique du cas de la Californie et de la fameuse Proposition 13 de la constitution californienne. Les inscriptions de ce type dans les constitutions apparaissent comme des verrous du monde contemporain (on pourrait citer aussi celui de la constitution allemande à propos de la création monétaire par la banque centrale).
Ce petit livre se termine par une description précise et édifiante du retournement idéologique des dirigeants canadiens quittant une perspective écologique pour la justification d’une économie primaire d’exploitation des ressources fossiles, ainsi que de la gestion des forêts au Canada très précisément documentée.
On pourrait dire que c’est une mise à jour du livre de D. Gabor The Mature Society. La conclusion est intéressante, l’auteur hésite, il ne veut pas finir sur une note pessimiste, il note que nous sommes tous — dans les pays développés — à profiter des possibilités de se déplacer etc. et donc participants implicitement à une certaine hypocrisie.
C’est très honnête, et révélateur du fait qu’il semble bien difficile de publier en Amérique une position vraiment radicale aujourd’hui, sauf à s’appuyer, à gros efforts de documentation, sur une révélation à sensation (Naomi Oreskes and E. M. Conway, David Michaels, etc.) d’où la force nouvelle d’internet.
• Albert Jacquard et Hélène Amblard, Réinventons l’humanité, Postface de Serge Latouche, Sang de la Terre, 2013.
Est-ce que les propos de Jacquard sont ceux d’un chrétien ? C’est la question qui me vient à l’esprit après la lecture de ce petit livre-bavardage comme il dit lui-même. La question est fondamentale parce qu’elle concerne la dissipation d’un trouble attaché à la pensée contemporaine, une ambiguïté si on prend cela comme un risque constaté, une bifurcation si on y voit l’amorce d’une perspective d’avenir nouvelle. Par ses écrits il donne l’impression d’être athée si l’on entend religion comme ensemble de croyances révélées. Albert Jacquard est un scientifique ayant assez parcouru les sciences expérimentales et les sciences humaines pour avoir acquis une distance vis à vis des systèmes globaux et s’être complètement déterminé sur la base de ses propres réflexions. Pourtant il y a du christianisme dans ce livre. En quel sens ?
Il y a chez lui le sentiment très profond que si l’Histoire continue suivant les mêmes valeurs mercantiles et individualistes, l’avenir s’annonce insoutenable, indigne, une accoutumance au spectacle de la souffrance et de la barbarie.
Dans cet entretien il adopte tantôt le ton des souvenirs, l’art d’être grand-père en toute simplicité, tantôt le registre grave de celui qui tire la raison profonde de l’expérience d’une vie. Et dans ces pages aux mots posés, mesurés, c’est un message très fort qui nous est livré avec deux volets : D’abord ce qui compte c’est la société de demain. Vers quelle humanité allons nous ? Comment sera cette humanité, ses inégalités, son degré de solidarité. Et ensuite, second volet, l’idée que c’est à tort que les gens pensent que leurs enfants leur appartiennent, la possession, le sentiment de propriété est à remettre en cause, et pour les objets, et pour les enfants.
« Nous avons à réaliser l’unité de l’humanité… »
« Il en est de l’histoire comme de l’actualité. De même qu’à Pechpeyrou la vérité est partout il n’est pas une seule et unique musique. Il nous faut écouter l’ensemble de la symphonie »
Et l’égoïsme qu’il dénonce n’est pas de surface :
« A nous de faire l’humanité. Si nous disons ‘désapproprions la Terre‘, il nous faut dire aussi ‘désapproprions l’enfant‘ »
« Dans le catéchisme on vous apprend à ne pas vous installer dans la vie. Pourquoi s’installer dans la vie ? On ne s’installe pas dans une chambre d’hôtel. Nous sommes donc dans la vie pour un temps, pendant lequel nous n’aurions qu’à nous réjouir de l’éternité. C’est le paroxysme de l’égoïsme : il ne s’agit que d’attendre. Ce cheminement conduit à introduire la notion d’objet de possession au niveau de la procréation. Or, il se trouve que la procréation, succédant à la reproduction, débouche sur l’infini des possibles. Cette révolution n’est toujours pas comprise ».
Jacquard fait allusion, je pense, à la combinatoire, en effet assez vertigineuse, de la procréation : par combinaison de deux moitiés de gênes tirées au hasard les individus sont tous dans des configurations uniques.
« Au delà de liberté et d’égalité, ‘fraternité‘ n’est plus une façon de boiter derrière l’essentiel. Au contraire c’est à partir de là que commence l’essentiel. Redéfinissons la fraternité comme participation à quelque chose que nous ne pouvons pas définir seuls, elle devient quelque chose d’actif »
» ‘Désapproprions la Terre‘ commence par ‘désapproprions l’homme‘. »
Jacquard va très loin avec cette idée de cesser avec ce « droit » de propriété. Il est à contre courant. Beaucoup au contraire posent que le propriétaire soigne mieux « son » bien, que c’est la raison de la difficulté des biens communs. Thèse très répandue mais à courte vue, les biens communs sont là, on ne peut raisonner comme s’ils étaient des épiphénomènes.
La question que nous posions d’emblée serait finalement celle de savoir si cette prise de conscience pourrait légitimement être placée dans le sillage des valeurs chrétiennes ? Il est certain que c’est discutable… Les « pays chrétiens » se sont comportés à des moments clés de leur histoire avec la pire sauvagerie et le plus grand cynisme pour justifier leur intérêt (conquête espagnole de l’Amérique du Sud, commerce triangulaire, esclavage, guerre de l’opium, etc., etc.). Aujourd’hui l’Occident, porteur de cet héritage, est dominant dans le système économique et démissionne devant sa responsabilité globale (conférence de Copenhague, et suivantes…).
Pourtant, je ne vois pas sur quoi d’autre que le christianisme on pourrait fonder la solidarité indispensable qui nous manque et l’universalisme de la condition humaine. Le matérialisme dialectique a échoué et de toute façon avait été inventé pour résoudre d’autres problèmes. Il y a là un renouveau, une refondation, pour la pensée chrétienne elle-même, comme l’ont compris — après Jacques Ellul et d’autres philosophes — nombre de jeunes qui agissent dans les associations et les ONG.
En haut de la page 46 Albert Jacquard cafouille un peu avec le paraboloïde hyperbolique… ses cours de la Montagne Sainte Geneviève sont un peu loin, il est tellement dans le registre de la générosité que cela n’a aucune importance.
En ce qui concerne la postface de Serge Latouche qui est très bien, je n’ai rien à dire, si ce n’est que beaucoup d’arguments esquissés (Madoff, Kerviel, Marcellin Berthelot, Yves Coppens, etc.) portent moins que la raison simple et directe à laquelle s’en tient Albert Jacquard.
• Bernard Perret, Pour une raison écologique, Flammarion 2011.
Dans un monde où le profit règne sans souci du long terme, où s’épanouissent le commerce des armes, la corruption, le trafic de drogue, où perdurent les haines et violences religieuses et raciales, où les inégalités donnent à certains individus la richesse de nations entières, est-il bien raisonnable de parler de raison, serait-elle écologique ? Le choix de Bernard Perret n’est pas de dessiner une harmonieuse utopie où la nature est préservée par des humains sages, instruits et généreux en accord avec des institutions idéales. Son projet est, plus concrètement, de déduire des contraintes physiques et naturelles et de principes éthiques simples respectueux du futur, non pas un système dans la tradition des doctrines philosophiques, mais plutôt la charpente d’une organisation sociale fondée sur un mode de vie proche mais différent.
L’ouvrage est à cet égard un peu déconcertant. Sous couvert d’une réflexion prudente dans son mode d’expression et modérée dans le déplacement suggéré au lecteur, il présente comme indispensable un nouveau cadre de rationalité tout à fait accessible mais qui tourne le dos résolument à la croissance et à la pensée économique dans ses tentatives de marchandiser l’environnement. La raison construite par Perret est certainement raisonnable mais plus radicale que celle de Tim Jackson par exemple dans son essai Prospérité sans croissance qui tente de préserver, autant que faire se peut, les usages économiques auxquels nous sommes habitués. Bien des constats récents d’immobilisme font penser, en effet, qu’il faut franchir les bords d’une cuvette pour que les forces de déplacement du capitalisme ne fassent revenir au business as usual.
La première partie de l’ouvrage « Le règne de l’inconséquence » est consacrée à pointer ce qu’il faudrait appeler les pertes, au sens psychologique, qui sont à faire. D’abord l’illusion de la croissance verte. Perret montre que le découplage entre croissance et consommation des ressources n’est pas suffisamment opérant pour justifier cette idéologie issue des idées optimistes du sommet de Rio relatives au développement durable, et qu’il est incontournable de faire le deuil d’une certaine idée du progrès. Mais aussi les œillères de la pensée économique, l’illusion d’inclure l’environnement dans l’économie et l’incompatibilité entre la logique de marché et celle de l’effort partagé. Enfin une perte également est à faire sur une certaine conception de la raison d’Etat comme jeu compétitif de puissance.
Dans la seconde partie l’auteur étudie l’essence de ce que peut être la raison entendue comme au dessus de la pluralité des raisons qui animent la vie sociale. Philosophe spécialiste des politiques publiques, il excelle ici à situer la responsabilité de façon plus claire que ne l’avait fait Hans Jonas, en se fondant sur la volonté de durer et en analysant la force de la raison écologique comme universalité potentielle malgré sa faiblesse comme utopie sociale.
Enfin la troisième partie qui représente la moitié de l’ouvrage établit les grandes lignes d’un nouveau cadre de rationalité, par huit chapitres très aboutis qui constituent un des meilleurs exposés disponibles de ce qu’on doit envisager comme mode de vie et organisation sociale pour et après la transition écologique. Citons : les problèmes juridiques concernant l’environnement et les générations futures; les relations à la nature, le recyclage, la diversité, les ressources locales plutôt que lointaines, l’économie de la fonctionnalité; la nécessité d’une « métamorphose » du capitalisme pour subordonner les marchés aux objectifs politiques, etc. Perret insiste sur la dé-marchandisation, c’est-à-dire une autre définition du bien-être que par la consommation et une restriction du domaine de la marchandise.
Un point tout à fait essentiel parmi ceux que souligne l’auteur est l’importance de la constitution d’indicateurs à disposition des décideurs publics et privés qui ne soient pas établis en termes de prix ni de coût, mais en termes réels, qualitatifs et quantitatifs, comme l’empreinte écologique, pour décrire l’état de l’environnement et pour faire connaître l’effet sur l’environnement de telle ou telle décision, indications qui sont très mal fournies par le système des prix de marché.
Il faut insister sur la qualité de cet ouvrage qui émerge nettement de l’immense littérature consacrée à l’environnement. Aisé à lire par un style simple et précis, il apporte une argumentation très forte sur la critique de la pensée économique et redonne à la philosophie en tant que recherche d’une raison une place bien analysée entre sociologie et environnement.
On raconte que lors du naufrage du Titanic les chanceux qui avaient pu monter dans les chaloupes en nombre insuffisant étaient obligés de taper sur la tête ou sur les mains de ceux trop nombreux qui en nageant tentaient d’y monter et risquaient de faire sombrer les barques. Nous serons rapidement dans une telle problématique de taper sur les têtes ou sur les mains, si rien ne se passe. Aussi bien le livre de Bernard Perret peut être vu comme une urgence : définir clairement ce qui doit être abandonné et sur quelle base construire. Ou sinon, si la scène politique et économique continue à être dominée par ceux qui disent que les hommes ne sont jamais conduits par la raison, ce ne sera qu’après la guerre écologique que la question se posera, et alors dans les mêmes termes.
• Illusion financière, de Gaël Giraud,
Coll. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire, Les éditions de l’atelier 2012.
Dans le courant des années 1970 la finance a amorcé une mutation profonde institutionnalisant une technicité de haute volée qui caractérise la période néolibérale actuelle. Les difficultés à comprendre ces nouveaux arguments mathématiques et ces nouvelles pratiques de gestion financière ont alimenté, tout naturellement, la machine universitaire tant au niveau de l’enseignement que de la recherche, abondamment durant une trentaine d’années maintenant. Mais on commence à se poser des questions. De nombreux intellectuels après avoir approfondi et clarifié ces technicités veulent faire vraiment le point et dresser le bilan des rapports de la finance avec le fonctionnement économique et social sans se laisser impressionner par la subtilité juridique et mathématique. C’est le cas de Gaël Giraud. S’appuyant sur une remarquable connaissance de l’économie financière au plan théorique et de la gestion opérationnelle dans les salles des marchés, il est en mesure de rendre transparentes ces pratiques et de poser les questions majeures: économiques car le bilan économique est mauvais, politiques parce que le langage classique du libéralisme ne correspond plus à la réalité, et éthiques à cause de l’érosion continue de la solidarité.
L’ouvrage prend la crise des subprimes comme entrée en matière, ce qui n’est pas original, mais donne l’occasion d’initier le lecteur à la titrisation dans un style pigmenté d’anecdotes savoureuses et d’exemples édifiants sur les usages de toute cette quincaillerie de produits dérivés. Le point central est que la mise en marché des créances par la titrisation a transformé « la relation de confiance entre un créancier et son débiteur en un bien de propriété privée » une marchandise. Le titre de ce premier chapitre «La « société de propriétaires » un idéal messianique ?» est une interpellation qui ne sera explicitée complètement qu’à la fin du livre. Le second chapitre prolonge le premier comme décryptage de la crise européenne à la lumière du jeu des agissements financiers. L’auteur fournit une foule de faits précis sur les liens d’intérêt des établissements et des acteurs qui donne à la crise grecque un sens très différent de celui qu’on entend le plus souvent. Ces chapitres sont remarquables de pertinence et de lucidité.
Après avoir porté la critique au niveau théorique en dénonçant la soi-disant efficience des marchés financiers, l’ouvrage prend sa véritable dimension avec le chapitre 4 sur la transition écologique. L’incapacité de la finance à prendre en compte les objectifs sociaux et naturels est illustrée par la pratique de l’effet de levier dans la gestion des risques, par la notion de bulles et d’effet grégaire (taches solaires) ainsi que par l’agitation spéculative des cours mondiaux. Mais l’auteur n’en reste pas à la critique. L’essentiel de l’ouvrage est un plaidoyer pour faire admettre la légitimité de solutions nouvelles en matière de création monétaire et de gestion économique des biens communs. S’appuyant sur l’idée de liens contractuels dans l’esprit des travaux d’Elinor Ostrom concernant les « communs » et sur les possibilités qu’offre la création monétaire non exclusivement privée, l’auteur construit une proposition tout à fait intéressante pour la transition écologique qui se veut réaliste dans le contexte européen et il explicite pour cela les chantiers prioritaires.
Si l’énergie est souvent prise comme point d’argumentation, la question du nucléaire n’est pas abordée en tant que telle. Non plus la grande question des transferts Nord-Sud qui apparaissent à bien des égards comme la clé des blocages des négociations climatiques et environnementales. L’auteur entend se focaliser sur l’articulation de la finance avec le fonctionnement concret de nos sociétés, cette région où le quotidien pousse à accepter trop rapidement des comportements dont nous ne mesurons pas les conséquences.
La grande valeur de ce livre réside certainement dans la lumière qui est faite sur les non-dits. Par sa maîtrise technique et sa compréhension des mécanismes, l’auteur dit — souvent très courageusement — ce qui est occulté par le vocabulaire ressassé et superficiel qu’on entend partout. Du coup, même si on a quelque réticence à le suivre sur certaines solutions précises, son livre ouvre largement la palette des possibilités d’engagement hors du fatalisme qui nous est savamment distillé (en nous imposant par exemple les réactions de la bourse tous les midis sur les radios nationales).
C’est sur une réflexion morale importante que s’achève l’ouvrage par son dernier chapitre qui s’adresse particulièrement aux chrétiens mais ne peut laisser indifférent quiconque se préoccupe des conséquences sociales du partage ou du déclin des valeurs altruistes.
A cet égard l’universalité du message du Christ a fondé historiquement des valeurs de solidarité qui se trouvent être maintenant contradictoires avec le fait que la religion chrétienne reste celle dont les pays les plus riches se réclament en premier lieu, dans un monde fini qu’ils ont exploité le plus et continuent à polluer. Ce livre interroge profondément cette situation et ouvre une dimension nouvelle de l’héritage chrétien occidental qui n’est pas de se sentir conforté et cautionné dans ses affaires et son patrimoine mais de contribuer à la fondation d’un vivre collectif respectueux de l’autre et de la nature.
• Jean-Baptiste Poulle Réflexions sur le droit souple et le gouvernement d’entreprise, Le principe « se conformer ou expliquer » en droit boursier. L’Harmattan 2011.
La liste des raisons qui coupent la finance de l’opinion s’allonge et ceci porte à réfléchir. Il y avait l’ésotérisme des nouvelles techniques mathématiques relatives à la couverture des options (cf. N.B. « Les réticences de l’opinion envers la finance » Esprit nov. 1998), l’extension des calculs aux risques de créances titrisées qui furent un facteur aggravant de la crise des subprimes (cf. N.B. « Malaise dans la finance, malaise dans la mathématisation, Esprit fév. 2009), à quoi se sont ajouté les critiques sur les pressions politiques exercées par les marchés financiers économiquement contestables comme l’a souligné le collectif des « Economistes atterrés », tout ceci dans un paysage de contestation des vertus du capitalisme devant les défis environnementaux de la planète (cf. notamment Bernard Perret, Pour une raison écologique, Flammarion 2011). Particulièrement difficile à comprendre et à accepter furent les mesures adoptées envers les banques après la crise qui avec les règles Bâle 2.5 (et en Europe CRD3) et le projet Bâle 3 se rangent dans la catégorie des thérapies douces sans interdits stricts. On est loin de la limitation des effets de levier, de la réduction de la création monétaire privée ou de taxe sur les transactions financières telles que prônées par les partis de gauche ou l’association ATTAC. Ces règles sont des dispositifs complexes concernant les encours, les agissements, les méthodes comptables et d’évaluation des risques qui ne sont juridiquement que des recommandations.
Sans s’occuper uniquement de cet exemple particulier le livre de Jean-Baptiste Poulle analyse en profondeur la philosophie de ce droit souple qui régit donc la machinerie la plus puissante du monde et a commencé à être utilisé par la Commission européenne dès 2006, donc avant la crise, avec la directive 2006/46/CE relative aux sociétés cotées en bourse.
La conviction sur laquelle s’appuient ces usages juridiques est précisément à l’opposé de ce que pense le citoyen généralement. Elle est que des règles contraignantes non seulement n’atteignent pas toujours leur but mais ont l’effet de distordre le libre jeu de la concurrence donc le bon fonctionnement des cotations, des achats et des ventes. Au fond ce qui fait que le marché fonctionne bien est que tous les acteurs peuvent y exprimer librement leur intérêt, ce qui veut dire l’intérêt tel qu’ils le voient eux-mêmes. Mais alors ces axiomes du néo-libéralisme ne sont-ils pas nécessairement la négation de toute régulation ?
C’est là qu’intervient un principe aussi génial que subtil : « comply or explain », en français « se conformer ou expliquer ». On demande annuellement aux banques ou aux entreprises concernées soit de se conformer à une règle prudentielle ou déontologique explicite (telle que les clubs d’affaires ou fédérations professionnelles en élaborent) soit si ce n’a pas été le cas pendant une certaine période de l’année d’indiquer pourquoi ils ne l’ont pas fait et ce qu’ils ont fait alors. Cela fait immanquablement penser à l’éducation parentale trop coulante où l’enfant peut tout faire pourvu qu’il sache tenir une conversation sur ses agissements !
Mais en fait il y a derrière ce principe d’abord une exigence de transparence, a posteriori évidemment, ce qui n’est pas rien si l’on pense aux excès des paradis fiscaux, des places off shore et des abus du secret bancaire. Surtout on remarque que l’autorité judiciaire n’a plus à sanctionner sur le fond mais seulement sur la forme et qu’elle laisse les recours éventuels des acteurs les uns contre les autres faire la police finalement ce qui est en harmonie avec les axiomes de base.
Dans le cas de l’Europe, Jean-Baptiste Poulle montre que la gouvernance par le droit souple dans le cas de la directive 2006/46/CE fut adoptée par la commission dans le but de ne pas heurter les règles juridiques en vigueur dans les Etats membres, la souplesse et la recommandation étant ici l’expression du jeu entre directive et subsidiarité. En l’occurrence le principe « se conformer ou expliquer » est aussi un outil pour les pouvoirs publics pour mieux s’informer des meilleures pratiques et pouvoir en tenir compte de façon plus appuyée sur certains points ensuite. Cela constitue une sorte d’étude d’impact in vivo, particulièrement précieuse en terme de pouvoir si l’on pense que les administratifs dominent difficilement l’hyper sophistication financière. La commission se met ainsi dans une position où la menace de règles contraignantes partagées par les usages majoritaires suffit à faire assez bien respecter les recommandations.
Le livre de J.-B. Poulle particulièrement clair et extrêmement documenté est à la fois une référence pour les juristes professionnels, un outil de travail pour les étudiants en droit et une provocation intellectuelle pour le néophyte. A ceux qui s’intéressent aux relations entre capitalisme et écologie ou entre néo-libéralisme et générations futures, il pointe le problème majeur que le credo de la « raison économique » et de la vertu des marchés imbibe profondément le droit lui-même et ceci à un niveau de pouvoir tel qu’il semble dépasser l’action politique standard. Le fait que la crise des subprimes n’ait pas modifié ces croyances est difficilement compréhensible, si ce n’est par l’interpénétration des milieux politiques et des milieux financiers notamment aux Etats-Unis. Mais certaines idées font leur chemin, sans revenir au Glass-Steagle Act, George Osborne chancelier de l’échiquier, après presque un an d’hésitation vient d’imposer aux banques britanniques de séparer partiellement leur activité de détail et leur activité d’investissement.
• Philippe Derudder et André-Jacques Holbecq Une monnaie complémentaire, Pour relever les défis humains et écologiques Editions Yves Michel, 2011.
Il est plus utile ici de souligner l’importance des questions auxquelles cet ouvrage propose une réponse que d’en faire un résumé.
Comment valoriser les biens collectifs
Nourrie d’une inquiétude grandissante devant les catastrophes techniques, l’érosion du vivant, les limites de la planète et le changement climatique, la pensée écologique a développé des thèses, révolutionnaires ou réformatrices, qui dénoncent la société de consommation, le profit destructeur du capitalisme débridé, le Business as usual. Mais depuis les premières semonces, maintenant anciennes, peu de changements se sont produits : plusieurs causes de dommage reconnues continuent de croître. Nous sommes à un stade où la majorité des gens a pris conscience des tendances et de leurs conséquences mais où néanmoins les outils du passage à l’action ne sont pas là. Au point que la communication sur ces sujets devient paradoxale : l’inquiétude au niveau collectif au lieu de susciter la valorisation des biens communs, la mise en place d’institutions de mesures et de contrôle, et de préserver le cadre de vie, accentue les comportements de protection individuelle et l’égoïsme des ménages d’où une planification inopérante dans les pays pauvres, un vote en faveur de l’économie la plus libérale dans les démocraties occidentales et une industrialisation déréglementée dans les pays en développement par renforcement de la mondialisation.
Depuis longtemps les analyses de Jacques Ellul, d’André Gorz ou de Lester Brown qui plaident en faveur d’une économie écologique et durable ont pointé la nature destructrice du marché capitaliste : elle est principalement due à la quête de croissance et à la dévalorisation de fait des biens collectifs. De la valeur n’est accordée qu’aux activités et ressources qui peuvent immédiatement s’ouvrir à l’argent et en générer. Les biens qui ne sont pas déjà propriété privée sont traités comme gratuits, exception faite de ceux qui sont répertoriés comme en péril à protéger dans des nomenclatures tardives et toujours mal appliquées. Les prix de marchés ne prennent pas en compte les dommages à long terme de l’environnement. La question des taux d’intérêt et celle de l’actualisation sont au cœur de cette pseudo-rationalité envahissante. Aussi de tous les projets de réforme de l’économie, la monnaie, cette technologie sociale si efficace actuellement, est-elle sans doute l’outil le plus performant que l’on puisse réajuster.
Agir sur le long terme grâce à la monnaie
C’est une idée à la mode. Plusieurs personnalités et partis politiques ont évoqué récemment la création monétaire comme une éventualité sérieuse à prendre en compte pour des objectifs de redistribution sociale ou environnementaux. Est-ce possible actuellement avec quelques modifications dans la réglementation financière en Europe ? Ou bien est-ce là une utopie que le capitalisme va aisément virtualiser ? L’usage de la monnaie est fondé sur la confiance. Y toucher est délicat. Pourtant une des leçons de la tornade financière récente n’est-elle pas, in fine, que la confiance vient moins de l’imposante architecture des sièges des établissements financiers que du fait que les Etats représentent l’économie réelle due au travail des hommes ?
La masse monétaire n’est pas gérée de la même façon aux Etats-Unis ou au Japon où les banques centrales peuvent mener une politique monétaire publique c’est-à-dire frapper monnaie pour l’Etat, et en Europe où la Banque Centrale Européenne et les Banques Centrales Nationales qui la représentent n’ont pas ce droit et ne peuvent donc jouer que sur des taux par l’intermédiaire de banques privées. En effet l’article 123 du traité de l’Union stipule : « Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. » La philosophie du traité est d’obliger les gouvernements à emprunter à des taux fixés par le marché dans le but d’empêcher la création monétaire publique perçue comme facteur d’inflation. Cette disposition impose aux Etats de se plier au jugement privé de rentabilité qui choisit des taux variables suivant les perspectives de sécurité de remboursement.
Des difficultés graves en ont résulté pour des pays tels que la Grèce, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne qui doivent emprunter à des taux bien supérieurs à ceux des pays comme la France et l’Allemagne économiquement plus crédibles. Elles ont entraîné les décisions de la BCE et du FMI que l’ont sait de création du fonds de stabilité financière européen qui a prêté à la Grèce 110 milliards d’Euros pour l’instant jusqu’en 2013. Mais ce genre d’arrangement avec la lettre du traité pour raison politique, est critiqué comme un risque indu par une part de l’électorat français et surtout allemand. Les deux logiques s’affrontent et aujourd’hui à la mi-avril 2011 les marchés prêtent à la Grèce à dix ans au taux de 14,5% et à l’Allemagne à 3,3%, de quoi méditer…
Les banques privées créent de la monnaie de plusieurs façons, la plus évidente est qu’en moyenne le rythme global des crédits qu’elles accordent est supérieur au rythme des remboursements de prêts qu’elles reçoivent et aussi — la crise a montré que ce n’était pas une hypothèse d’école — parce que les risques de contrepartie font qu’il y a des crédits non remboursés, les montants correspondants sont de la création monétaire. Le lecteur trouvera des précisions sur ces mécanismes sur le site de l’association Chômage et monnaie et sur celui de la BCE.
Un des moyens de la création monétaire publique : une monnaie supplémentaire écologique
Alors que la monnaie est évidemment sociale puisqu’elle n’a pas de fondements « naturels » c’est un choix très fort de confier quasi-exclusivement à des instances privées le soin de la créer, car elle est le moyen d’action par excellence. D’un point de vue écologique, on impose ainsi au système ouvert que nous sommes comme êtres vivants la recherche de profits immédiats. De nombreux auteurs considèrent que cette stratégie financière est anachronique et que — compte tenu des problèmes globaux — le pouvoir politique doit reprendre démocratiquement la maîtrise de ce levier essentiel. Les emprunts contractés par les Etats auprès des marchés se perpétuant et se cumulant si le budget reste déficitaire — ce qui est le cas dans la plupart des Etats — on arrive à un régime permanent qui ressemble à la création monétaire publique sauf que 1) il y a rémunération des banques privées (domestiques ou internationales) 2) la charge de l’intérêt de la dette incite les Etats à utiliser la part gouvernable du budget (celle qui n’est pas promise à des frais permanents) à des placements dont la rentabilité est proche des taux privés. Le long terme, plus incertain et moins urgent, ne peut plus être envisagé et traduit en politique économique.
Des économistes aux Etats-Unis (cf. Real-World Economics Review), au Royaume Uni (cf. la revue Prosperity) et même en Allemagne (cf. le site Monetative) proposent une réappropriation publique de la création monétaire comme outil pour la maîtrise d’objectifs globaux et environnementaux. Cela pose deux sortes de difficultés.
1) Une question de gouvernance : comment limiter la création monétaire par les BCN pour les Etats. Question politique et juridique qui se complique dans le contexte européen, mais qui au fond est forcément soluble puisque ce type de responsabilité est assumé par la FED aux Etats-Unis actuellement. Elle est au demeurant hors de l’agenda européen car le pays le plus attaché au système actuel est aussi celui qui a les meilleures performances économiques.
2) Une question de mise en œuvre : comment se fait le passage entre les objectifs (définis par la politique environnementale) et des actions économiques ? Le problème est similaire à celui soulevé par le CDM, mécanisme de développement propre, où des entreprises affichent qu’elles font des investissements pour aider les pays en développement à moins polluer, et font parfois tout autre chose, en délocalisant tout simplement. Les objectifs sont des mots, leur sens est vague, les indicateurs sont plus complexes que des prix. Comment s’assurer que sous couvert d’effort vers ces objectifs les entreprises ne vont pas faire bénéficier d’autres pans de leurs activités des mécanismes d’incitation publique ?
C’est notamment en raison de ce risque de dérive que les auteurs de l’ouvrage présenté préconisent la création d’une monnaie supplémentaire utilisée par des entreprises à vocation sociétale. Leurs propositions — qui prolongent les thèses de Ph. Derudder Rendre la création monétaire à la société civile, Yves Michel 2005 — sont très convaincantes et semblent pouvoir se faire en France sans contradiction avec le système actuel, même pouvoir entraîner d’autres pays par la suite. Le style est plaisant et les technicités très pédagogiquement exposées par des analogies accessibles. L’ouvrage n’est pas dogmatique ni abstrait, il fait d’autant plus réfléchir.
• Fred Hirsch, Social Limits to Growth, Harward Univ Press 1976.
Publié peu après le premier rapport du Club de Rome (D. Meadows et al. 1972) cet ouvrage entend mettre en évidence un phénomène plus important : « l’inquiétude quant aux limites de croissance qui a été exprimée en long et en large par le Club de Rome est totalement hors de propos. On se focalise sur des limites physiques lointaines et incertaines et on omet la présence de limites sociales certes moins apocalyptiques mais immédiates ».
La démonstration de Fred Hirsch est du domaine de l’économie non formalisée. Son point de départ est la thèse — présentée comme évidente quoique politiquement très marquée — que la différenciation sociale est un moteur primordial de l’économie : parmi les biens de consommation, sont de plus en plus recherchés ceux qui sont positivement corrélés à la position sociale. Idée plus ou moins dérivée de celle de consommation ostentatoire de Veblen. L’exemple générique choisi par Fred Hirsch est l’éducation : les ménages sont prêts à des efforts financiers en ce domaine si et seulement si les formations donnent accès à des professions attractives et des opportunités sociales. Plus généralement toute l’économie est activée par le champ de force de la recherche d’une meilleure position sociale.
Or plusieurs phénomènes interviennent qui contrecarrent cette dynamique. D’une part la position sociale est un concept relatif qui ne saurait augmenter en moyenne. De sorte que l’accès du plus grand nombre aux biens de consommation et au confort satisfait de moins en moins l’appétit de supériorité sociale. Ce bien qualitatif est d’une nature particulière dont on peut dire « What each of us can achieve, all cannot ». C’est cette attraction vers un « mieux que les autres » qui a été le moteur de la croissance économique notamment dans la période d’industrialisation et encore récemment parce qu’on partait d’une société inégalitaire. Mais l’accroissement de la population et du bien-être de chacun désamorce nécessairement cette dynamique fondamentale. Les syndicats, en réclamant pour tous ce que tous ne peuvent avoir ont leur part de responsabilité dans cet état de chose (cf. p 9). Fred Hirsch considère que les besoins primaires étant satisfaits, ce sont les « biens positionnels » qui deviennent prépondérants. On arrive donc à un feed back négatif absolument incontournable. C’est la première partie du raisonnement.
Vient ensuite une analyse des conséquences de cette logique implacable qui est assez simple : nous sommes contraints de changer nos systèmes de valeurs pour privilégier le collectif sur l’individuel et restreindre les enjeux de la compétition de position sociale. « Le capitalisme a en effet apporté des bas de soie, qui étaient le privilège des reines, à chaque ouvrière; dans cette sphère, dans cette phase, il a été un grand niveleur, comme Schumpeter l’a montré. Sa réussite malheureusement ne le rend pas capable de répéter la performance pour les aspects non matériels des privilèges passés ou présents ».
Non seulement le point de départ de Fred Hirsch fait montre d’une vision très conservatrice de la société, mais l’argument principal du livre est douteux. Depuis que l’enseignement supérieur est devenu un enseignement de masse, une proportion importante des étudiants se motivent sur la seule base de l’intérêt des contenus disciplinaires indépendamment des débouchés effectifs, phénomène bien connu contre lequel les pouvoirs publics tentent d’agir comme ils peuvent. La séparation entre biens matériels et biens positionnels est peu pertinente. Il est clair que la possession d’un téléphone mobile est d’autant plus intéressante que l’usage de ce moyen de communication se répand, et de même pour ses perfectionnements. L’économie d’Internet est un contre-exemple à la pseudo loi de Hirsch.
En ce qui concerne la conclusion, la démonstration n’est pas plus convaincante. L’argument se retourne de lui-même. On peut penser en effet que dans une société durable il y aura beaucoup de « choses à faire » comme dans un jardin à entretenir. Il faudra nettoyer, trier, recycler, etc. Ces tâches d’intérêt général plus ou moins pénibles seraient — si on suit la logique de Hirsch — obtenues plus facilement si une forte inégalité sociale suscite des appétits pour améliorer sa condition. D’où une société très inégalitaire… Evidemment une société durable ou moins déséquilibrée que la nôtre peut sûrement prendre des formes très diverses, la politique et l’histoire ne s’arrêteront pas avec l’épuisement des ressources fossiles.
Dans le brouhaha des médias et des politiciens en matière de limites de croissance, la thèse de la société durable a du mal à se faire entendre. La situation se complique lorsqu’elle est défendue avec de mauvais arguments. Cela ajoute à la confusion et conforte finalement le « business as usual ».
Il semble bien au contraire que ce qui risque de provoquer des changements sociaux, ce n’est pas tant l’érosion du relief social ou l’essoufflement des appétits arrivistes mais bien plus la lente montée des inquiétudes pour soi et les siens qui nourrit d’une valeur refuge et de protection tous les biens que l’on peut s’approprier et transmettre à ses enfants. C’est moins réjouissant que le discours sympathique de mettre progressivement l’accent sur les valeurs collectives qui est le choix conclusif de Hirsch.
Quarante ans après la publication de ce livre, on a envie de dire que le deuil que Hirsch doit faire c’est uniquement le sien propre d’une conception erronée de la société. Quant à la question — très abstraite — de savoir s’il y aurait des limites strictement sociales indépendamment de toute contrainte physique, le développement des technologies de la communication rend plausible une réponse négative, et c’est sans doute une des raisons qui fait que les contraintes physiques sont trop souvent oubliées.
• Michel Serres Genèse, Grasset 1982.
Ce très beau livre est paru durant la période où Bruno Latour animait, avec sa fougue et son impertinence habituelles, le bulletin de liaison intitulé Pandore, où émergeait une pensée contestataire sur la science, accompagnée de projets de recherche et d’initiatives pédagogiques sous la bannière STS science technique et société.
Je restitue ici un commentaire que j’avais commis dans ce cadre ainsi que la réponse de Michel Serres, plus comme évocation du climat de ces temps bien différents, que pour le débat lui-même. Je tente ensuite de dégager ce qui, fondamentalement, a changé. La méchante quérulence de mon propos est inappropriée, elle est une réaction à des éloges qui m’apparaissaient excessifs plus qu’à l’ouvrage lui-même. Mais elle pointe tout de même un problème.
Le livre de Michel Serres, Genèse a fait l’objet dans ce bulletin de trois commentaires élogieux. Sans doute parce que je suis étranger par ma formation au milieu des sciences humaines et donc ignorant des règles du jeu implicites d’un tel exercice, ces louanges m’ont gêné, et je voudrais faire part ici d’une lecture de ce livre un peu différente.
Je dois reconnaître d’abord que j’ai été impressionné par la qualité du style. Par style, j’entends non seulement le choix de la forme des phrases, du vocabulaire et la puissance d’évocation obtenue par les analogies et les polysémies qui va jusqu’à la découverte d’enchaînements qui sont de vraies trouvailles, mais aussi l’architecture du livre et la justesse du ton et des registres où l’essentiel n’est jamais confondu avec l’accessoire. Se rapporte également au style l’usage de la manière étymologique — ce n’est pas vraiment une méthode — tant utilisée par les philosophes surtout contemporains (Heidegger, Deleuze, Derrida, etc..) qui consiste à redonner une plénitude de sens à un mot en le chargeant de tout le « pouvoir » de la famille étymologique associée des langues mères ou cousines : Noise, noiseuse, the noise; randonnée, random; chaos, cahot, cohue… Si le but est de donner du sens, cette manière est une sorte de table d’harmonie : d’une note surgit aussitôt la quinte, l’octave et tout un jeu de résonances. Cependant la musique des synthétiseurs est un peu monotone, l’aria, la phrase a aussi son importance. Je ne critique pas cette manière qui a tout le charme des choses culturelles mais je m’étonne qu’elle rencontre un tel succès en philosophie. Il me semble, en effet, — et alors évidemment ces questions de style touchent des questions de fond — que le but et la motivation de bien des philosophes contemporains est, précisément de « donner du sens à des concepts nouveaux » c’est là que se situe pour eux la création philosophique. Le culte de la raison libre et créatrice va parfois jusqu’à prendre une telle importance que la place centrale en philosophie se trouve tenue par l’amour de la création ou poïematophilie, discipline à laquelle se sont plus ou moins adonnés des auteurs tels que Bergson, Brunschwicg, et bien d’autres. La poïèmatophilie s’oppose essentiellement à l’esprit de système, systèmes scientifiques ou philosophiques, et c’est peut-être la spécificité de Hegel d’avoir tenté le tour de force de concilier les deux. Genèse est typiquement, ne serait-ce que par son titre, un ouvrage de philosophie poïèmatophile, nous y reviendrons. Je voudrais simplement noter sous cet angle, à propos de la manière étymologique, qu’il se trouve, et c’est un fait curieux, que si l’on suivait la même démarche en mathématiques, on n’inventerait jamais rien. En faisant résonner l’intégrale de Riemann avec la notion de primitive et le calcul d’aire de Pythagore, on ne passe jamais à l’intégrale de Lebesgue. C’est, en tout cas ici, sur une construction, une articulation nouvelle que se greffe le sens nouveau.
Ma lecture de Genèse fut sereine et même agréable jusqu’à la page 161 : « Nous devons introduire en philosophie le concept de chaos, mythique jusqu’à ce matin, […] Quand on importe en philosophie un concept issu de la science, on n’a pas grand peine, tout le travail est déjà fait […] Tricheur. Le grand espoir est d’importer des concepts vers la science pour des pratiques à venir … » Ai-je bien compris ? M. Serres propose à la science un concept nouveau : Le chaos ? Quel est le plus tricheur des deux ? On ne crée pas par prétérition, assurément la science n’aura que faire de cette proposition. Je vois d’ici les équipes de recherches occupées à travailler ce concept, à cultiver et jardiner ce germe dont les rameaux porteront les fruits de la nouveauté. Y a-t-il là autre chose que de la poudre aux yeux ? A partir d’un tel concept tout reste à faire. Il y a dans les poubelles de l’histoire des sciences des idées autrement plus prometteuses qui n’ont rien donné.
De telles propositions sont pléthore chez les commentateurs de la science. L’un voudrait développer une logique énergétique (S. Lupasco), l’autre abandonner le principe d’identité pour sauver l’occident (M. de Dieguez), celui-ci construire une nouvelle sémantique, celui-là aider la physique à sortir de l’impasse, etc.. Tous ces « possible worlders » sont des marchands de rêves. « Tenter de penser, tenter de produire, suppose de prendre des risques… Introduisons donc le concept de chaos ». Quels risques, en effet! M. Serres ne mérite-t-il pas au moins autant la noix d’honneur pour ce passage qu’E. Morin pour sa noologie « scienza nuova » à développer.
Le chaos est un concept mort-né. La philosophie, de maïeutique qu’elle était, serait-elle devenue faiseuse d’anges ?
Je signale d’ailleurs en passant que le concept
de chaos a déjà été utilisé dans la science où il est
attaché au nom de Norbert Wiener (dont les travaux semblent bien connus de M. Serres, son nom étant cité à plusieurs reprises dans Le passage du Nord-Ouest) qui a su lui donner une certaine fécondité puisque ses travaux furent suivis par ceux de Kakutani, Ito et Segal et d’autres liés à la théorie quantique des champs. Mais sans doute s’agit-il de tout autre chose, l’idée de Serres est de potentialités infiniment plus grandes…
Nicolas Bouleau
Paru dans Pandore N°21 Décembre 1982
Réponse de Michel Serres
Je remercie Monsieur N. Bouleau de sa lecture critique. Je suis content qu’elle soit ponctuelle, cela permet la discussion, claire et calme.
Revenons à la dite page
161, qui paraît mériter reproches et même noix. Je dis en cet endroit mon intention d’importer, d’introduire en
philosophie le concept de chaos. Soulignons : introduire en philosophie. Monsieur Bouleau souligne : proposer à la science. Là, ponctuellement, est le désaccord. La lecture ne suit pas l’écriture.
Introduire, importer sont des verbes de mouvement, ils indiquent quelque transport d’un lieu vers un autre. Ici le transport va du mythe vers la philosophie. Je dis bien : introduire en philosophie le concept de chaos, mythique. Le chaos, en effet, n’est qu’une figure mythique, je le prends là où il est, dans la Genèse (la vraie) ou chez Aristophane, chez Lucrèce, et j’essaie de le transporter vers la philosophie qui, en effet, n’en parle presque jamais. Je ne dis pas que je le transporte dans la science. Je sais qu’il faut de tout autres conditions, de rigueur, de précision, de fidélité à des protocoles expérimentaux, pour qu’un concept soit dit scientifique. Je n’ai aucune prétention de ce genre, bien sûr, et n’en ai jamais eue.
Voici, en gros, trois
lieux : le mythe, la philosophie, les sciences, qu’on peut
distinguer, au moins pour la
commodité. Le vieil Auguste
Comte disait que les idées, au
cours de l’histoire, transitaient par les trois lieux,
qu’il nommait, dans sa langue : théologie, métaphysique,
positif. Ce n’est pas tout à
fait une loi de l’histoire massive, comme il le croyait, mais ce n’est pas non plus une mauvaise approximation. Il n’est pas déraisonnable de penser, en effet qu’un concept passe d’un de ces lieux à l’autre. Bien des concepts de la science ont été des notions de la philosophie et des fragments de mythe, avant.
Cela dit, je crois bien que le mouvement est à sens unique. Il va, quand il y va, du mythe à la philosophie, et de celle-ci à la science. La tricherie que je critique est de le faire aller dans l’autre sens. Quand le philosophe introduit en philosophie un concept issu de la science, mouvement inverse, il n’a pas grand travail, en effet. E. Kant, par exemple, essaie d’introduire en philosophie le concept de nombre négatif. Cela ne signifie pas grand chose. Je ne dis rien de plus.
Si, je dis plus. Je dis que l’espoir, le seul espoir du philosophe est de travailler dans le mouvement que j’indique, de travailler pour la science et antérieurement à elle. S’il travaille postérieurement et dans l’autre sens, il copie, simplement, il recopie, on n’a pas besoin de lui. La science n’a pas besoin d’épistémologie, si celle-ci est en aval d’elle. L’espoir du philosophe, en amont de la science, est de raffiner les gros cailloux dragués en amont encore, du côté du
mythe ou d’ailleurs, et de les préparer pour un avenir, qu’il ne sait ni ne peut
prévoir.
Non, je n’invente pas une science, je suis loin d’une telle arrogance, je fais mon métier, plus grossier, de philosophe. Mon métier d’anticipation.
Il me semble, vu clairement ainsi, que je ne mérite, de la noix, ni l’honneur, ni l’indignité. Merci, en tous cas, aux lignes de N. Bouleau.
Michel Serres,
Paru dans Pandore N°22 Février 1983.
Trente ans se sont écoulés.
Qu’est-ce qui a changé ? Nous sommes les mêmes, c’est le contexte, le grand Autre comme dit Lacan, ce dont nous nous préoccupions sciemment et ce qui restait implicite. On ne parlait guère des travaux du Club de Rome, très peu de transition écologique, jamais de décroissance. C’était bien avant que Serres publie ses thèses majeures sur nos liens à la nature et nos liens entre nous, avec Le contrat naturel et Le Tiers-instruit.
Ce qui me frappe c’est que le courant que Bruno Latour a incarné et qui a pris dans son sillage toutes les sciences studies était une critique de l’universalisme de la science et de ses prétentions à tirer le monde vers l’avenir qui ne prenait pas son motif initial du constat de la dégradation environnementale, du moins pas essentiellement. Comme dit le poète Que peu de temps suffit pour changer toutes choses.
L’utopie soviétique tenait encore, la période néolibérale de Thatcher-Reagan n’avait pas encore installé les marchés financiers dans toute leur puissance ni dérèglementé les protections sociales acquises de hautes luttes.
Voici un exemple révélateur. Le livre de Michel Serres commence par une jolie histoire intitulée Conte court :
Me promenant cet été-là, sous un ciel éclatant, à la voile, et dérivant avec paresse sous le soleil et dans le vent, je me trouvai, un beau matin, dans les parages morts et verts de la mer des Sargasses, en un lieu mystérieux où la lumière de l’aurore faisait miroiter follement des millions de petits éclats de toutes formes et couleurs. Laissant porter, je vis avec stupeur un champ d’à peu près cent hectares entièrement peuplé de bouteilles dansantes. Il y en avait un nombre incalculable. Chacune contenait son message, sans doute, chacune avait son poids et sa petite ondulation, lestée de coquillages et de rocaille, chacune portait son espoir et son désespoir. Les vents noués les avaient toutes poussées là, de- toutes distances, à partir de mille azimuts. Leurs rencontres, régulières, hasardeuses, rendaient un carillon aigu et cacophonique. Ce bruit montait au ciel, allait à l’horizon, il emplissait l’espace d’ivresse.
La nuit suivante, une large sargasse me mit en péril de naufrage. Et j’étais sur le point de couler. Je fis vite de quelques bouteilles un radeau, elles me servirent de flotteurs et d’outres, je rentrai ainsi à Bordeaux.
Aujourd’hui, ce sont des bouteilles en plastique qui flottent sur la mer. Les détritus légers forment un nouveau continent de cinq fois la surface de la France au milieu du Pacifique. Toutes les rivières par leur travail patient emmènent ces souvenirs de notre insouciance vers les gouffres amers des poètes. Mais la fureur de Poséidon n’y fait rien, l’environnement est pensé comme une providence qui sera capable de tout résorber, tout cicatriser. Ceci nous renvoie encore à Michel Serres : Le Mal propre : polluer pour s’approprier ?
Que pensait de ces ponts avec la philosophie Henri Lebesgue qui a apporté aux mathématiques des concepts si féconds? Voici:
Mon bon maître, Jules Tannery, disait: « Il est prudent de respecter, au moins provisoirement, ce que l’on ignore ». D’autre part, si ignorant que je sois, je n’oublie pas que c’est parce que des philosophes ont longuement médité sur des problèmes, si difficiles qu’on ne peut même les formuler, qu’ils sont parvenus à en isoler des questions plus simples: celles dont s’occupent les sciences.
Nous devons respecter la philosophie; il ne s’ensuit pourtant pas qu’elle puisse nous aider ni à comprendre mieux nos sciences, ni à les faire progresser. C’est un fait que les sciences se sont développées surtout quand elles ont pris conscience de leur individualité et se sont séparées de la philosophie.
Que les philosophes recherchent si quelque méthode, ayant fait ses preuves dans le domaine scientifique, ne pourrait pas leur être utile, cela est naturel et raisonnable; c’est aller du facile au difficile. Mais que les mathématiques, qui étudient des questions si simples qu’on peut en donner des solutions précises et définitives, aillent demander des ressources à la philosophie, qui doit se contenter de réponses imprécises et précaires, je n’ai pu l’admettre.(H. Lebesgue Sur la mesure des grandeurs, Gauthier-Villars 1956)
Curieusement pour revenir au chaos, il est aussi quelque chose que l’on était bien incapable d’anticiper à cette époque où nous dialoguions de ce sujet. Ce fut la plus grande « vision nouvelle » à laquelle j’eus la joie d’assister durant ma carrière de mathématicien. Par deux articles de 1978 et 1983 puis une série d’autres Paul Malliavin est parvenu, en partant des idées de Wiener sur les chaos, à construire un calcul intégro-différentiel nouveau fécond de toute sorte de propriétés, en analogie ou contre analogie avec le calcul usuel développé par Newton et Leibniz. Bien dans le style mathématique de son inventeur, le calcul de Malliavin n’est pas, dans sa forme première, un souci de plus grande généralité mais l’équipement d’un objet central, l’espace du mouvement brownien de Wiener, d’une panoplie permettant de nouvelles méthodes. En particulier cela fournit une approche originale pour montrer que certaines variables aléatoires obtenues par le calcul stochastique ont des densités. Ce courant fit naître un engouement chez les mathématiciens tout à fait comparable à celui que le « sociocentrisme » créa dans les départements de sciences humaines. Une rubrique de la classification mathématique porte maintenant le nom de calcul de Malliavin.
Paul-André Meyer que l’on peut considérer comme la figure de proue de l’Ecole probabiliste française de la seconde moitié du XXème siècle et qui a contribué à ces idées de façon majeure a pu dire « L’intérêt est assez difficile à prévoir, les chaos de Wiener, par exemple, ont été découverts par Wiener dans les années 30, il en a donné la définition et personne ne s’y est intéressé… On prend conscience du fait qu’une chose qui n’a l’air de rien du tout est la clef, l’idée autour de laquelle toute sorte de choses s’organisent… »
Voir pour plus de détails Le calcul intégro-différentiel de Malliavin ou Malliavin calculus.
Finalement sur les apports mutuels de la philosophie et de la science, je trouve que la science fait l’objet d’un respect par certains et d’un irrespect par d’autres qui proviennent en fait d’une même vision apodictique de cette forme de connaissance qui se caractérise par son effort vers une certaine objectivité et une certaine universalité jamais atteintes. Mais il est une autre façon de se servir de la science en philosophie que de la considérer comme si les descriptions dont elle tente de rendre compte portaient sur un champ de réel délimité et précis, car ce n’est pas le cas. La science est aussi un formidable ensemble d’exemples et de façon de penser dont on peut tirer parti pour ouvrir des raisonnements philosophiques.
D’une certaine façon, le sociocentrisme est une idée audacieuse et séduisante de tenter de montrer combien les contenus de connaissance sont socialement construits. Mais maintenant, avec le recul, cette démarche patine quelque peu, parce que, finalement, nos moyens de description du social sont assez limités. Malgré toutes les études de cas que l’on voudra et les finesses méthodologiques des sociologues et des anthropologues (reconvertis à l’étude de la modernité) la description du social est assez pauvre (et ce n’est pas l’économie avec ses petits calculs qui peut se targuer de davantage d’imagination).
Au contraire, comme Quine et Lacan l’ont compris, chacun dans un registre différent, mais aussi Prigogine et Stengers, on a le droit parfaitement légitime — bien aussi légitime que la sociologie des sciences — de se servir des situations que la science nous fait connaître pour montrer que le réel peut être plus complexe et surprenant que la philosophie ordinaire ne le laisse entendre. La science est un champ d’expérimentation philosophique. Une aide à imaginer des mondes possibles, ou plutôt à imaginer des possibilités du monde.
